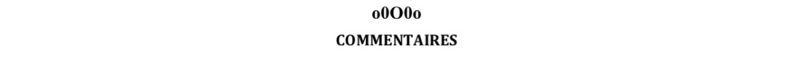J°012 – Plurilinguisme en Europe et défense du français dans les pays de vieille souche francophone
Le présent article s’appuie, à titre d’illustration, sur la défense du français dans les pays francophone d’Amérique du Nord, le Québec et l’Acadie.
À l’ICEO, nous défendons et promouvons depuis longtemps le concept d’un trilinguisme souple au sein des instances européennes et de leurs ramifications multiples. Il s’agit de lutter contre l’élimination progressive et sournoise du trilinguisme officiel des langues dites de travail de la Commission et des services de l’UE (allemand, anglais, français) qui vise à imposer à terme le monolinguisme du tout-anglais comme langue unique de communication entre Bruxelles et les pays membres de l’Union.
Chacun de ceux qui nous lisent savent que notre trilinguisme souple repose sur le principe que tout intervenant dans ce contexte européen devrait présenter d’abord son intervention, qu’elle soit orale ou écrite, dans sa langue maternelle, la mieux à même d’exprimer les nuances de sa pensée et la faire traduire ensuite, pour les besoins de plus large diffusion, dans deux des trois langues de travail, ou l’une de ces trois plus une autre langue de l’Union si jugée plus pertinente avec l’objet de son intervention. Ce faisant, notre ambition est de défendre l’égale dignité de toutes les langues nationales et d’éviter leur déclassement au rang de patois locaux : une langue n’est pas qu’un outil de communication, c’est aussi le produit d’une histoire, le support d’une culture particulière qui apporte à la culture commune. Ensemble, ces langues font la richesse de la culture et de la civilisation européenne, notre patrimoine commun. Il ne s’agit pas ici de multilinguisme, simple constat de cohabitation de plusieurs langues, y compris éventuellement dans chaque pays. Il s’agit bien de plurilinguisme qui signifie que, idéalement, chaque individu dans son pays respectif et chez ses voisins, doit être capable de comprendre et de s’exprimer dans trois langues : la sienne plus deux autres.
Dans ce contexte, défendant toutes les langues et chacune en particulier, nous défendons aussi la langue française, en France mais aussi dans les pays francophones qui se la sont appropriée, en tout ou à différents degrés selon leur origine et leur histoire.
Le présent article s’appuie ainsi, à titre d’illustration, sur la défense du français dans les pays francophone d’Amérique du Nord, le Québec et l’Acadie notamment où il est toujours menacé par son environnement anglophone en dépit des lois qui théoriquement le protègent. Les exemples concrets que nous citerons ci-après seront suivis de l’importante contribution, originale et pertinente, que l’un de nos amis et partenaires, Thierry PRIESTLEY[1], a bien voulu nous adresser après lecture de ces articles que nous lui avions communiqués. Intégrant au présent cet article sa contribution fortement argumentée autour d’une approche originale de ce combat linguistique, nous espérons ainsi ouvrir un débat avec nos amis lecteurs pour l’alimentation duquel toutes contributions ultérieures seront les bienvenues.
[1] Thierry PRIESTLEY : voir notice sous l’article de notre site : N° 280 Partenaires associatifs et amis d’ICEO, sur la toile et sur le terrain

Texte tiré du journal LA PRESSE, Montréal, Québec :
« Le français » : Laurence VINCENT, entrepreneure et dirigeante d’entreprise, La Presse, le 16 octobre 2022
— C’est effrayant à quel point votre génération utilise des mots en anglais.
— Ce n’est pas si pire que ça quand même !
— Vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez passé la fin de semaine à parler de KPI, de templates, de process, de USP, de stakeholders, de forecasts… Ça me choque de voir que vous n’êtes pas capables de parler français !
Après deux jours de réunions internes, nous étions tous attablés lorsqu’un de nos directeurs, dans la soixantaine avancée, nous a reproché notre désengagement total envers la langue française.
Pour moi, qui suis une fière défenseure de la survie de notre langue, j’avais honte. Était-il possible que ce soit si terrible ? J’ai toujours été sensible au français. Chez nous, mes parents me répétaient sans cesse : « C’est parfait de vouloir apprendre et parler l’anglais, mais parle une seule langue à la fois. Quand tu parles anglais, parle anglais et quand tu parles français, utilise des mots français. Ils existent tous. »
Notre entreprise était jusqu’à tout récemment dirigée par un anglophone et un francophone. Pourtant, du temps de Jon, nous n’avons jamais utilisé autant de mots en anglais qu’aujourd’hui. La réalité ne pouvait faire autrement que de me frapper. C’était vrai. Le branding. Going forward. Think outside of the box. Avoir du leverage. Les best practices. Les low hanging fruits. Les quick wins. Un petit touch base. Je feel pas. C’est un no brainer. Your call. Faire du small talk… J’étais effarée de la quantité de mots que mon collègue m’énumérait.
Une partie de moi avait envie de lui dire qu’il exagérait. Que « donner du feedback », c’est naturel dans notre langage québécois. Pourtant, dans les faits, le mot en français existe. C’est de la rétroaction. Bien sûr, d’un point de vue phonétique, c’est moins cool… Je veux dire moins trendy… Heu… je veux plutôt dire branché ! J’ai dû effectuer une recherche de trendy en français, parce que mon cerveau ne l’avait pas dans ses points de repère naturels.
Notre laisser-aller, notre paresse linguistique générationnelle, c’est ça, le véritable problème. Les expressions de notre propre langue ne nous viennent plus spontanément.
Elles sont là pourtant. Elles sont toutefois moins répandues et moins naturelles. C’est sûr que ça fait bizarre de dire chouette, plutôt que cool, de dire mignon plutôt que cute, de parler d’une salle d’exposition, plutôt qu’un showroom… Ça fait plus coincé, plus formel, parler français. Ça donne l’impression d’être un peu plus stuck-up…
Heureusement, grâce à mon collègue, j’ai découvert la fierté oubliée de trouver le mot juste et de ressortir ces perles de petits mots français délaissés pour la « coolitude » américaine. Je dois l’avouer, je me sens parfois ringarde à utiliser des mots que ma grand-mère utilisait à l’époque et que je n’ai jamais entendus au XXIe siècle. Finalement, peut-être que that’s the real battle ?
Depuis novembre dernier, notre équipe s’est donc donné le défi de parler réellement en français. D’utiliser des mots français, québécois même, parce que c’est encore mieux d’utiliser nos mots colorés ! Et pour nous « donner une chance », nous nous sommes accordé le droit d’utiliser des anglicismes plutôt que de perpétuer notre accoutumance à la sonorité anglaise. Pour l’instant. Parce que c’est tough en tabarouette de déconstruire une façon de parler que nous tenions pour acquise depuis si longtemps.
Je dois avouer que, souvent, je n’ai pas de fun à m’arrêter tous les deux mots dans une phrase pour me corriger, ou pire, me corriger sur le même mot trois fois de suite dans une même conversation. À l’écrit, ça va, on se force davantage, mais à l’oral, surtout quand on se laisse aller un peu, c’est vraiment tout un challenge ! Quand nous voulons être naturels, spontanés, c’est plus smooth de dire que c’est world cup, plutôt que génial.
Je dois avouer que la première semaine, tout le monde trouvait ça drôle. Mais depuis neuf mois, je casse les oreilles de l’ensemble de ceux qui me côtoient avec ma recherche de mots français.
Avec mes amis, mes collègues, ma famille, je leur ai tous fait part de ma nouvelle marotte. Ils ont trouvé l’idée initialement charmante, pour se tanner plus ou moins vite et finir par me trouver fatigante en maudit !
À tous ceux qui ont levé les yeux au ciel dans les derniers mois, je veux vous dire que je vais m’entêter. Parce que savez-vous quoi ? Après neuf mois, je trouve encore difficile de ne pas dire que « je trouve ça tough ». Et quand je relâche un peu la garde, les mots de Shakespeare… ou plutôt, devrais-je dire, ceux de Britney Spears… se faufilent bien malgré moi entre mes lèvres. Je ne lâcherai pas parce que la cause est juste. La protection du français au Québec est fondamentale. Et nous avons tous un rôle à jouer. Il n’y a pas une loi sur terre qui viendra dicter les mots qui sortent de nos bouches tous les jours. C’est un choix. Une responsabilité.
Êtes-vous game ? Acceptez-vous le défi de n’utiliser que des mots français durant la prochaine semaine ? Essayez-le, vous allez voir que c’est beaucoup plus ardu qu’il n’y paraît, mais c’est un effort qui en vaut la peine ! Sauf que je ne voudrais pas pousser ma luck…

Texte tiré du journal LA PRESSE, Montréal, Québec :
« Tensions linguistiques dans les tours de condos » – Suzanne COLPRON – La Presse, le 24 octobre 2022
Note d’ICEO : Au Québec, les « condos » (condominiums) correspondent aux immeubles en copropriété en France.
Lorsqu’il a pris possession de son condo, il y a huit ans, M. Serge ne pensait pas devoir se battre pour parler français. Mais la situation s’est à ce point envenimée qu’il s’est résolu à intenter une poursuite en dommages contre les administrateurs de sa copropriété. « Je les poursuis parce qu’ils m’ont dit carrément que je n’avais pas le droit d’être un Québécois au Québec, lance-t-il. Ils veulent que tout soit dans la langue anglaise. J’ai refusé, moi. Et j’ai simplement dit que j’avais le droit de m’exprimer en français au Québec. » L’entrée en vigueur en juin de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, souvent appelée « loi 96 », change la donne. « Ils commencent à comprendre qu’ils ont moins de liberté dans l’imposition de leur volonté », laisse-t-il tomber.
Le cas de M. Serge, qui préfère taire son nom de famille, est extrême, mais il illustre les défis de l’aménagement linguistique dans la vie en condo. Celle-ci soulève des problèmes particuliers, qui ont pris de l’ampleur avec l’explosion de la construction de tours en copropriété au centre-ville de Montréal.
UN CHEZ-SOI
L’enjeu peut se résumer ainsi : un condo, est-ce que c’est un chez-soi où on peut parler la langue de son choix, un espace public où, en principe, la langue commune est le français, ou encore un endroit semi-privé, semi-commercial où s’appliqueraient, par exemple, les règles d’affichage ?
Ces questions se posent de façon très concrète lorsqu’il faut déterminer quelle langue est utilisée dans les assemblées de copropriétaires.
Me Yves JOLI-COEUR, président du Regroupement des gestionnaires et des copropriétaires du Québec, est un expert dans le domaine. « La question de la dualité linguistique dans les assemblées de copropriétaires, c’est une réalité très montréalaise, dit-il. À Québec, ce ne sera pas un enjeu, ni à Chicoutimi. Mais c’est sûr qu’à Montréal, dans une ville très multiethnique, on a cette réalité de la langue, et ce n’est pas juste entre le français et l’anglais, mais également entre les membres de la communauté chinoise qui sont propriétaires, dans les grandes tours du centre-ville, de nombreux appartements. »
Il fait remarquer qu’une copropriété est un milieu collectif, « un milieu de partage d’un actif ».
« Si les gens ne comprennent pas sur quoi ils votent et sur quoi ils ont à partager, c’est évident qu’il va y avoir un autre problème. Il ne faut pas être des intégristes linguistiques, mais il faut avoir à cœur la protection de la langue française. »
L’IRRÉDUCTIBLE FRANCOPHONE
Me Ludovic LE DRAOULLEC, aussi spécialisé en droit de la copropriété, préside des assemblées de copropriétaires depuis 10 ans.
« On se retrouve parfois dans des copropriétés où tu sens que tu vas pouvoir faire l’assemblée uniquement en anglais. Mais, du fait de la loi de la charte française, on se doit quand même de poser la question au début, explique-t-il. Et là, tu vas toujours, comme dans la série Astérix, avoir l’irréductible francophone qui comprend l’anglais, mais qui va dire : “Moi, je ne suis pas d’accord.” Donc, là, on se retrouve obligés de tenir l’assemblée dans les deux langues. »
Ces situations rappellent qu’il faut regarder les deux côtés de la médaille. Les francophones, dans leur souci d’affirmer la place de leur langue, pourront s’appuyer sur les lois linguistiques. Les anglophones, de leur côté, qu’ils soient ou non d’accord avec les lois linguistiques, voudront pouvoir vivre dans leur langue, que ce soit dans leur quartier ou dans leur résidence en copropriété.
Claude DESCHÊNES, ex-journaliste de Radio-Canada, croit de son côté qu’il faut défendre la présence du français. « Il ne faut pas baisser la garde, affirme-t-il. Il faut parler français à ceux qui sont là. On a ce rôle-là. » Il y a un peu plus de deux ans, M. DESCHÊNES a quitté la copropriété qu’il possédait depuis 30 ans, au coin de la rue Sherbrooke et du boulevard Saint-Laurent, pour aller habiter dans une tour de 20 étages au centre-ville, dans un secteur plus anglophone.
Toutes les communications internes sont dans les deux langues, mais la priorité est accordée au français, indique-t-il. Les assemblées annuelles se déroulent aussi en français, avec traduction simultanée dans une salle attenante. Toutefois, sur la page Facebook des résidents de la copropriété, « les gens s’interpellent entre eux en anglais, énormément », constate M. DESCHÊNES. « Je suis surpris. Mais je suis surpris aussi de constater à quel point tout ce monde-là parle français. »
— Claude DESCHÊNES, à propos des résidents de sa copropriété :« La question, c’est : est-ce qu’on sera assez nombreux comme francophones pour leur faire réaliser que c’est important de parler français ? Enchaîne-t-il. Comme la majorité parle anglais, parce que c’est plus simple, ils vont apprendre l’anglais. On se plaint que ça ne parle plus français à Montréal, mais c’est parce que les francophones ne sont pas là ; ils quittent Montréal. C’est ça qui m’inquiète le plus. »
UN CLIVAGE
Le politicologue de l’Université Laval Éric MONTIGNY, qui possède aussi un condo à Montréal, partage ces préoccupations. « Il y a beaucoup de tensions linguistiques dans les réunions annuelles de copropriété, signale-t-il. Le premier enjeu, c’est la langue dans laquelle la réunion doit se dérouler. C’est un enjeu de frustration et de débats. On a même changé d’administrateur de l’édifice parce que des gens se plaignaient qu’il n’y avait pas assez d’anglais. Un autre enjeu important, c’est la longueur des réunions parce qu’elles sont bilingues. Donc, les réunions sont deux fois plus longues. »
La population de sa copropriété est composée à moitié de francophones et à moitié d’anglophones. « Il y a un clivage : des anglophones qui ne parlent pas du tout français veulent être servis en anglais. Il y a des enjeux d’affichage aussi à l’intérieur. Des francophones demandent qu’il y ait une prépondérance de l’affichage en français. »
— Éric MONTIGNY, politicologue
Il ajoute : « Dans les condos, il y a des espaces privés et des espaces communs. Est-ce qu’on doit étendre la portée de la loi aux aires communes pour le vivre-ensemble et la prépondérance du français ? Moi, je pense que oui. Les gens font ce qu’ils veulent dans leur appartement, mais un espace commun, c’est un espace commun, et la langue commune, c’est le français. »
CE QUE DIT LA LOI
Quelles sont les règles qui s’appliquent dans les condos ? [..]
La langue des documents : Depuis l’entrée en vigueur de la loi 96, tous les documents tenus à la disposition des copropriétaires doivent être en français. « On ne peut plus rien publier en anglais au registre foncier », précise Me Ludovic LE DRAOULLEC, spécialisé en droit de la copropriété. « Les déclarations de copropriété ne peuvent plus être publiées en anglais, seulement en français. Ça, ça peut être une source de tensions. »
Les amendes en cas de violation vont de 700 $ à 7000 $ pour les personnes et de 3000 $ à 30 000 $ pour les personnes morales (par exemple, une entreprise, un syndicat de copropriétaires), ajoute Me Yves Joli-Cœur, avocat expert en copropriété.
La langue des assemblées : Toute personne a le droit de s’exprimer en français en assemblée délibérante. « Il existe un droit linguistique fondamental au Québec qui est celui de s’exprimer en français dans les assemblées délibérantes », affirme Guillaume ROUSSEAU, professeur agrégé de droit à l’Université de Sherbrooke, directeur des programmes de droit et politique de l’État.
« Le président d’une assemblée de copropriétaires ne pourrait pas dire : “veuillez parler en anglais parce qu’il y a des gens qui ne comprennent pas le français”. Non. C’est un droit fondamental de s’exprimer en français, ajoute-t-il. En matière de droit fondamental, on ne peut pas renoncer à un droit fondamental. On peut renoncer à son exercice. Quelqu’un pourrait dire : “j’ai le droit de parler en français, mais je décide de ne pas exercer ce droit”. Mais ça ne pourrait pas venir du président. Je ne pense même pas que ça pourrait venir du règlement de copropriété parce que quelqu’un pourrait dire : “votre règlement est contraire à la loi”. »
La langue de l’affichage : Si on publie une annonce pour louer un condo, la loi sur l’affichage s’applique, puisque c’est commercial. La publicité doit se faire en français. Elle peut aussi se faire en français et dans une autre langue, à condition que le texte rédigé en français ait un impact visuel plus grand que celui rédigé dans l’autre langue. « Mais si ce n’est pas à des fins commerciales ou publicitaires, comme une communication interne, ça peut être bilingue 50-50 », signale le professeur Guillaume Rousseau.
La langue du vivre-ensemble : Pour le reste, il n’y a pas beaucoup de choses précises sur les copropriétés. « Au niveau théorique, ça semble bien, mais est-ce que dans les faits, les conditions sociales démographiques permettent vraiment l’exercice de ces droits-là ? » Soulève M. ROUSSEAU. « Est-ce que l’Office québécois de la langue française fait des choses au niveau de la copropriété ? À ma connaissance, ce n’est pas si évident. Le rôle de l’Office, c’est souvent les entreprises, la langue de travail. Est-ce qu’il y a suffisamment de travail de persuasion, de sensibilisation au niveau des copropriétés ? Je ne me souviens pas d’avoir vu un programme spécifique de l’Office de la langue visant à faire la promotion du français dans les assemblées de copropriétaires ».
« Donc, au niveau de la loi, les droits sont là, mais le contexte ne rend pas ça toujours facile dans l’exercice à Montréal. Peut-être qu’il y aurait lieu d’avoir des programmes gouvernementaux de promotion de ces droits-là et de sensibilisation dans l’importance de les respecter. »

Publié dans L’ACADIE NOUVELLE, Nouveau-Brunswick :
« La louisianisation planifiée du N.-B. ou le second génocide acadien » : Ilyes ZOUARI – L’Acadie nouvelle, le 11 octobre 2022
Article d Ilyes ZOUARI, président du CERMF (Centre d’Études et de Recherches sur le Monde francophone)
Avec une nouvelle baisse du poids des francophones, de 1,5 point de pourcentage en seulement cinq ans, et à 30,3% de la population provinciale, les résultats du dernier recensement ne font que confirmer une certitude mathématique: la disparition prochaine du peuple acadien et la redéfinition de la carte du monde francophone, dont l’Acadie du Nouveau-Brunswick ne fera plus partie.
À cause d’une natalité catastrophique, d’un niveau important d’assimilation, d’un cruel déficit en immigration et de l’assimilation, à terme, d’une partie même de la descendance de cette immigration, la francophonie du Nouveau-Brunswick connaît le même processus d’extinction déjà observé en Louisiane. Cet État, où les francophones voyaient leur poids baisser continuellement, perdant localité après localité, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun village francophone et donc plus aucune vie francophone.
Selon toute vraisemblance, la prochaine ville que les Acadiens perdront sera celle de Campbellton, où les francophones sont passés de 53,9% à 52,3% entre les deux derniers recensements. Devraient ensuite suivre, assez rapidement, les villes de Shediac et de Dieppe, où la francophonie s’est écroulée en passant respectivement de 72,2% à 65,9%, et de 72,7% à 67,0%. Comme en Louisiane ou au Manitoba, ces villes seront à leur tour suivies par toutes les autres localités francophones, jusqu’aux plus reculées d’entre elles.
Triste constat lorsque l’on pense aux terribles souffrances endurées par les ancêtres des Acadiens d’aujourd’hui, qui ont réussi par leur courage, leurs sacrifices et les hurlements des Acadiennes lors de leurs multiples accouchements, à redonner vie, espoir et avenir à leur peuple. Un peuple, qui n’avait plus qu’une présence insignifiante dans les Maritimes après ce qu’il convient plutôt d’appeler le «génocide» acadien, conformément à la définition désormais souvent retenue pour le terme, comme par l’ONU et les États-Unis pour décrire la récente tragédie, fort comparable, des Rohingyas de Birmanie (respectivement dans un rapport du 27 août 2018, et dans une déclaration du 21 mars dernier). Mais grâce à son courage, le peuple acadien réalisa une remontée fulgurante, passant à 15% de la population du Nouveau-Brunswick en 1871, puis à 36% en 1951, faisant même dire alors à certains que la province redeviendrait bientôt majoritairement francophone.
Ces souffrances et sacrifices n’auront donc, pour finir, servi à rien. Car le processus de disparition définitive du peuple acadien est désormais enclenché, et clairement entretenu par la majorité anglophone de la province qui n’acceptera évidemment jamais de lui fournir l’oxygène dont il a besoin, à savoir une immigration francophone suffisamment importante.
En effet, voilà déjà longtemps que les Acadiens sont loin d’atteindre leur objectif de 33% d’immigration internationale francophone, et que leurs sont fournies des explications dont la non-sincérité ne fait aucun doute: si le gouvernement provincial le voulait vraiment, il pourrait même parvenir à une immigration presque entièrement francophone, tant la demande est importante, et en particulier au sein du monde francophone (dont la population vient de dépasser les 540 millions d’habitants). Et pourtant, il convient là de rappeler que même si cet objectif devait être atteint, cela n’interromprait nullement le processus de disparition du peuple acadien, qui a en réalité besoin d’une immigration internationale à plus de 40% francophone, car devant tenir compte de l’assimilation, voire environ 50% francophone, en tenant compte de l’immigration interprovinciale grandissante. Ce que la majorité anglophone n’acceptera jamais.
Ce refus systématique et injustifié d’accorder aux Acadiens ne serait-ce que le modeste niveau d’immigration qu’ils réclament, démontre bien le caractère planifié de leur extinction. Pourtant, force est de constater qu’ils se caractérisent par la mollesse de leurs réactions et une quasi-absence d’émotion.
Nul ou presque ne semble mesurer la gravité de la situation, alors que leur disparition est une certitude, faute de natalité suffisante et à cause d’une immigration qui sera toujours elle aussi insuffisante. Si les Acadiens peuvent continuer à être, probablement, le plus sympathique des peuples du monde francophone, il est temps qu’ils cessent d’en être peut-être le plus naïf…
La seule solution est donc la natalité, d’autant plus que la baisse continue et généralisée du poids des francophones rend de moins en moins possible la création d’une province acadienne. L’abandon de cette idée a sûrement été la plus grave erreur commise par les Acadiens, qui se sont ainsi condamnés à leur propre disparition, faute de frontières protectrices leur permettant, notamment, le luxe d’avoir une faible natalité. En d’autres termes, ils se sont condamnés ad vitam aeternam à devoir afficher une assez forte fécondité salvatrice.
Désormais, la question de la natalité devrait être quasiment la seule et unique des préoccupations des Acadiens. À défaut, ils doivent cesser de perdre leur temps et leur énergie à demander l’impossible, comme une immigration à hauteur de leurs besoins, ou à réclamer d’inutiles lois et droits linguistiques, qui seront enterrés dans quelques années au fur et à mesure de leur extinction.
Avec la baisse continue du poids des francophones, faute de territoire où ils fixeraient les règles du jeu, tout effort accompli dans ces domaines n’est que gaspillage d’énergie et d’argent public. Seul un sursaut de la natalité peut assurer un avenir aux Acadiens (en maintenant leur présence et la possibilité de création d’une province acadienne), et de faire faire des cauchemars en plein sommeil à ceux qui veulent les voir disparaître.
Une étude réalisée en 2017 démontrait que les francophones devaient atteindre un taux de fécondité d’environ 2,7 enfants par femme, soit le double du niveau actuel, afin de pouvoir combler les déficits causés par l’assimilation et l’immigration. Avec la hausse récente de l’immigration, le taux requis peut aujourd’hui être estimé à trois enfants, un niveau que l’on rencontre dans des pays assez développés comme l’Algérie et l’Égypte (qui concentre 103 millions d’habitants sur un territoire, hors Sahara, inférieur à celui du Nouveau-Brunswick, qui reste donc à peupler…).
Ainsi, il ne faut nullement dramatiser le sujet, notamment car il n’est plus nécessaire d’avoir autant d’enfants que par le passé, compte tenu de la baisse de la natalité côté anglophone. Désormais, une moyenne de trois enfants suffit à atteindre la même efficacité qu’une moyenne de cinq à six enfants auparavant. 3 = 6, voilà l’équation magique que devraient retenir tous les Acadiens.
La natalité est avant tout une question de mentalité, d’état d’esprit, et non de moyens. Et un peuple sans enfants, et dépourvu de frontières protectrices, n’a absolument aucun avenir. Ceci est une constante historique et éternelle.
Les Acadiens n’ayant réussi à survivre au premier génocide que grâce à leur forte natalité, ils ne survivront donc guère à cette sorte de second génocide, lent et silencieux.
Si rien ne change, la disparition du peuple acadien est une certitude. La génération actuelle d’Acadiens sera la fossoyeuse des réalisations et exploits des ancêtres, et entrera dans l’histoire comme la responsable de la disparition du peuple acadien, du rétrécissement de la francophonie mondiale et de la victoire totale et posthume des génocidaires britanniques du milieu du 18e siècle.
Note d’ICEO. Les esprits curieux qui voudraient en savoir plus sur ce conflit linguistique larvé au Nouveau-Brunswick, entre le gouvernement (anglophone) et les Acadiens, francophones (et peuple fondateur) mais devenus minoritaires, peuvent aussi lire l’article suivant : Langues officielles: la SANB ressort bredouille d’une rencontre avec le PM

Longue note, pertinente et élaborée (c’est de fait un véritable article), que notre partenaire et ami Thierry PRIESTLEY a adressée au secrétaire général d’ICEO
Note que Thierry PRIESTLEY a adressée au secrétaire général d’ICEO, qui lui avait communiqué le premier des articles ci-dessus et qui lui avait demandé ensuite s’il pouvait publier ce long commentaire sur le site d’ICEO, en la combinant aux articles repris de LA PRESSE (nous le faisons sous la forme épistolaire reçue de son auteur. Seules les mises en relief de certains passages ci-après le sont de notre fait) :
Merci cher Jean-Marie,
Pour l’envoi de cet article québécois qui nous donne effectivement une leçon de civisme et de résistance linguistiques édifiante. Juste que, si les Québécois sont moins apathiques à cet égard que les Français, c’est indéniablement du fait de leur histoire, de leur localisation et de leur démographie nationale qui donnent un sens différent et une importance bien supérieure que chez nous à la menace de l’effondrement de leur langue française chez eux au profit de l’américain, tant son océan linguistique les encercle et les submerge plus que jamais.
Cependant, et c’est bien là ce qui sépare mon point de vue de celui de mes anciens camarades des associations de défense de la langue française, c’est que je ne partage ni leurs analyses des raisons majeures de l’abaissement accéléré du statut de fait national et international du français et de bien d’autres langues face à celui de la langue qu’ils nomment « l’anglo-américain », ni encore moins la stratégie d’action qu’ils préconisent pour freiner, sinon inverser, le développement continu de ce phénomène depuis de longues décennies.
En parlant de l’anglo-américain, en effet, ils visent la langue naturelle des pays anglophones, celle des Etats-Unis en particulier, désignés comme les stratèges de la diffusion mondiale de leur langue, alors que d’évidence la langue qui nous submerge n’est pas tant primordialement la leur que celle que je nomme la langue « anglo-managériale » dont le nom désigne ses principaux inventeurs et propagateurs (même si elle en est une émanation utilisant ses normes sémantiques et phonétiques).
Cette langue envahissante est en effet celle que fabriquent et propagent aujourd’hui presque industriellement et à l’ombre de toute investigation et critique journalistiques et universitaires (hélas !) les cabinets de conseil des grandes multinationales et de la haute finance mondialisée dans le contexte de la globalisation et de ce que Alain SUPIOT nomme à juste titre le « marché total« . Ainsi, pour avoir investi totalement et partout toutes les sphères de l’activité humaine, y compris celles de la vie privée (dont l’usage de son corps et les sentiments), de la culture, des sciences, de la recherche et de l’enseignement (les universités et grandes écoles n’étant plus que des entreprises comme les autres, n’est-ce pas Monsieur le président des universités françaises ?), ce marché total s’est donné les moyens de faire pénétrer insidieusement sa langue dans leurs mots et leurs usages linguistiques, sauf peut-être dans ceux de quelques privilégiés de certaines de ces sphères, enfermés dans leurs tours d’ivoire.
En d’autres termes, il est plus qu’urgent selon moi de se rendre compte que le monde marchand globalisé, indépendamment de la volonté des Etats qui sont tous sous sa coupe (même les USA d’une certaine façon), s’est totalement accaparé l’exercice du pouvoir normatif de la langue, celui dont la finalité (comme celle de toute langue) est d’instituer une certaine représentation du réel aux yeux des humains qui n’en dit que la vérité que l’on veut lui faire dire et qui, en l’occurrence, a pour première finalité de servir les intérêts marchands en conformant la représentation de ce qu’ils désignent selon leurs vues. Car oui, la fonction d’une langue est non seulement de faire exister aux yeux des humains ce qui n’existe pas quand ce n’est pas nommé (comme cela est si bien dit dans la Genèse de la Bible), mais plus encore de faire apparaître à ses locuteurs ce qui est bien et désirable et ce qui ne l’est pas, quand ce n’est parfois d’occulter ce qu’on ne veut pas faire apparaître en ne le nommant pas.
C’est bien pour cela que la plus importante production à plus forte valeur ajoutée desdits cabinets de conseil privés, évidemment tue, est bien la production des nouveaux mots, expressions et règles d’usage de leur novlangue à imposer mondialement dans toutes les sphères de l’activité et de la vie humaines. L’objectif non affiché est aussi de formater insidieusement toutes les langues usuelles pour les réduire à ce qui leur donne un usage purement utilitaire auquel les mots de la novlangue peuvent aisément s’accorder pour se substituer ensuite aux mots desdites langues usuelles. Ce sont ainsi ceux et celles dont les langues naturelles originelles (quelles qu’elles soient, y compris l’anglais) sont chaque jour de plus en plus imprégnées dans leur usage ordinaire, jusqu’à rendre obsolète tout ce qui, de leurs mots et de leurs modalités d’usage, peut aiguiser le doute et le jugement critique, autonomiser la pensée, diversifier la représentation de ce qui est et éloigner leurs locuteurs des représentations du monde que portent les mots univoques de cette novlangue qui finissent par s’imposer à tous. Ils s’imposent d’autant plus à elles que le monopole de fait que leurs inventeurs et propagateurs ont de l’exercice du pouvoir normatif de la langue est assorti de celui qu’ils ont de l’innovation en tous domaines dans le cadre du marché total. Ainsi l’immense majorité des mots pour dire le nouveau réel ne sont partout plus que les leurs, à consonance anglo-saxonne de préférence, et ils ne sont pas neutres…
Ainsi s’appauvrissent à grande vitesse, non les langues naturelles en elles-mêmes bien-sûr, mais celles qui sont effectivement parlées par la plupart (sauf au sommet de la société) pour lesquels cette langue anglo-managériale ou l’anglais utilitaire devient le modèle qu’il faut adopter et, peut-être à terme, choisir comme nouvelle langue naturelle par nécessité ou légitime ambition professionnelle. Beaucoup, notamment chez les jeunes, ont déjà franchi ce pas ou sont disposés à le franchir, au prix naturellement d’un terrible appauvrissement de leur capacité d’expression et de leur autonomie de pensée, ce dont ils n’ont peut-être même pas conscience, en croyant accéder au contraire à la langue anglaise du savoir qui est aussi pour eux celle de la promotion sociale.
Sans doute les États-Unis tirent-ils comme avantage de ce triomphe de la novlangue utilitaire des grands marchands du monde la facilitation de l’universalisation de leur langue naturelle (l’anglais) et l’augmentation de leur « soft power » qu’elle favorise, du fait qu’elle est la « langue mère » de cette novlangue et à la maîtrise de laquelle peuvent accéder les plus privilégiés, qu’ils soient américains ou étrangers. Ils n’en subissent pourtant pas moins, eux aussi, l’inconvénient de l’appauvrissement jusqu’à la misère des outils et savoirs linguistiques des masses pauvres et peu éduquées de leur nation, elles sont nombreuses chez eux. C’est ce dont peut-être, il est vrai, leurs élites se fichent totalement puisqu’elles savent attirer chez elles autant que de besoin et à leur service tous les meilleurs chercheurs et ingénieurs du monde, tous devenus de vrais anglophones. S’il y a donc bien complicité et contrat gagnant-gagnant entre les maîtres du monde marchand globalisé et l’Etat américain, nul doute que les vrais maîtres du jeu linguistique mondial sont les premiers et ceux qui en profitent le plus.
Sans doute pourra-t-on m’objecter qu’un tel diagnostic est un peu caricatural. Peut-être, mais, j’en suis totalement convaincu, fondamentalement juste. C’est pourquoi je pense que non seulement la France et les autres pays démocratiques, pour peu que l’on veuille bien oublier toutes les défaillances actuelles de nos démocraties, mais aussi le Québec en dépit de sa vaillante lutte, n’ont aucune chance de faire reculer chez eux et encore moins sur la scène internationale l’envahissement de cette langue anglo-managériale, ni d’y défendre le statut de leur langue naturelle nationale face à la supériorité écrasante de celui de l’anglo-américain, tant du moins que rien ne sera fait par eux pour mettre un terme à la confiscation du pouvoir normatif de la langue par les maîtres du monde marchand globalisé.
Car ce sont eux bien plus que l’Etat américain qui tiennent les manettes de cette servitude organisée au niveau mondial, y compris en Chine et en Russie dont les oligarques n’ont pas; du moins à cet égard, des intérêts et des visées différents de ceux de l’Occident et d’ailleurs. C’est du reste bien pour cela qu’ils parlent et pratiquent tous quotidiennement un « parfait anglais », enfin je veux dire le leur…, à la domination duquel ils participent activement faute de pouvoir faire du « néo-mandarin » la langue universelle du capitalisme néolibéral globalisé (malgré les intenses efforts de l’Etat chinois pour développer l’implantation des instituts Confucius dans le monde). Quant au monde intellectuel d’ici et d’ailleurs, cela fait déjà belle lurette qu’ils ont perdu toute influence sur l’usage des langues naturelles et l’évolution de leurs mots pour dire le réel d’aujourd’hui et de demain. Pire, beaucoup se soumettent sans rechigner aux mots injonctifs de la langue anglo-managériale qu’ils font leurs.
Inverser ce cours des choses est-il alors une ambition excessive impossible à réaliser tant elle touche aux fondements politiques, géopolitiques, économiques et sociaux de l’ordre actuel du monde ? C’est ce dont j’étais jusqu’ici tristement convaincu.
Je pense néanmoins que tout ce qui s’accumule aujourd’hui dans l’actualité du monde pour faire apparaître l’évidence du dépassement par le capitalisme dit néo-libéral de ses limites catastrophiques, qu’elles soient écologiques, géopolitiques, économiques, sociales et autres (on dirait même que ça pète ou sombre de tous les côtés), offre sans doute l’occasion de changer la donne à ce sujet. Mes récentes lectures de « La grande transformation » de POLANYI et de certains ouvrages de CASTORIADIS m’ont du reste conforté dans cet espoir même s’ils n’évoquent pas directement ce thème. Et puisque les catastrophes écologiques actuelles nous imposent de changer notre représentation de ce qui est bien et désirable ou non, peut-on supposer que cette mutation de notre imaginaire collectif puisse s’accorder avec la poursuite de la confiscation (ou l’exercice monopolistique, comme on voudra) du pouvoir normatif de la langue par le monde marchand d’aujourd’hui ? Ce serait folie et absurdité de le croire.
Pour ma part, je pense ainsi que le premier pas fondamental à faire en ce sens est celui d’une profonde réforme de l’école qui se donnerait comme objectif central celui d’enseigner une langue française permettant l’acquisition de la connaissance et du jugement critique et non plus, comme aujourd’hui, l’acquisition de savoirs exclusivement utilitaires, ceux par lesquels se propage sans limites la langue anglo-mangériale. Cela permettrait aussi, en offrant à tous les membres de leurs sociétés les moyens d’une pensée autonome, de sauver de l’effondrement nos démocraties au sens que CASTORIADIS donne à ce mot. C’est dire la multiplicité et l’énormité des enjeux des mutations linguistiques d’hier, d’aujourd’hui et de demain, que malheureusement nos classes politiques et nos intellectuels ne portent jamais dans le débat public, sinon de façon trop réductrice. Peut-être au motif de leur conviction sincère que ces mutations procèdent d’un déterminisme échappant à la volonté humaine et à l’action politique, alors que la redoutable efficacité des stratégies linguistiques des sbires du capitalisme marchand globalisé prouve bien le contraire. La réponse politique à une telle stratégie est donc possible et nécessaire.
Encore faudrait-t-il pour cela que cette lourde question soit enfin réfléchie, mise en débat public démocratique sous les bons angles et intégrée dans les projets des divers mouvements politiques et intellectuels qui ont pour ambition de débarrasser le monde des formes délétères actuelles du capitalisme et de les remplacer par un monde plus sage et plus juste. Nous en sommes malheureusement encore très loin et l’envahissement de l’anglais managérial n’est pas près de s’atténuer, même avec les magnifiques efforts des Québécois…
Merci encore pour l’envoi de cet article et avec mon plus amical souvenir,
Thierry
Voilà donc un débat ouvert sur la question linguistique. Tous ceux de nos lecteurs qui auront pris le temps de lire l’ensemble de ces textes, sont invités à ajouter leur propre réflexion à ce débat. Nous publierons leurs commentaires, qu’ils soient approbateurs ou contestataires mais argumentés et, à l’avance, nous les en remercions.
[Le 28 novembre 2022, 11 H25, J-M. R., Alet-les-Bains] : Un texte qui complète l’article. François LEGAULT et la pérennité de la francophonie montréalaise (Jean-Pierre CORBEIL, professeur associé au département de sociologie, université LAVAL)
À son arrivée à Djerba en Tunisie pour participer au 18e Sommet de la Francophonie, le premier ministre François LEGAULT a affirmé qu’il souhaitait remettre les pendules à l’heure au sujet de ses politiques pour la protection du français au Québec et faire comprendre au premier ministre Justin TRUDEAU qu’ils devront travailler ensemble notamment parce « qu’à 48 % de francophones sur l’île de Montréal, la situation est inquiétante ».
[Le 23 novembre 2022, 14 H45, H. G., Nantes] : Le Monde a publié le 20 novembre 2022 un article intitulé : L’historien israélien Élie BARNAVI, provocateur et amer : « Je suis né grâce à HITLER ».
Un extrait qui complète bien votre article :
Avec quel sentiment avez-vous approché le français ?
Un véritable amour. Jusque-là, le français ressemblait pour moi à un château fort interdit. Et soudain, cette forteresse devenait mienne. Ça a été un éblouissement. J’aime beaucoup l’hébreu, j’aime l’anglais, mais, avec le français, j’ai un rapport à la fois intellectuel et charnel. Une passion qui ne s’est jamais démentie. En posséder les codes, l’écrire aussi bien que mes camarades français, a été l’ambition de ma jeunesse. Cette bataille-là, je crois que je l’ai gagnée.
Qu’est-ce qui vous touchait tant dans cette langue ?
C’est un mystère. Une musique d’abord, des sonorités magnifiques. Une grande richesse, mais surtout une extrême précision. Vous pouvez y dire exactement ce que vous voulez dans les termes que vous voulez. L’anglais, que je possède bien aussi, est plus riche, mais les phrases peuvent avoir plusieurs sens. En français, ça n’arrive jamais. Vous dites clairement, parfaitement, exactement ce que vous voulez dire. Par rapport à l’hébreu, il dispose d’une énorme plasticité grammaticale. J’ai toujours été un historien en herbe. En hébreu, il n’y a qu’un passé. Allez faire de l’histoire avec un seul passé ! Et puis, très vite, je me suis pris de passion pour la littérature française et l’extraordinaire variété des styles qui s’y déployait.