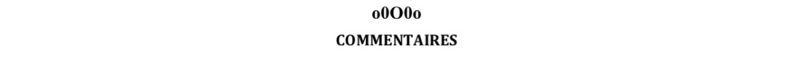N°250 Les Européens : idiots utiles d’un nouvel Empire ottoman et de l’islamisme
Le vendredi 24 juillet 2020, le président Recep Tayyip ERDOGAN a participé à la première prière organisée dans l’ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion en mosquée.
Temps total de lecture : 180 minutes

N°250 [0] ERDOGAN rêvait d’être sultan, il l’est. Rêve-t-il désormais d’être calife aussi?
Les idéologues occidentaux ont rêvé de faire en Turquie le mariage parfait entre l’islam modéré et la démocratie. Après le printemps arabe le rêve s’est envolé, et il a tourné au cauchemar.
Temps de lecture 2 minutes
La Turquie : point de vue de L’Express en 2004
o0o
« Pour ou contre la Turquie dans l’Union?« . Le titre que Jean-Michel DEMETZ a donné à son article publié le 31 mai 2004 dans l’Express, ne doit pas faire trop illusion. Le journaliste présente une longue liste d’arguments pour ou contre, mais la conclusion de son inventaire montre d’évidence sa préférence.
In fine, qu’est-ce qui est le plus risqué pour l’Europe: accepter la candidature turque ou la refuser?
Diplomates et experts turcs n’en font nul mystère, au risque de passer pour des maîtres chanteurs. Si l’Europe dit non, la déception sera telle qu’elle ne pourra compter sur le même zèle de la part d’Ankara pour contrôler les routes de la drogue et de l’immigration clandestine qui passent par son territoire vers les nôtres. Sans parler de la lutte antiterroriste. A nuancer. Il n’y a pas de plan de rechange et les élites turques savent bien, quoi qu’elles en disent, que l’avenir de leur pays est lié, sous une forme ou une autre, à celui de l’Europe. Mais, en disant non, on renforcerait l’islamisme et l’extrême droite nationaliste. «Parce que le pays est dans une période de transition démocratique, un non de l’Europe serait une catastrophe économique et politique», prédit l’homme d’affaires Can PAKER (HenkelTurquie). Il est prêt à attendre la date d’entrée: «La route de l’adhésion est plus importante que l’adhésion elle-même.» La perspective européenne sert aujourd’hui, comme hier en Espagne et au Portugal, d’aiguillon à la démocratisation. Et, sur le modèle franco-allemand, à la réconciliation historique avec le vieil ennemi grec.
«Une Turquie stabilisée, rassérénée et démocratique», c’est notre «assurance-vie», résume Michel ROCARD.

La Turquie : point de vue de L’Express en 2019
o0o
Dans le numéro de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2019, L’Express dresse dans une dizaine de pages un sévère réquisitoire contre le président ERDOGAN. L’article intitulé : « ERDOGAN s’est retourné contre les Occidentaux » est particulièrement inquiétant.
En 15 ans la Turquie a énormément changé, il n’est donc pas étonnant que le journal ait modifié son analyse géopolitique. Il n’est pas étonnant non plus que le regard des Européens sur RecepTayyip ERDOGAN ait totalement changé. Par contre il est triste qu’ils aient mis tant de temps à ouvrir les yeux. La Turquie a certes changé mais les salafistes, eux, n’ont pas changé d’objectifs.
Malheureusement, ce dont se lamentent les Européens aujourd’hui était loin d’être imprévisible,
pour ceux qui connaissaient l’Histoire de la chute de l’Empire ottoman, et le passé des militants salafistes.

N°250 [1] « L’intégration d’un vaste ensemble islamique enrichit l’idée européenne« . Le N-O
N°250 [2] Turquie : des bouleversements pas prévus, mais pas imprévisibles
N°250 [3] Turquie : pourquoi un soudain empressement pour son adhésion à l’UE ?

N°250 [1] « L’intégration d’un vaste ensemble islamique enrichit l’idée européenne« . Le N-O
Le Nouvel observateur 8 décembre 2004 – 24 juillet 2020, le président Recep Tayyip ERDOGAN a participé à la première prière organisée dans l’ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion en mosquée.
Temps de lecture : 3 minutes
« Une telle décision est susceptible de provoquer la colère des chrétiens et d’attiser les tensions avec la Grèce voisine » fit alors immédiatement observer Le Monde, considérant sans doute encore que la déclaration du président turc n’était qu’une bravade électorale, qui ne serait probablement jamais suivie d’effet.
1 1 Ancienne basilique, ancienne mosquée, aujourd’hui ancien musée
Comme un symbole, Recep Tayyip ERDOGAN a choisi pour la première prière le jour du 97e anniversaire du traité de Lausanne qui fixe les frontières de la Turquie moderne et que le président, nostalgique de l’Empire ottoman, appelle souvent à réviser.
Sainte-Sophie reste en Turquie étroitement associée à la prise de Constantinople en 1453 par le sultan Mehmet II, dit le Conquérant. Une fanfare ottomane était d’ailleurs présente sur le parvis de l’édifice vendredi 24 juillet.

24 juillet 2020, première prière du vendredi dans et devant l’ex-basilique Sainte Sophie
Alors qu’ils ont pu l’observer pendant 26 ans, comment expliquer que tant de « spécialistes » de la Turquie soient (ou fassent semblant d’être ?) encore surpris des prises de positions et des déclarations de l’actuel président turc ?
L’Histoire nous enseigne que les individus qui partagent les mêmes convictions politiques, ou qui sont victimes des mêmes présupposés idéologiques, sont souvent affectés du même manque de lucidité et du même aveuglement.
Les plus chauds partisans de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, n’ont pas vu la réalité, ou n’ont pas voulu la voir, pour qu’advienne à tout prix la grande Europe de leur rêve.
1 2 Le rêve vire au cauchemar. On sait aujourd’hui à qui la faute.
Tous ceux qui avaient le mauvais goût d’afficher leur opposition à cette perspective, avaient droit à des cours de géopolitique, délivrés par des maîtres chroniqueurs, se prétendant tous plus savants les uns que les autres en matière de turquerie, d’islam et de laïcité.
La relecture de cet article, 16 ans après sa parution, permet de mesurer à quel point l’un des chroniqueurs spécialistes autoproclamés les plus influents avait pu manquer de clairvoyance et de culture ottomane.
Tel est l’argument que Laurent JOFFRIN et ses homologues ne cessent d’essayer de faire valoir, pour excuser leur manque de perspicacité, et essayer de faire oublier leurs récurrentes et grossières erreurs d’analyse sur la situation politique au Moyen-Orient.
Turquie : des bouleversements pas prévus, mais pas imprévisibles
Les Européens qui n’ont pas su ou voulu voir les fourberies de Recep Tayyip ERDOGAN, en croyant servir l’Union européenne, n’ont été que les idiots utiles d’un nouvel Empire ottoman en gestation.
o0o

Le 9 novembre 2018, Sainte Sophie déjà sous haute surveillance policière et militaire

Pourquoi il faut leur dire oui
Article de Laurent JOFFRIN, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, publié le 13 décembre 2004
Temps de lecture : 6 minutes
Aussi impressionnants soient-ils, ces arguments reposent sur une vision dépassée, fausse et, pour tout dire, archaïque de l’Europe à construire. Non, l’Europe ne sera pas la projection à l’échelle continentale du modèle national. Elle n’aura pas une culture homogène, un héritage religieux commun, des frontières fixes justifiées par l’histoire et la géographie, un pouvoir simple et fort qui exprime l’unité d’un peuple et d’un territoire.
Si tel était le cas, bien sûr, la Turquie n’aurait rien à faire en Europe. Vaste pays musulman qui jouxte à l’est l’Irak, la Syrie, l’Iran, la Géorgie et l’Arménie, pays qui reste autoritaire à certains égards, où l’islam prétend encore régenter la société et où la femme reste souvent opprimée, placé au centre d’une diaspora turcophone de quelque 200 millions de personnes, la Turquie a vocation à devenir un pays charnière, utile mais extérieur à cette Europe bien de chez nous.
Mais est-on si sûr qu’il s’agisse là de la bonne Europe ? A-t-elle d’ailleurs jamais été pensée comme telle ? L’Europe, avant tout, est une construction politique. C’est par l’adhésion volontaire à des principes de liberté politique et économique que l’on est jusqu’ici devenu européen, plus que par une vocation géographique. Avant d’être une terre, l’Europe est une idée. Pour cette raison, l’Union a longtemps récusé l’adhésion de pays parfaitement européens. La Grèce, le Portugal, l’Espagne ont du attendre des lustres avant de rejoindre la CEE. Étaient-ils étrangers à l’Europe ? Non : ils refusaient la philosophie des droits de l’Homme. Pour adhérer, il a fallu qu’ils l’adoptent.
Autrement dit, les nations ne naissent pas européennes. Elles le deviennent. Comment expliquer, sinon, que les pères fondateurs aient accepté le principe de l’adhésion turque dès 1959 ?
C’est-à-dire un an après la signature du traité de Rome… Ignoraient-ils à l’époque que la rive Est du Bosphore, dans tous les manuels de géographie, était en Asie ? Que la Turquie était peuplée de Turcs, c’est-à-dire, pour l’essentiel, de musulmans ? Non : pour eux l’Europe était moins une expression géographique qu’un projet politique. Par contiguïté spatiale, elle peut s’étendre au-delà des frontières de principe dès lors que les principes sont communs. Souvent démocrates-chrétiens, les grands ancêtres ne voyaient pas l’Union comme un club chrétien. Pour eux, répétons-le, l’Europe était une idée avant d’être une terre.
Objet juridique non-identifié, l’Union ne repose pas sur la tradition mais sur la volonté. Elle ne procède pas du passé mais de l’avenir. Un peu comme la nation de RENAN, elle est un référendum de tous les instants, le produit d’un acte conscient et libre bien plus qu’une réalité culturelle. Elle se définit par sa ferveur démocratique, sa volonté d’équité sociale et une politique étrangère de négociation et de coopération plus que de confrontation.
Il y a un « rêve européen » fondé sur l’extension indéfinie des droits de l’Homme, sur l’équilibre social et sur la coopération internationale, rêve dans lequel Jeremy RIFKIN, intellectuel américain, voit la meilleure chance de réussir l’entrée dans le XXIème siècle (1). On peut discuter les thèses de RIFKIN, les trouver trop optimistes dans un monde tragique et violent. Il se trouve néanmoins que cette doctrine est la nôtre. Au fond, sont européens ceux qui la partagent.
A partir de là, tout s’éclaire. La Turquie n’est pas en Europe ? Edgar MORIN le conteste avec beaucoup d’arguments. A vrai dire, c’est une nation duale. Par sa situation géographique, son histoire, sa culture, elle est à la fois européenne et asiatique. Renouant avec une de ses traditions, elle veut désormais se tourner vers l’Ouest. En tout cas, elle est plus développée que la Roumanie, plus laïque que la Pologne, moins atlantiste que la Hongrie et plus favorable à l’Union… que la Grande-Bretagne.
Son économie ne pourra guère nous concurrencer plus qu’aujourd’hui puisque nous sommes déjà en Union douanière avec elle. Sa population croit trop vite ? Comme partout ailleurs, elle cessera de le faire quand elle sera développée, c’est-à-dire bientôt. La Turquie a déjà fait passer sept ou huit grandes réformes qui la rapprochent à chaque fois de la norme juridique européenne. Il reste une marge ? Certes. Mais le sens du mouvement n’est pas douteux.
Dans dix ans, terme prévu des discussions, la Turquie sera alignée sur la philosophie des droits de l’Homme. Et si elle ne l’est pas ? Eh bien, c’est tout simple : elle ne pourra pas adhérer.
On dit que son entrée compliquera la décision européenne et repoussera encore la perspective fédérale. Mais au fait, où en est le fédéralisme européen ? On a fait passer depuis de longues années « l’élargissement avant l’approfondissement », autrement dit l’extension avant la cohésion. La constitution européenne en voie de ratification exclut formellement tout fédéralisme (sinon Tony BLAIR l’aurait récusée).
Un nouvel élargissement ne changera rien à cette situation. La cohésion ne viendra pas d’une soudaine et bienheureuse fixité des frontières. Comme le disent Jacques DELORS, Joshka FISCHER et bien d’autres, elle naîtra de l’action volontaire d’un petit nombre de pays décidés à aller plus loin dans l’intégration et qui entraîneront les autres. La question turque n’y changera pas grand-chose.
Reste la grande question, le véritable aliment, au fond, de toutes les oppositions : l’islam. Quatre-vingts millions de musulmans ? Une folie ! Mais précisément : l’intégration d’un vaste ensemble islamique enrichit l’idée européenne. Il sera démontré à la face du monde – à la face du monde musulman, y compris parmi les minorités présentes en Europe – que le « choc des civilisations » n’est pas inéluctable et que l’islam, comme le catholicisme, le protestantisme ou le judaïsme, est bien compatible avec la démocratie.
Démonstration heureuse et surtout utile : elle crée un pôle démocratique puissant en terre d’Islam et déploie comme jamais l’influence occidentale en Orient. Quatre-vingts millions de musulmans adhèrent d’un coup à la philosophie des droits de l’Homme : quelle victoire ! L’Union européenne est un empire fondé sur le contrat. Mais elle ne pratique qu’un seul impérialisme : celui des valeurs. Par ce moyen, elle a déjà fédéré un continent. La Turquie ne sera rien d’autre que sa prochaine conquête.
Laurent JOFFRIN

N°250 [2] Turquie : des bouleversements pas prévus, mais pas imprévisibles
Le vendredi 24 juillet, le président Recep Tayyip ERDOGAN a participé à la première prière organisée dans l’ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion en mosquée.
Temps de lecture : 30 minutes
Les experts qui se sont lourdement trompés sont tous victimes du même mal : l’ignorance de leur part d’incompétence.
Seuls les experts très compétents peuvent prendre conscience de l’étendue de leurs domaines d’incompétence.
2 1 Des bouleversements pas prévus, mais pas imprévisibles, pour qui connait la LONGUE Histoire et la géographie
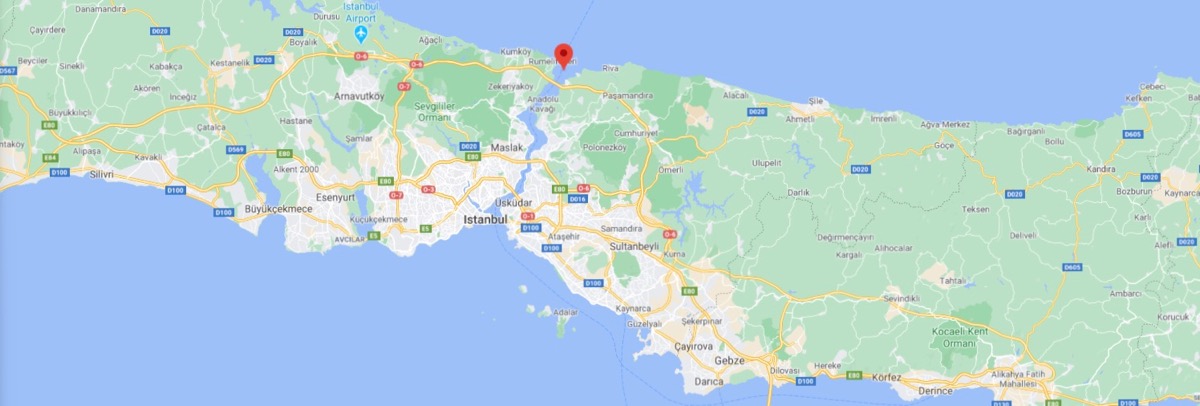
Le Bosphore, un détroit entre l’Europe et l’Asie, très étroit, trop étroit.
Ils jugent très sévèrement leurs anciens, en se demandant comment ils avaient pu être assez naïfs pour croire ce fou sur paroles,
Plus exactement, en faisant hypocritement semblant de se demander, car ils connaissent bien sûr la réponse.
C’est pour dénoncer l’attitude insensée des politiques alors en responsabilité, que Winston CHURCHILL prononça l’une de ses plus célèbres phrases : « Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur ; vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. »
2 2 « L’opium des intellectuels » fait encore des dégâts dans les têtes.
Face aux totalitarismes, il resta un défenseur du libéralisme, à contre-courant d’un milieu intellectuel pacifiste et de gauche alors dominant. En 1955, Il dénonça dans son ouvrage L’Opium des intellectuels, l’aveuglement et la bienveillance, voire la fascination, des intellectuels à l’égard des régimes autoritaires en général, et des régimes communistes en particulier. Le titre fait bien sûr référence à la célèbre formule marxiste « la religion, opium du peuple », exprimant ainsi (non sans une certaine malice) d’une part le parallélisme entre communisme et religion et d’autre part l’attrait irrationnel que la violence révolutionnaire exerce sur les intellectuels.
Raymond ARON fait la critique sévère des intellectuels, qui sont impitoyables aux défaillances des démocraties, mais qui sont si indulgents aux plus grands crimes, sous réserve qu’ils soient commis au nom des doctrines auxquelles ils adhérent quasi religieusement.
Depuis la fin du système soviétique, la consommation excessive d’opiacés idéologiques a continué à faire perdre la vue et parfois la raison à nombre d’intellectuels, qu’ils viennent de la gauche, de la droite ou du centre.
D’anciens admirateurs de Robespierre, de Trotski, de Lénine, de Staline, de Mao, ou de Pol Pot, ayant excusé, voire cautionné, toutes les violences révolutionnaires, sont ainsi devenus en une chute de mur, les défenseurs les plus intransigeants de l’État de droit, prompts à dénoncer comme violence policière, tout usage de la force par les forces de l’ordre.
Paradoxalement, parmi les valeurs que l’Union européenne revendique, ce sont celles qui étaient le plus étrangères au monde soviétique qui sont devenus leurs valeurs de prédilection, respect sourcilleux des droits de l’homme, libre circulation des personnes, et liberté religieuse et culturelle notamment.
Bien sûr, après, ils réévaluèrent le « pouvoir de nuisance » de l’Église catholique contre le monde soviétique, mais aucun d’entre eux ne pouvait admettre que ce serait l’élection d’un pape polonais qui signerait la fin du système communiste en URSS.
2 3 Les raisons de la fin de l’Union soviétique toujours en discussion
Pour les anciens, militants du Parti communiste, sympathisants communistes, compagnons de route du Parti communiste, pour tous les apôtres de l’Union de La gauche, en France et dans le monde, la disparition de l’Union soviétique fut une énigme, qui continue à les hanter. L’historien Marc FERRO écrivit en 2009, « Les Russes ne voyaient pas le rapport entre la chute du Mur et la remise en cause du communisme... »
À droite, les opposants au système soviétique espéraient pouvoir endiguer sa progression, et étaient parfois prêts à tout pour cela, mais aucun n’imaginait sérieusement pouvoir vaincre mortellement l’adversaire. La disparition de l’Union soviétique fut donc pour eux une sorte de « divine surprise« .
2 4 L’Histoire qui fait les hommes, ou les hommes qui font l’Histoire ?
Au moment de la parution, le Parti communiste français était encore le parti dominant idéologiquement la gauche et le climat international était à la Détente, c’est pourquoi l’ouvrage eut un faible retentissement en France, et tomba rapidement dans l’oubli, jusqu’à sa redécouverte entre 1989 et 1991.
Bien que l’historien Marc FERRO considère rétrospectivement qu’il s’agit du « succès le plus mémorable de la clairvoyance dans l’analyse critique », l’analyse de TODD n’est toujours pas unanimement partagée.
Une question les tracassaient : Comment pouvait-on écrire en 1976 que la fin du système soviétique était inéluctable alors que deux événements historiques majeurs de la fin du vingtième siècle n’avaient pas encore eu lieu ?
1 – 0ctobre 1978 : intronisation de Jean-Paul II, premier pape polonais.
2 – Mars 1985 : élection de Mikhaïl GORBATCHEV, Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l’URSS.

Après 1989, et plus encore après 1991, cette question philosophique est revenue en force dans tous les esprits. Les marxistes-léninistes avaient affirmé avec assurance que les religions étaient condamnées à disparaître et que le communisme était appelé à triompher sur la terre entière, pour des raisons objectives.
La chute du Mur de Berlin vint donc semer un grand trouble chez tous ceux qui avait professé le matérialisme historique.
Dans son ouvrage, La chute finale, publié en 1976, Emmanuel TODD, avait déclaré le système soviétique « intrinsèquement stérile », économiquement.
Tandis que les anciens supporters de l’Union soviétique disaient cela pour dénoncer les deux hommes qui étaient, à leurs yeux, coupables d’avoir précipité la fin d’un régime qui portait leur espérance.
2 5 Décembre 1991 fin de l’URSS, avril 2005 mort de Jean-Paul II.
Mikhaïl GORBATCHEV, élu président de l’Union soviétique en mars 1990, alors qu’il avait reçu le prix Nobel de la paix en octobre 1990, fut contraint à démissionner en décembre 1991
Quant aux Russes, qui, à en croire les enquêtes d’opinion, affichent aujourd’hui si peu d’estime pour lui, ils oublient légèrement que sans GORBATCHEV la fin de l’empire soviétique se serait très vraisemblablement terminée dans un bain de sang, comme en Yougoslavie.
Il n’en fut rien. Non seulement, ni les sociaux démocrates ni les sociaux libéraux ne bénéficièrent d’embellies, mais ils suivirent rapidement le même chemin du déclin que les partis communistes quelques années avant.
2 6 Le déclin des partis communistes à l’Ouest antérieur à 1991
Dès 1976, lors des élections municipales, pour la première fois depuis sa création en 1971, le parti socialiste a dépassé le parti communiste. Ce que la SFIO n’avait jamais réussi à faire après la Libération.



Il faut noter aussi qu’en raison du fort taux d’abstention aux élections européennes de 2019 (49,88 %), le vote pour le PCF, le plus faible enregistré de toute son histoire, ne représente plus que 1,19 % des électeurs inscrits, PS 2,96 % et RN 11,16 %.
Déclinant à partir de 1976, le Parti communiste français perdit en 15 ans la moitié de ses électeurs, Tandis que la même année (1976) le Parti communiste italien était flamboyant, avec plus de 34 % des voix, son maximum historique, En 1987, lorsqu’il descend à 27 %, son score le plus bas depuis vingt ans, le PCF ne rassemblait déjà plus qu’à peine 10 %.
Le PCI, premier parti communiste occidental et deuxième parti politique italien pendant des décennies, a donc disparu avant même la dissolution effective de l’URSS en décembre 1991.
2 7 Les partis sociaux-démocrates sur le reculoir avant 1991
En 2020, on peut affirmer que ces démarches étaient illusoires au moment où elles ont été tentées . Le sort suivi par les deux partis les plus engagés dans ces tentatives, le PCI et le Parti communiste d’Espagne en a apporté la preuve.
Ces démarches étaient illusoires, car lorsqu’elles ont été entreprises les partis sociaux-démocrates s’étaient déjà convertis au social-libéralisme, ou plutôt avaient été poussés à se convertir au social-libéralisme, pour répondre aux idéologies devenues dominantes, à gauche et à droite.
Victimes d’une illusion d’optique, à l’heure où ils pensaient avoir enfin gagné, les communistes et les socialistes français n’ont pas mesuré l’importance du rôle qu’allaient jouer de concert, et de conserve, Margaret THATCHER, élue le 4 mai 1979, et Ronald REAGAN, élu le 20 janvier 1981.
La Prime Minister britannique et le président des États-Unis goûtaient mal la participation de quatre ministres communistes au gouvernement français. Leurs programmes économiques et sociaux étaient totalement contraires à celui que les Français prétendaient mettre en œuvre.

Mais après les élections municipales de 1983, perdues par la majorité, et alors que les partenaires européens réclamaient un redressement de la situation économique de la France, Pierre MAUROY se vit contraint d’effectuer le tournant de la rigueur.
2 8 Un virage idéologique en forme de trahison, lourd de conséquences
Les socialistes, contraints de limiter les réformes sociales en raison de contraintes économiques , savaient qu’il était difficile, voire impossible, de redresser la situation électorale rapidement, si l’offre aux électeurs qui s’étaient sentis trahis par la gauche, restait inchangée.
Habile manœuvrier et tacticien de la IVe République, François MITTERRAND avait appris que, pour remporter les élections, lorsqu’on ne peut espérer renforcer son camp, reste la possibilité d’affaiblir celui de son principal adversaire. La façon la plus simple de le faire étant de provoquer des divisions dans le camp rival.
Son éducation familiale, son histoire personnelle et politique, avait donné à François MITTERRAND une connaissance exceptionnelle de tout l’échiquier politique français. Il savait les douleurs, les amertumes et les rancœurs qui s’étaient accumulés à droite depuis la Libération. Aussi, pour trouver des motifs de division à droite et à l’extrême droite il n’avait que l’embarras du choix.
François MITTERRAND, qui avait été Garde des sceaux pendant cette période dramatique, connaissait les vives blessures que la Guerre d’Algérie avaient laissées dans la société française. Il savait qu’il avait recueilli les suffrages d’un bon nombre de ceux qui n’arrivaient pas à pardonner au Général de GAULLE d’avoir abandonné l’Algérie. Il savait aussi que pour sanctionner sa politique de rigueur, vécue comme une trahison, ces électeurs particuliers risquaient de se tourner vers la droite.
Il fallait absolument offrir à ces électeurs en partance pour l’opposition une alternative.
Le 4 septembre 1983 eut lieu à Dreux une élection municipale partielle qui allait marquer un tournant historique de la politique française. En effet, ce jour là, pour la première fois de ses 11 ans d’existence, le Front national obtint un score remarquable, et remarqué. Alors que jusqu’à cette date il ne représentait pratiquement rien, 0,75 % à l’élection présidentielle de 1974, 1,31 % en 1979, à la première élection européenne, Jean-Pierre STIRBOIS qui conduisait la liste Front national réussit à obtenir 16,7 % des suffrages exprimés au premier tour.
François MITTERRAND comprit immédiatement le sens du message envoyé par les électeurs de Dreux, il comprit surtout le profit que le parti socialiste et lui pouvait en tirer.
Le tournant de la rigueur avait poussé de nombreux électeurs à ne plus voter pour la majorité présidentielle. Le Front national venait de démontrer qu’il pouvait séduire ces électeurs. Pendant que la plupart des observateurs politiques condamnaient le vote pour le Front national, car il constituait à leurs yeux une honte et un danger pour la démocratie, François MITTERRAND, lui, tout en condamnant publiquement ce vote, concevait promptement la meilleure façon de l’instrumentaliser.
On peut aujourd’hui reconstituer en quelques dates la manœuvre mise en place par François MITTERRAND pour affaiblir durablement la droite.
13 février 1984 : invitation de Jean-Marie LE PEN à l’émission L’heure de vérité sur TF1, sur proposition pressante de l’Élysée.
Mai 1984 : la liste présentée par le Front national aux élections européennes franchit pour la première fois la barre des 10% au niveau national. Alors que le FN n’avait obtenu que 1,31 % en 1979, en 1984 il obtient 10, 95 % des suffrages exprimés.
15 octobre 1984 : création de SOS racisme sous le bienveillant parrainage du parti socialiste et de l’Élysée. Le Front national accusé d’être, « xénophobe, raciste et antisémite », est déclaré au plus haut niveau de l’État ennemi public numéro 1.
Les 35 députés FN qui siègent à l’assemblée nationale de 1986 à 1988 permettent au Front national de s’installer solidement et durablement dans le paysage politique français.
Lors des élections législatives de 1988, qui se déroulent en juin, à nouveau selon le mode uninominal à deux tours, le FN n’a plus aucun élu, mais il réunit encore 9,66 % des suffrages au premier tour.
2 9 De la France tranquillement socialiste à la France Unie
En 1981, François MITTERRAND proposait aux électeurs une France socialiste (France socialiste puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant). En 1988, il leur proposait une France unie et fraternelle, où les étrangers seraient « chez eux chez nous » (1986), répondant ainsi à des valeurs quasi évangéliques.
En 1988, la rupture avec les communistes n’étaient pas formellement consommées électoralement, mais désormais, les socialistes ne tournaient plus du tout leurs regards vers l’Est, ils n’avaient désormais d’yeux que pour Bruxelles.
Pour François MITTERRAND et les socialistes il est dès lors devenu évident que l’Europe était aussi leur seule planche de salut politique.
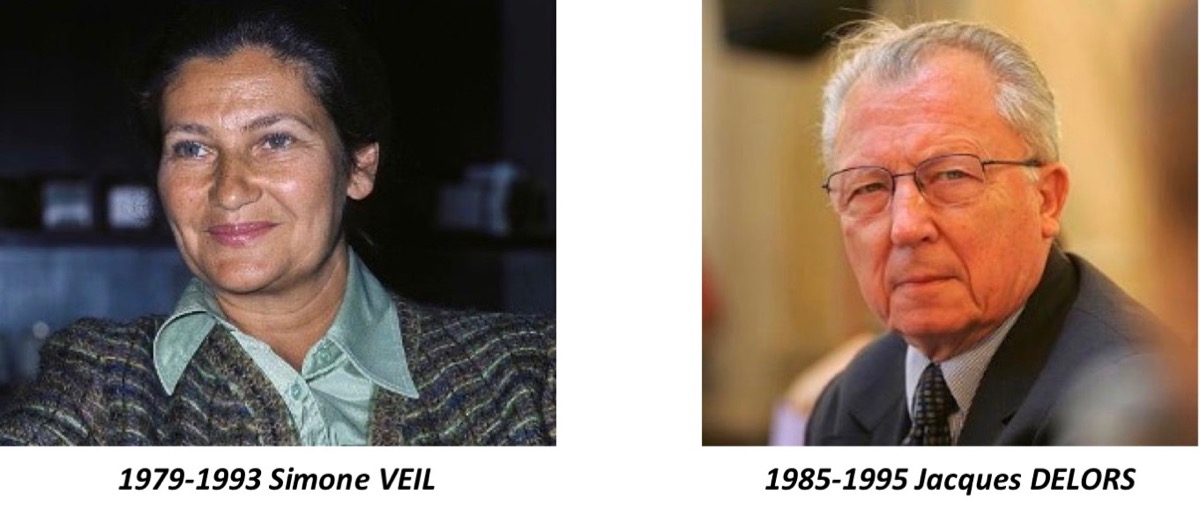
2 10 « La France est notre patrie, l’Europe est notre avenir » (mai 1989)

On peut s’en étonner 30 ans après, mais, au moment où elle fut prononcée, cette phrase ne provoqua pas de grande inquiétude, même parmi les électeurs qui étaient les plus attachés à l’indépendance nationale.
Les élargissements faisant passer l’Europe de 6 à 12 membres ne se sont pas faits sans craintes, mais ils se sont tous faits sans problèmes majeurs, à la satisfaction rapide du plus grand nombre.
En France et en Allemagne, les électeurs les plus anciens pouvaient aussi se rassurer, en ne voyant dans la politique nouvelle que la suite logique de la politique européenne initiée par Charles de GAULLE et Konrad ADENAUER, signataires en janvier 1963 du Traité de l’Élysée.
Mais en s’agrandissant, la Communauté économique européenne n’avait pas seulement changé de taille, elle avait changé de nature et surtout d’ambition.
Dés décembre 1978, date à laquelle la Chine a décrété vouloir passer à une « économie socialiste de marché », les Chinois ont vu l’arrivée de commerçants du monde entier.
Comment les marchands auraient-ils pu résister à l’aventure qu’offrait alors le plus grand marché potentiel du monde? Les Occidentaux en général, et les Européens en particulier ont été les premiers à partir à la conquête du marché chinois., sans aucune réserve, ni morale, ni économique, ni politique.
Bien avant que Pascal LAMY théorise tous les bienfaits et les vertus du Commerce international, la plupart des responsables politiques et économiques européens s’étaient rangés à l’idée que la mondialisation n’était plus un choix problématique, mais qu’elle était un point de passage devenu obligé, et une opportunité à saisir.
Progressivement, les Européens s’étaient laissés convaincre, avant la chute du Mur de Berlin, que seule l’ouverture au monde pouvait permettre de régler les récurrents problèmes économiques et sociaux, que presque tous les pays d’Europe avaient en commun.
Les élites européennes favorables à la mondialisation attendaient ainsi avec impatience l’ouverture de vastes marchés, en rêvant d’un marché intérieur européen aussi grand que possible.
En juin 1993 à Copenhague, le Conseil européen réunissant les Chefs d’État ou de gouvernement avait anticipé la création de l’Union européenne en définissant à l’avance les critères auxquels tout pays candidat à l’adhésion devait satisfaire.
o0o
2 11 L’heure tant attendue des élargissements était enfin revenue
La rapidité de l’examen des dossiers de demandes d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, s’explique bien entendu par la particularité des pays demandeurs. Les 3 États qui frappaient à la porte de l’Union européenne avaient des liens économiques si anciens avec certains des pays membres, que leur adhésion n’était en rien problématique,
À ce jour, les adhérents de 1995 sont les derniers à avoir rejoint l’UE comme États contributeurs nets.
Depuis 1981, le club Europe est devenu particulièrement attractif, c’est en effet le seul club, qui non seulement ne fait pas payer tous les nouveaux membres, mais qui finance ceux qui ne peuvent pas payer pour qu’ils puissent le devenir. Il n’est donc pas étonnant que les candidatures d’adhésion aient été si nombreuses, et le restent.
Un mystère demeure : comment se fait-il que la Suisse, la Norvège et l’Islande se refusent toujours à faire partie du Club Europe ? Sont-ils trop riches pour accepter de partager, ou sont-ils si attachés à leur souveraineté, « petite souveraineté » que les Européens jugent sévèrement dérisoire et illusoire?
Par contre, dans le cas des élargissements ultérieurs qui concernaient des pays qui avaient tous vécu pendant plus de 40 ans dans une économie dirigée, à l’exception de Chypre et de Malte, personne ne pouvait prédire la tournure que prendraient les changements économiques et politiques imposés par l’Union européenne.
On tend à oublier avec le temps que, le cinquième élargissement, effectué en 2004, fut l’objet des tractations parmi les plus longues et les plus délicates de l’histoire de la construction de l’Union européenne.
Ce fut le premier élargissement jugé à haut risque, même parmi les plus ambitieux et les plus entreprenants des responsables européens.
Un an après, tout se passant pour le mieux, à la satisfaction de tous les anciens membres, et à la satisfaction plus grande encore de tous les nouveaux membres, rien ne semblait plus pouvoir s’opposer à de nouveaux élargissements.
Le 3 octobre 2005, alors que le sixième élargissement à la Bulgarie et à la Roumanie était annoncé pour 2007, l’Union européenne annonça qu’elle ouvrait officiellement le dossier d’adhésion de la Croatie et de la Turquie.

L’annonce en effet en fut faite moins de 6 mois après que les électeurs de deux des six pays fondateurs de la CEE ont rejeté le traité de constitution européenne, en France le 29 mai 2005, et aux Pays-Bas le 1er juin 2005.
Les électeurs qui ont voté NON peuvent difficilement oublier.
o0o

N°250 [3] Turquie : pourquoi un soudain empressement pour son adhésion à l’UE ?
Le vendredi 24 juillet, le président Recep Tayyip ERDOGAN a participé à la première prière organisée dans l’ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion en mosquée.
Temps de lecture 35 minutes
Considérant que le pari était gagné, dés le 1er mai 2004, la plupart des responsables européens rêvèrent de nouveaux élargissements.
La plupart des dirigeants n’avaient toujours pas su, ou voulu, tirer les conséquences du contre-exemple chinois. Vingt ans après la tuerie de la place Tienanmen, la démocratie se faisait toujours attendre en Chine, mais les mondialistes occidentaux restaient persuadés qu’elle finirait par triompher .

Pékin, place Tiennanmen, avril 1986
Pour chaque pays candidat, l’UE met en place un partenariat pour l’adhésion. Celui relatif à la Turquie a été adopté dès 2001.
3 1 Un élargissement instrumentalisé des deux cotés
Il comprit tout de suite qu’en 2004, l’adhésion de son pays présentait pour de nombreux Européens deux intérêts :
un évident intérêt économique, la Turquie représentant un marché en forte expansion, de 80 millions de consommateurs potentiels.
un intérêt politique et culturel, la Turquie étant, encore dans ces années là, un pays musulman fortement sécularisé par plus 70 ans de kémalisme.
En quoi ce deuxième point présentait-il un intérêt important pour les Européens, à ce moment de la construction européenne ?
Pour comprendre, il faut se replonger une quinzaine d’années en arrière, et se rappeler les débats politiques et culturels qui agitaient les esprits, un an avant la mort du pape Jean-Paul II, et un an avant la ratification du traité de constitution européenne par les États.
En 1992, la ratification du traité de Maastricht, avait été difficile, notamment en France où le référendum avait donné lieu à une âpre bataille électorale. Dans l’Union européenne élargie à 25 États, de nombreux dirigeants craignaient que dans leur pays, la ratification du traité de constitution soit encore plus délicate.
- difficulté de faire fonctionner une Europe à 25 avec les mêmes règles que pour une Europe à 15 ;
- volonté de réunir dans un texte unique les différents traités qui se sont succédé au fil des ans,
Créée à l’issue du Conseil européen de Laeken en décembre 2001, la Convention sur l’avenir de l’Europe, ou Convention européenne, fut chargée de rédiger un projet de Constitution européenne,
La rédaction du texte de cette constitution fut laborieuse. Elle ne prit fin que le 24 octobre 2004. Elle fut aussi mouvementée. Un point fit longuement débat, celui concernant la référence aux valeurs chrétiennes et la laïcité.
Fallait-il rappeler les racines chrétiennes du continent européen ?
L’Europe pouvait-elle se contenter d’être une grande zone de libre échange, une Europe marchande, ou devait-elle aussi avoir une âme forgée par l’Histoire?
Dès son élection en 1978, et jusqu’à sa mort en 2005, le pape Jean-Paul II n’eut de cesse d’alerter les Européens sur l’importance qu’ils devaient accorder à leurs racines culturelles et religieuses. L’arrivée à Strasbourg en 2004 de députés de Pologne, de Slovaquie et de Hongrie, donna aux propos du pape un écho particulier.
Les Européens qui voyaient avant tout dans l’adhésion de la Turquie à l’UE un très grand intérêt économique, tenaient à toutes forces à évacuer ces questions, car ils pensaient qu’elles n’avaient pour but que de pouvoir fermer la porte au nez de la Turquie..
À Bruxelles et à Strasbourg, la candidature de la Turquie devint de plus en plus souhaitée et soutenue, bien sûr en raison des excellents résultats économiques que la Turquie put très rapidement afficher, mais aussi pour des raisons de politique intérieure dans les pays européens où les musulmans étaient de plus en plus nombreux.
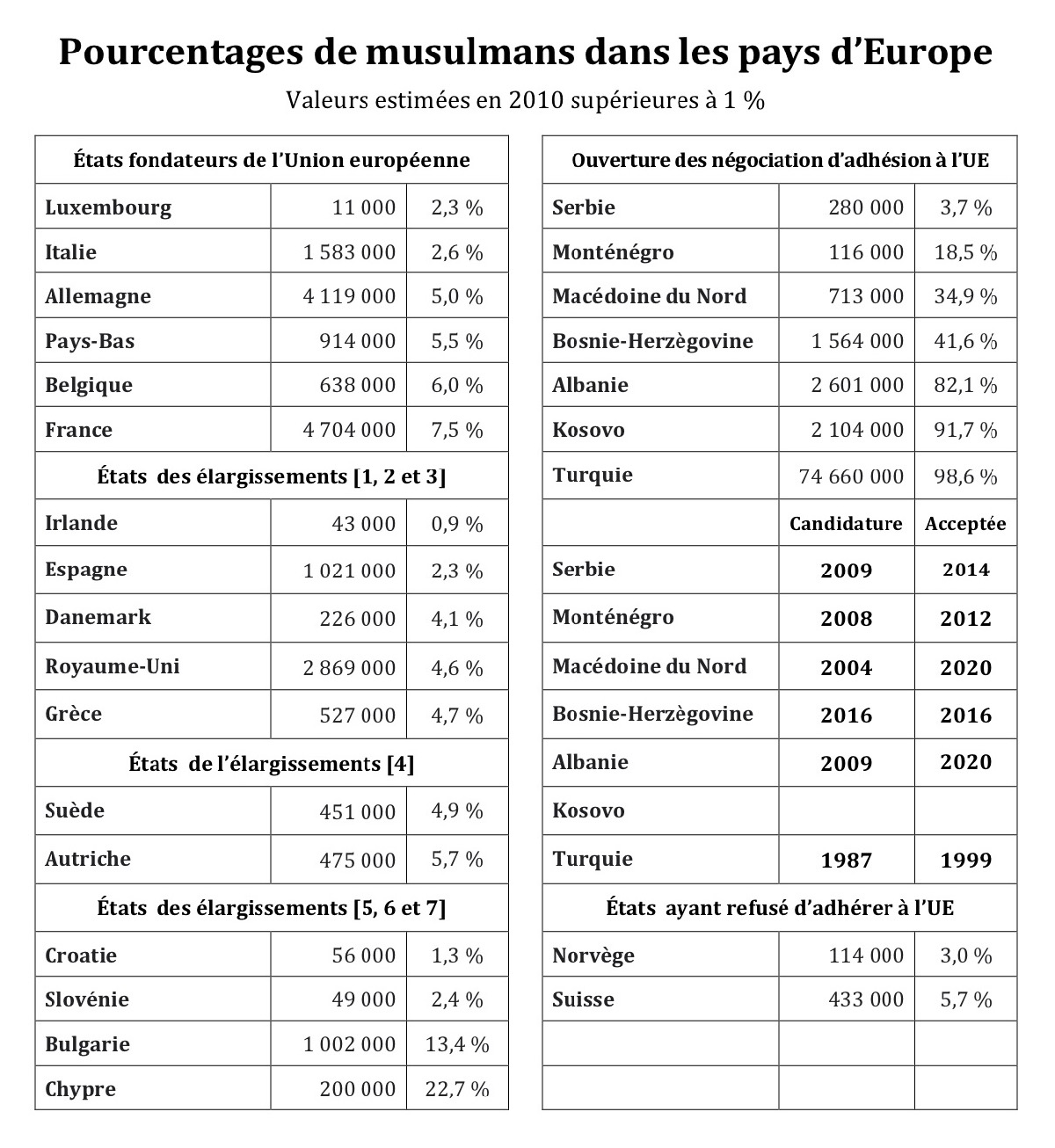
Les pourcentages d’appartenance religieuse qui sont publiés ne sont donc que les valeurs estimées par les sociologues, et en ce qui concerne les musulmans, par les démographes qui font leurs estimations à partir de l’origine géographiques des ascendants des personnes recensées. Ces valeurs sont donc hautement sujettes à caution. Elles ont surtout le grave défaut d’assigner, à vie, un individu à la religion de sa parentèle.
Aucun dirigeant politique ne sait précisément le nombre correspondant à la population d’origine musulmane de son pays, mais tous connaissent son évolution.
De 1978 à l’an 2000, le nombre de musulmans a considérablement et rapidement augmenté, non sans de grandes difficultés et parfois de graves problèmes, dans la plupart des pays de l’Europe occidentale, en France en particulier.
Tous les responsables politiques à Paris, à Bruxelles et à Ankara savaient pertinemment cela lorsque les négociations d’adhésion de la Turquie ont repris avec la volonté d’aboutir, du coté de l’Union européenne au moins.
3 2 Turquie: LA solution des problèmes des Européens avec l’islam ?
Face aux flux de migrants, mal contrôlés et mal préparés, les autorités ont vite été dans l’incapacité d‘accueillir, d’intégrer, et encore moins d’assimiler les nouveaux arrivants, dans de bonnes conditions. Accusés de conduire des politiques discriminatoires, voire racistes, conscients de leur impuissance grandissante, les gouvernements désemparés, ont vite prêté une oreille attentive au discours de ceux qui plaidaient pour l’adhésion de la Turquie, autant pour des raisons économiques, que pour des raisons culturelles et religieuses.
Pour les partisans de l’adhésion de la Turquie, ce rappel était précisément ce qu’il fallait éviter, pour qu’en aucun cas, les musulmans d’Europe ne puissent se sentir exclus du projet européen.
3 3 L’islam turc : un islam de rêve pour l’UE, mais un islam rêvé ?
Peine perdue, non seulement les extrémistes ne se repentent que rarement de leurs erreurs passées, mais de façon cocasse ils s’en font une sorte de gloriole pour mieux s’engager dans les erreurs futures.
Les Turcs étaient instrumentalisés, diabolisés par ceux qui étaient contre leur adhésion, parce qu’ils étaient musulmans, et idéalisés par ceux qui étaient pour leur adhésion, parce qu’ils étaient musulmans.
Les partisans et les opposants à l’adhésion, prenaient ainsi position pour de fausses bonnes raisons ayant peu à voir, ni avec l’intérêt bien compris de l’Union européenne, ni avec celui de la Turquie.
Contrairement à la plupart des experts européens, èsTurquie, il connaissait bien l’histoire de son pays et celle de l’Empire ottoman. Il avait parfaitement senti que, a contrario des Européens qui se voulaient sans racines, les Turcs restaient très attachés aux leurs, et qu’ils n’avaient rien oublié de leur culture et de leur splendeur ottomanes.
Depuis qu’il avait réussi à se faire élire maire d’Istanbul (1994-1998), il avait compris comment il pouvait arriver à faire avancer ses idées dans le cadre démocratique turc. Mais Il était bien conscient que l’État profond turc (kémaliste) qui était par nature opposé à ses idées politiques, ferait tout pour faire obstacle à leur mise en œuvre.
Recep Tayyip ERDOGAN savait que tous les islamo-conservateurs, qui, avant lui, avaient essayé de s’affranchir de la tutelle kémaliste, avaient été déposés, ou renversés, par l’armée turque, gardienne de la tombe et de la pensée du père de la nation, Mustafa Kemal ATATÜRK.
3 4 En Turquie depuis 2002, l’AKP et Recep Tayyip ERDOGAN au pouvoir
Pour arriver à devenir Premier ministre le 14 mars 2003, et pour arriver à rester au pouvoir depuis, Recep Tayyip ERDOGAN a su faire preuve d’une exceptionnelle intelligence politique et tactique. Mais Il a surtout pu bénéficier pour son ascension de l’appui de nombreux réseaux, dont le plus important fut le réseau du Mouvement GÜLEN.

Réseau GÜLEN: une impressionnante machine d’influence encore puissante en 2017
En 2002, les deux hommes avaient tout pour s’entendre. Ils avaient un intérêt politique personnel commun, une conviction religieuse aussi affirmée, et la même volonté de mettre fin à l’État profond kémaliste.
Leur collaboration fit immédiatement des miracles économiques, de 2003 à 2011 le PIB par habitant a doublé.
Le mouvement GÜLEN se distinguait par son rapport décomplexé avec l’argent et le capital, à l’inverse d’autres mouvements religieux islamiques. Dès 1980, la libéralisation de l’économie turque avait permis au Mouvement de développer un grand réseau d’établissements scolaires et de pénétrer les médias.
o0o
3 5 Pour en finir avec le kémalisme, l’UE appelée en renfort
En 2002, l’accession de l’AKP au pouvoir eut pour conséquence de faire cesser ces purges et de permettre l’avancement des officiers liés au GÜLEN. Durant des années, les concours d’entrée aux écoles militaires ont été truqués, les membres du mouvement ayant connaissance des sujets à l’avance. L’AKP fit aussi massivement appel à des cadres gülénistes pour remplacer les fonctionnaires kémalistes dans des secteurs tels que la police ou la justice.
Ils savaient que la constitution de 1982 faisait peser sur leur avenir politique, voire sur leurs têtes, une terrible menace. Les Turcs considérant toujours majoritairement que : “Les forces armées turques sont les gardiennes de la République turque.”
N’ayant pu réformer la constitution par voie parlementaire, au moment où le contexte électoral leur avait été exceptionnellement favorable, ils ne pouvaient espérer le faire que par voie référendaire.
En 2004, aucun dirigeant politique turc responsable ne pouvait encore se risquer à demander aux électeurs s’ils étaient favorables à une réforme de la constitution, prévoyant de retirer aux forces armées de la Turquie les prérogatives que le père de la nation, le fondateur de la République, leur avait accordées.
Oser poser la question, c’était s’afficher ouvertement comme un opposant à la République de Turquie, laïque et sociale, fidèle à l’esprit nationaliste hérité d’ATATÜRK.
En raison de son passé politique semé d’embûches, Recep Tayyip ERDOGAN était bien placé pour savoir qu’il ne pouvait pas proposer une révision de la constitution à titre personnel, mais en 2004 il avait trouvé qui pourrait poser la question à sa place.
![2020.09.11 Erdogan Prodi Bruxelles [2004.09.23] 959 - 1](https://www.association-iceo.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020.09.11-Erdogan-Prodi-Bruxelles-2004.09.23-959-1.jpg)
Preuve en fut, la très bienveillante attention dont la Turquie a pu bénéficier de 1999 à 2014, de la part de la Commission.
o0o
3 6 Les Européens ne savent plus si Recep Tayyip ERDOGAN veut que la Turquie adhère à l’UE, en 2004 il a tout fait pour qu’ils le croient.
Ils ne veulent surtout pas qu’on leur rappelle les arguments péremptoires qu’ils assénaient à tous ceux qui avaient l’audace d’essayer de calmer leur ardeur, et/ou d’oser les mettre en garde.
Les plus lucides admettaient que les mises en garde n’étaient pas toutes infondées, notamment en matière de droit de l’Homme et d’État de droit, mais ils étaient convaincus que l’adhésion, loin d’être un problème était LA solution. Ils restaient convaincus que le désir d’Union européenne aboutirait une nouvelle fois à faire un miracle.
Loin d’être échaudés par la tournure que prenaient les négociations, les plus chauds partisans de l’adhésion de la Turquie ont redoublé d’ardeur pour facilité la reprise au plus vite des négociations.
Sachant avoir un fan-club européen aussi inconditionnel, le Premier ministre turc n’eut aucune difficulté à faire accroire sa vision faussée de la situation politique en Turquie, à plaider sa bonne foi et sa bonne volonté.
On pourrait être tenté d’accuser les nombreux journalistes, qui se sont montrés alors incapables de démasquer l’évidente duplicité des dirigeants turcs, d’avoir fait preuve de grave complaisance . Ce serait malheureusement les accuser à tort.
Certes ces journalistes ont été très souvent aveuglés par les a priori favorables qu’ils avaient pour l’élargissement de l’Union européenne à la Turquie, mais ils ne cherchaient pas à être complaisants, ils étaient simplement avant tout ignorants.
Le Premier ministre turc n’avait pas besoin de forcer son talent pour abuser les Européens, ils s’abusaient tous seuls. Leur méconnaissance de l’histoire de la Turquie et de la société turque était telle qu’ils étaient incapables de comprendre que les réformes, qu’ils croyaient imposer aux islamo-conservateurs qui dirigeaient le pays, étaient précisément celles dont ils rêvaient, pour pouvoir asseoir leur pouvoir politique, et surtout pour arriver à réinstaller l’islam au cœur de la société turque.
Dans l’Union européenne et en Turquie, pour convaincre leurs concitoyens qui restaient rétifs, les partisans de l’adhésion avaient construit de conserve l’image d’une Turquie en route vers la démocratie, vers la tolérance et la liberté religieuse.
Depuis 1998, Recep Tayyip ERDOGAN avait tout fait pour faire oublier les propos qui lui avaient valu des ennuis avec l’armée et la justice. Il avait tout fait pour faire accroire qu’il avait changé. Il ne pouvait, ni ne voulait, renier publiquement ses convictions religieuses maintes fois affichées, mais il s’efforçait de se présenter comme un musulman désormais ouvert et non violent.
Depuis qu’ils avaient fait alliance au début des années 2000, les deux compères s’étaient parfaitement partagé le travail, pour arriver à leurs fins : à ERDOGAN d’attirer, en autres, les électeurs islamo-conservateurs les plus exigeants, à GÜLEN de rassurer et mobiliser l’électorat musulman modéré, et europhile pour des raisons essentiellement économiques.
Malgré les mises en garde des rares journalistes qui avaient connu ERDOGAN maire d’Istanbul, et qui pour cette raison n’avaient jamais été dupes des mensonges et des manœuvres du Premier ministre turc, la grande majorité des correspondants de presse européens en Turquie continuaient à donner à leurs lecteurs et leurs auditeurs une analyse de la situation politique turque, simplifiée, souvent simpliste, et surtout erronée.
o0o
3 7 Une grille de lecture simpliste et fausse, voire mensongère
D’où leur volonté depuis cette date de diriger et communiquer selon des schémas simplifiés.
La négociation avec la Turquie pour sa possible adhésion à l’Union européenne, n’échappa pas à cette nouvelle ligne de conduite. Pour « éclairer » les électeurs européens qui connaissaient encore moins la Turquie que les pays baltes, mais qui étaient bien plus réservés sur son éventuelle adhésion, les dirigeants européens, et leurs plus fidèles journalistes, leur ont expliqué la situation démocratique complexe du pays à l’aide d’images simples transposées.
C’est ainsi que le parti islamo-conservateur AKP, façonné par le salafisme à la mode turque, a été présenté comme le frère jumeau du parti démocrate chrétien italien, aussi peu dangereux que lui pour la démocratie. Personne n’a eu la perfidie d’ajouter explicitement, sous réserve d’oublier les liens des démocrates chrétiens italiens avec la mafia, mais tous le pensaient évidemment.
À ceux qui craignaient que l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne ne provoque une nouvelle guerre de religion on ne manquait pas de rappeler le dialogue interreligieux apaisé que GÜLEN cherchait à bâtir depuis des années avec le pape.

Février 1998, Fethullah GÜLHEN reçu au Vatican par le pape Jean-Paul II
Pour faire bonne mesure, dès leur arrivée au pouvoir les deux compères avait tout fait pour donner des gages tangibles au Vatican et à l’orthodoxie.
En Turquie, il n’y a plus de religion d’État, chacun est libre de ses croyances, mais il n’y a pas de séparation entre la religion et l’État, il y a même une mise sous tutelle de la religion par l’État, notamment le culte musulman sunnite, la religion historiquement majoritaire (65 %), dont les imams sont des fonctionnaires.
Dans l’Empire ottoman en 1900, un habitant sur quatre était chrétien. C’est pourquoi au cours des siècles, toutes les religions de l’Empire, même celles qui étaient lourdement discriminées, avaient accumulé, notamment dans la capitale de l’Empire, d’importants patrimoines immobiliers.
Le passage de l’alphabet turc ottoman à l’alphabet latin en 1928, et la confiscation de nombre de leurs biens à la suite du recensement de 1934, avaient fait perdre aux communautés non musulmanes la reconnaissance d’une grande partie de leurs titres de propriétés, et conséquemment de leurs revenus locatifs.
Connaissant bien cette situation, en tant qu’ancien maire d‘Istanbul, ERDOGAN fit savoir que, bien que les catholiques latins ne bénéficiaient pas du statut de minorités reconnues par le gouvernement turc, selon les termes du Traité de Lausanne, certaines congrégations religieuses rattachées à Rome pourraient bénéficier de la reconnaissance de tous leurs droits.
Ces mesures essentiellement symboliques avaient pour but principal de désarmer les opposants à l’adhésion de la Turquie, c’est pourquoi les partisans de l’adhésion les ont abondamment et largement fait connaître, en donnant un satisfecit au gouvernement turc, qui avait fait la preuve formelle de son respect de la liberté religieuse, pour les non-musulmans.
o0o
3 8 Imposé sans discernement, le principe « un homme une voix », mène plus souvent à la guerre civile qu’à la démocratie et la paix.
En Turquie il a fallu tout le prestige et la force de coercition de la toute nouvelle armée turque pour que Mustafa Kemal ATATÜRK puisse prendre le contrôle des mosquées et puisse faire voter une constitution instaurant un principe de laïcité.
Les Français savent que depuis 1905 la voie vers la laïcité n’a pas été un long fleuve tranquille. Quelques jours avant sa mort, l’ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis DEBRÉ rappelait avec toute la force de ses convictions : « Il ne faut jamais oublier que le combat pour la laïcité est un combat permanent« .
Durant près d’un siècle, les Turcs kémalistes ont su comment mener ce combat et comment le gagner. Ce qu’ils ne savaient pas, ce qu’ils ne pouvaient imaginer, c’est que ce serait l’Union européenne qui les conduirait à connaître leur première défaite.
Les responsables de l’Union européenne ont un vrai problème avec le suffrage universel. En Europe, ils en font peu de cas lorsqu’il s’oppose à leurs décisions. En dehors de l’Europe, ils lui attribuent beaucoup d’importance. Du moins c’est ce qu’ils prétendent. Bien sûr il y a des pays avec lesquels ils ne peuvent, ni ne veulent, se montrer trop regardant, notamment comme la Chine ou l’Arabie saoudite. Mais en dehors des pays qu’ils n’espèrent pas changer, commerce oblige, tous les autres ont droit à leur sermon démocratique, la Russie bénéficiant d’une attention particulière, et singulière.
Depuis des dizaines d’années, les Occidentaux, les Européens en premiers, prétendent exporter et imposer au monde entier leur modèle démocratique, modèle dont les origines remontent à plusieurs siècles en Angleterre.
Les Britanniques garde une grande confiance dans le système démocratique qu’ils ont inventé, voir tout récemment encore avec le Brexit, car au cours de leur histoire ils ont pu en vérifier la pertinence et la fiabilité.
Lorsque Winston CHURCHILL a déclaré en 1947 à la Chambre des communes «La démocratie est le pire des systèmes, à l’exclusion de tous les autres.», il voulait dire : « La démocratie britannique est, pour les Britanniques, le pire des systèmes, à l’exclusion de tous les autres.». Car il avait appris au cours de son long passé colonial que le modèle démocratique britannique n’avait pas vocation à devenir universel.
Chaque État a une Histoire, une géographie et une démographie singulières, il est donc impossible d’imaginer que tous les peuples de la planète puissent, et/ou veuillent, adopter les mêmes règles de gouvernance, puissent, et/ou veuillent, répondre aux mêmes exigences en matière de démocratie.
Malgré tous les drames que cela a provoqué, les Occidentaux n’ont toujours pas compris que le suffrage universel ne pouvait pas être imposé, adopté, s’il n’était pas adapté.
Le suffrage universel, selon le principe “un homme une voix”, mène plus souvent à la guerre civile qu’à la démocratie et la paix, lorsqu’il est importé et imposé sans discernement dans des États où cohabitent difficilement des populations qui vivent encore sur un mode tribal.
3 9 Le port du voile est le marqueur essentiel de l’islamisme triomphant
En 2005, lorsque les négociations d’adhésion ont commencé avec la Turquie, les situations politiques et militaires afghanes et irakiennes n’étaient pas encore désespérées. D’autre part, le gouvernement turc tenait à l’époque à afficher vis à vis des Kurdes un grand et nouvel esprit de tolérance. Les Européens ont donc ainsi pu croire à sa sincérité et à sa bonne volonté.
Persuadés que les dirigeants turcs partageaient leur souhait de faire aboutir les négociations, les plénipotentiaires de l’Union européenne ont tout fait pour les aider à lever les obstacles dont ils leur présentaient l’existence.
Il faut ici saluer l’habileté du Premier ministre turc qui a réussi à convaincre les Européens que le principal frein à l’adhésion de la Turquie était l’État profond kémaliste.
Pour tous ceux qui connaissaient bien la situation en Turquie et son histoire, la manœuvre de Recep Tayyip ERDOGAN était grossière et évidente.
Malheureusement, les négociateurs de l’Union européenne se sont laissés circonvenir par le Premier ministre turc, soit par naïveté, soit en raison de leur inculture, notamment leur abyssale inculture religieuse. Ils ont accueilli les doléances turques avec bienveillance, non par complaisance, mais parce qu’ils pensaient qu’elles étaient légitimement recevables.
À l’exception de la France, où la laïcité a été accouchée au forceps en 1905, dans presque tous les pays de l’Union européenne, le droit au port d’un voile pour une femme musulmane est considéré comme un droit essentiel, lié à la liberté religieuse.
Il n’est donc pas étonnant que les Européens aient laissé faire, voire soutenu, Recep Tayyip ERDOGAN dans son combat contre l’interdiction du voile dans les universités turques.
Il faut remarquer en revanche le remarquable travail d’analyse effectué par Alexandre DEL VALLE, qui a été un des rares spécialistes a faire preuve d’une grande lucidité : La Turquie dans l’UE : « rempart contre l’islamisme » ou mort programmée du système kémaliste laïque ?
Le vêtement, est un marqueur identitaire essentiel, il a de tout temps été instrumentalisé comme signe d’appartenance à un groupe ou signe d’adhésion et/ou de soumission à une idéologie.
Le vêtement imposé est le moyen le plus simple permettant le contrôle des masses. Tous les totalitarismes ont eu recours à ce mode d’embrigadement. Les salafistes n’ont rien inventé. Ils utilisent simplement une méthode ancestrale connue comme étant l’un des outils de prosélytisme les plus efficaces.
N° 125 Mustafa KEMAL ATATÜRK : interdiction du voile dans l’espace public.
N° 124 Égypte 1953 : quand NASSER se moquait du voile… C’était il y a plus de cinquante ans.
N° 126 En 1966, Habib BOURGUIBA invite les Tunisiennes à ôter leur voile.
Il est affligeant que si peu d’universitaires français aient compris et soutenu le combat que les universitaires turcs ont mené jusqu’au bout pour essayer de maintenir l’interdiction du port du voile dans les universités.
Comment le gaucho-islamisme a-t-il pu contaminer les cerveaux au point qu’un signe explicite d’asservissement puisse être désormais perçu comme licite par les partisans du droit à la différence tout comme par les défenseurs de la libération de la femme ?
Comment pouvait-on imaginer que ceux ayant eu, ou ceux qui avaient toujours, pour maître à penser TROTSKI allaient faire de la liberté religieuse une de leurs principales préoccupations?
La réponse à ces deux questions est tristement simple, si la gauche révolutionnaire se monstre soudain si soucieuse de la liberté religieuse, pour les musulmans, c’est parce que, son électorat traditionnel l’ayant abandonnée, les musulmans les plus intégristes représentent sa dernière réserve potentielle de voix.
Peu leur chaut que cela fasse le jeu des salafistes. Pour eux : leur révolution vaut bien une prière du vendredi.
o0o
3 10 Singulier, le système électoral turc, grand incompris des Européens
Le parlement monocamériste est ainsi le seul détenteur du pouvoir législatif. Mais pour garantir les principes fondateurs de la république laïque turque, définis par Mustapha Kemal ATATÜRK, le parlement a légifèré depuis 1924 sous la surveillance de la Cour constitutionnelle, et de son bras armé, au sens littéral, l’armée turque, reconnue comme garante ultime de la constitution, et donc de la laïcité.
Bien sûr le rôle singulier dévolu à l’armée dans le système parlementaire turc est resté inacceptable en Europe pour tous les théoriciens du droit constitutionnel qui méconnaissaient, ou qui voulaient méconnaître, les raisons de cette singularité.
La Turquie [780 000 km2] est née sur les ruines de l’Empire ottoman, alors qu’à la veille de son effondrement il avait encore une superficie 3 400 000 km2, après avoir eu à son optimum, en 1683, une superficie de 5 200 000 km2.
L’Empire Ottoman comptait plus de 35 millions d’habitants en 1858. Le recensement de 1927 a évalué la population de la Turquie à 13 millions d’habitants.
Le kémalisme et l’armée turque n’ont pas nuit au développement économique et scientifique de ce pays musulman, bien au contraire. L’armée turque n’a pas cherché à garder le pouvoir pour elle, mais elle l’a toujours remis à des civils, sous réserve que ceux-ci ne veuillent pas le confisquer.
Certes la Turquie est loin d’avoir été, et d’être aujourd’hui, une démocratie parfaite, mais comparée à tous ses voisins au Moyen-Orient, elle reste le pays où la démocratie a été, et est encore le moins bafouée. Le parti au pouvoir depuis 2002, l’AKP, peut difficilement affirmer le contraire, malgré les jérémiades répétées du Premier ministre auprès de l‘Union européenne.

Lors des 22e élections législatives l’AKP avait signé une première victoire en obtenant pour 34,3 % des suffrages, 363 sièges, soit 66 % des élus. Le CHP avait obtenu avec 19,4 % des suffrages, 178 sièges, soit 32 % des élus. Il faut ajouter 11 sièges attribuer à des élus sans étiquette.
Il est très important de noter que tous les autres partis (plus de 6) ayant recueilli tous ensemble plus de 46 % des suffrages n’avaient eu droit à aucun siège. Car, pour qu’un parti soit représenté au parlement, il doit présenter un candidat dans au moins la moitié des provinces de la Turquie, il doit par ailleurs obtenir un minimum de 10 % des voix au niveau national. Cette disposition a pour but d’écarter de la représentation national les mouvances séparatistes.
Ceci explique surtout pourquoi, et comment, l’AKP a pu arriver au pouvoir un an après sa création, et a réussi à le garder plus de 15 ans, bien qu’il soit resté longtemps minoritaire en voix, et deux fois en sièges.
En consultant la liste des législatures turques, on constate que les règles électorales appliquées en Turquie, conduisent à des résultats qui sont paradoxaux pour des électeurs européens peu au fait de la politique turque.


En 2002, seuls deux partis ont recueilli plus de 10 % de voix, et ils n’avaient obtenu à eux deux que 44 % des suffrages exprimés.
Ce qui explique que dès sa première participation sous son nom, l’AKP qui avait recueilli un tiers des voix, ait obtenu près des deux tiers des sièges. Notons que 4 des cinq partis qui avaient obtenu des sièges en 1999 [ DSP (136), MHP(129), FP (111), ANAP (86) et DYP (85)] n’étaient plus du tout représentés en 2002, [ AKP (363) et CHP (178) DSP (0), MHP(0), FP (remplacé par CHP), ANAP (0) et DYP (0)] .
Noter que Le Parti démocratique des peuples HDP n’apparaitra sur la scène politique turque qu’en 2012.
o0o
3 11 En 2002, les Européens incapables d’analyser la victoire de l’AKP
L’exceptionnelle prouesse réalisée par l’AKP à l’occasion de la 22e législature, n’a été rendue possible que par la sidérante indigence politique et tactique des partis traditionnels, qui se sont succédé au gouvernement pendant de longues années. Incapables de répondre à l’attente de leurs électeurs,
Malgré leurs échecs récurrents, ils avaient eu l’inconscience de croire qu’un parti religieux ne pourraient jamais accédé au pouvoir, ou que s’il y accédait , il n’aurait jamais la possibilité de changer l’ordre des choses en Turquie.
Le soir des élections législatives, malgré leur humiliante et cuisante défaite, Ils ont continué à penser que la constitution, l’État profond et l’armée turque, restaient et resteraient l’ultime garantie de leur survie politique. Ils étaient persuadés que leur départ de la Grande assemblée de la Turquie ne serait pas un départ sans retour. Pour finir de se rassurer ils se rappelaient, dans la longue liste des Premiers ministres de Turquie, tous ceux qui avaient été sommés de se soumettre ou de se démettre, et de tous ceux qui n’ayant pas voulu obtempérer ont été débarqués manu militari.
C’est sans doute pourquoi la plupart des correspondants de presse européens en Turquie ont relayé les déclarations apaisantes de Recep Tayyip ERDOGAN, sans mettre en doute le moins du monde, la bonne foi de celui qui, lorsqu’il était maire d’Istanbul (1995-1998), avait affirmé « Je suis l’imam d’Istanbul ».
La correspondante du journal Le Monde n’a pas échappé à l’ambiance générale. Nicole POPE écrit dans son article publié le 5 novembre 2002, un paragraphe qui, en 2020, laisse rêveur :
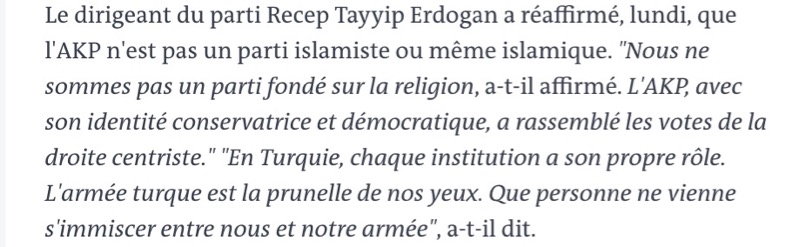
Les journalistes aveuglés par l’a priori favorable qu’ils avaient pour l’adhésion de la Turquie, ne cherchaient pas à être complaisants, ils étaient simplement devenus incapables de voir la réalité.
Soit ils connaissaient l’Histoire de la Turquie et de l’Empire ottoman, et d’évidence ils l’avaient oubliée, soit ils la méconnaissaient.

Les Premiers ministres de la République de Turquie
o0o
3 12 Les observateurs européens en Turquie, désarmés face à l’islam
Combien savaient qu’il était francophile et francophone, passionné par la révolution française, dont il voulait importer l’esprit et les réformes en Turquie ?
Que n’ont-ils lu le discours qu’il a prononcé à l’ambassade de France à Ankara le 14 juillet 1922 pour mesurer l’estime qu’il portait à la République française, et son amour de la France ?
Que n’ont-ils lu le livre de Jacques BENOIST-MÉCHIN publié en 1954 chez Albin MICHEL Mustapha Kémal ou la mort d’un empire ?
Ils auraient pu y trouver les nombreux propos virulents contre l’islam attribués à ATATÜRK ? Propos qui lui vaudraient aujourd’hui d’être condamné à mort, et assassiné, comme un simple journaliste de Charlie Hebdo. (voir en complément l’article publié en 2014 : ATATÜRK et la France – L’image d’un “bon dictateur”
Depuis qu’il n’a plus besoin de l’Union européenne pour asseoir son pouvoir personnel, le président ERDOGAN, qui n’est ni naïf ni ignorant, ne manque plus de rappeler, à tous les Turcs qui vivent en Europe qu’il faut qu’ils se méfient des mots. La plupart des Européens entendent la laïcité comme la liberté et/ou l’indifférence religieuse. Mais pour le président ERDOGAN le mot laïcité rime trop avec athée.
Répondant à Jean-Jacques BOURDIN qui l’interrogeait sur RCM (22 octobre 2020), François BAYROU a rappelé les principes laïcs en France : « la laïcité n’est pas une arme contre la religion ».
Les catholiques français ont mis plus d’un demi-siècle pour s’en convaincre. En Turquie, à en croire le résultat des élections, les musulmans en sont de moins en moins convaincus.
En France, les exigences laïques sont paradoxalement de plus en plus rappelées et contestées, alors qu’elles sont, à l’évidence, de plus en plus méconnues et/ou incomprises.
En écartant le religieux et la religion de l’École à tout crin, sans discernement, on n’a fait progresser ni la paix sociale, ni la paix culturelle, par contre on a fait progresser l’inculture généralisée, lit de toutes les incompréhensions, de tous les malentendus, de toutes les manipulations, et de toutes les violences.
Les journalistes européens vantent souvent la “laïcité en Turquie” sans la connaître, sans connaître les drames de son histoire, sa singularité et sa fragilité.
La laïcité modèle turc et la laïcité modèle français, modèle d’origine, n’ont malheureusement de commun que le nom. Tous ceux qui ont tenu à confondre les deux modèles ont commis une mauvaise action. Soit ils l’ont fait en toute connaissance de cause dans un esprit partisan, soit ils l’ont fait innocemment, donnant la preuve qu’ils ne savaient pas ce qu’est vraiment le principe laïc unique façonné en France à travers les siècles. (Voir La religion française de Jean-François COLOSIMO -2019)
Les Français sont très fiers de pouvoir affirmer que la laïcité est une spécificité française, qui n’existe pratiquement nulle part ailleurs à l’identique. Ils en veulent pour preuve l’absence de mot correspondant spécifiquement à laïcité dans la plupart des autres langues.
En Europe laïcité et sécularisme sont souvent confondues. Presque toutes les langues de l’Union européenne traduisent ainsi le mot laïcité par sécularisme.
La sécularisation d’une société se reconnaît d’abord à l’affaiblissement de la religion dans les mentalités, les mœurs et les institutions. Avant de découler d’une volonté politique et de se traduire dans le droit, la sécularisation exprime la tendance des sujets sociaux à se dispenser d’une référence obligée à une appartenance religieuse. Pour apprécier le degré de sécularisation d’une société, on ne se demande pas si la religion est revendiquée par une majorité ou une minorité d’individus, mais si elle conditionne les comportements et contribue à façonner les liens sociaux.
Un tel effacement de la référence religieuse ne signifie cependant pas que la religion serait nécessairement rejetée comme illusoire ou aliénante.
La sécularisation indique plutôt une indifférence au religieux et un relâchement dans les pratiques cultuelles traditionnelles. On perçoit en elle un certain mode d’existence sociale, qui relève plus du vécu que d’une conception construite et consciemment assumée…
o0o
Fin de l’article tel que mis en ligne le 27 octobre 2020
3 13 Laïcité : sécularisation contrainte et forcée de l’espace public
Dans aucune société, mêmes dans celles qui se sont toujours voulues les plus tolérantes, la liberté vestimentaire n’a été totalement sans limite et/ou sans interdit. En 2005, les Anglais, pourtant fiers d’être les plus libéraux en la matière, n’ont pas hésité à condamner sans ménagement le prince Harry, fils du prince Charles d’Angleterre, parce qu’il avait eu le mauvais gout de se déguiser en officier nazi lors d’une soirée costumée.
Nul n’a jamais été totalement indifférent au regard de l’autre, ni au paraître de ses semblables. De même, nul n’a pu s’exhiber partout , vêtu ou dévêtu, selon son seul bon vouloir.
La façon de s’habiller montre ce que l’on est, ce que l’on veut faire voir ou ce que l’on essaie de cacher. Elle peut aussi montrer, ce que l’on pense et ce en quoi l’on croit, ou ne croit pas.
En Turquie, depuis le XVIe siècle, le lien entre le spirituel et le temporel était encore plus évident puisque le califat et le sultanat étaient incarnés dans une seule et même personne.
C’est pourquoi, après la déposition de MEHMED VI, le dernier sultan de l’Empire ottoman, le 1er novembre 1922, après la création de la République de Turquie le 23 octobre 1923, Mustapha Kemal ATATÜRK, déposa le cousin de MEHMED VI, qui venait d’être nommé calife, et signa la fin du calfat ottoman le 3 mars 1924. L’islam sunnite turc passa alors sous le contrôle de la République, les imams devenant des fonctionnaires du nouvel État.
La totale séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel est si difficile a réaliser qu’elle n’est restée le plus souvent, cocasserie de la longue histoire des hommes, qu’un vœux pieux. Tous les dirigeants, qui ont voulu affranchir leur pouvoir temporel d’une pesante tutelle religieuse, n’ont eu d’autre choix que de commencer à placer la religion majoritaire dans leur pays sous la tutelle de l’État.
Pour bien marquer ces inversions de tutelles, les hommes en place ont tenu à imposer des changements de codes vestimentaires, ou plus exactement tenu à abroger les conventions marquant l’ancien monde.
C’est pourquoi l’expulsion des congrégations religieuses, notamment des jésuites a été voté en 1880, deux ans avant la création de l’enseignement public laïc et obligatoire (1881-82).
En France, seuls les clercs, les religieux et les religieuses affichaient leur conviction religieuse dans leur façon de s’habiller.
En Turquie, il en allait tout autrement, les sultans avaient en effet imposé au XIXe siècle le port du fez pour les hommes de l’Empire ottoman. Porter le fez était à la fois un signe d’allégeance au sultan et pour les musulmans un signe de soumission à l’islam et au calife.
En interdisant le fez en 1925, ATATÜRK fit d’une pierre deux coups, car il obligea ainsi les hommes turcs à rompre avec leur culture politique et religieuse ancestrale.
En 1934, l’année même où il accordait le droit de vote aux femmes turques, il fit interdire le port du voile dans les administrations et les écoles publiques.
Par contre la séparation du temporel et du spirituel en terre d’Islam, a été, et est toujours extrêmement problématique. C’est pourquoi, dans la plupart des pays de tradition musulmane l’Islam reste la religion de l’État.
En créant la République, ATATÜRK était conscient que séculariser son pays ne serait pas chose facile. Tous les politologues qui ont vanté, et vantent encore, la laïcité de la Turquie inscrite dans sa constitution, oublient que cette laïcité a été une laïcité introduite à pas comptés.
La constitution de 1924 dans sa version initiale stipulait dans l’article 2 : La religion de l’État turc est l’islam. La constitution de la Turquie ne déclare que l’État turc est laïc, qu’après avoir été amendée en 1937.
À la suite de la réforme constitutionnelle de 1982, les kémalistes espéraient pouvoir sauver une fois encore l’héritage d’ATATÜRK. Mais alors, la poussée islamiste dans le monde arabo-musulman était déjà devenue si forte qu’il était devenu difficile de pouvoir l’endiguer avec une simple réforme constitutionnelle.
Grâce aux garde-fous qu’ATATÜRK avait prévu de placer pour encadrer la vie démocratique turque, les Kémalistes ont réussi jusqu’en 2002 à contenir les velléités islamistes qui survenaient régulièrement sous l’influence des wahhabites, des salafistes, ou des frères musulmans, et la bienveillance ou la complicité de l’Arabie saoudite.
Ils n’avaient pas compris combien les réseaux sociaux avaient réussi à écorner l’image d’ATATÜRK en Turquie et dans l’ensemble du monde arobo-musulman.
Pour avoir une idée de ce que de nombreux musulmans reprochent depuis près d’un siècle au père fondateur de la Turquie il suffit de lire un des nombreux articles mis en ligne dans toutes les langues, dont l’un récent publié en 2017, en français : Mustafa Kemal ATATÜRK, l’homme qui voulait anéantir l’Islam
En 2002, les Européens n’avaient malheureusement pas mieux appréhendé les changements qui s’étaient opéré dans la tête de nombreux Turcs, notamment dans la tête des plus jeunes, garçons et filles.
Après les attentats du 11 septembre 2001, les Européens auraient dû s’interroger sur les raisons pour lesquels les Occidentaux, les États-Unis en premiers, suscitaient, tant de haine.
3 14 Une Europe qui se rêve en modèle envié, devenue un repoussoir
Convaincus que l’Europe était un modèle envié par tous les peuples de la terre, ils étaient incapables d’imaginer à quel point elle était devenue un repoussoir. Ils ne mesuraient pas que la grande réussite économique et scientifique des vieilles démocraties européennes avaient été pour la plupart des peuples de la terre, source de frustration et d’humiliation.
Les blessures d’amour propre les plus anciennes, et celles qui demeuraient les plus vives, se trouvaient surtout dans le monde arabo-musulman.
En 1928, dans le nord-est de l’Égypte, fut fondée la Société des Frères musulmans, organisation transnationale islamique sunnite, en réaction contre la modernité importé d’Europe. Paradoxalement, alors qu’elle prônait la lutte non violente, la Société commença par se doter d’un appareil militaire.
Tant que les Frères musulmans, les salafistes et les wahhabites, de toutes obédiences, ne propageaient leurs idées et leurs pratiques qu’en terre d’islam, les Européens n’y prêtaient guère attention. Certains éprouvaient même une certaine empathie pour ceux qui étaient victimes de la répression des régimes « laïcs » au pouvoir.
Lorsque les premiers attentats terroristes ont eu lieu en Europe, ils n’ont voulu y voir que des actes singuliers, perpétrés par des individus isolés.
Fervents défenseurs des droits de l’homme, farouches opposant au racisme, les Européens se pensaient, et se voulaient, sans ennemis, ni à l’extérieur ni à l’intérieur de l’Europe.
Pour préserver la paix menacée par le communautarisme de plus en plus envahissant, les gouvernements européens ont tous voulu croire au bonheur de vivre dans une société multiculturelle pleinement assumée.
Les musulmans qui vivaient en Europe, mais ne voulaient surtout pas devenir européens, n’avaient plus qu’à se plaindre d’islamophobie pour être écoutés, et le plus souvent entendus.
Pour les islamistes, le multiculturalisme sans réserve et sans limite des occidentaux c’est du pain bénit.
« L’islamisme a un certain génie stratégique : il mise sur les droits consentis par les sociétés occidentales pour les retourner contre elles. Il se présente à la manière d’une identité parmi d’autres dans la société plurielle : il prétend s’inscrire dans la logique du multiculturalisme, à travers lui, il banalise ses revendications. Il instrumentalise les droits de l’homme pour poursuivre l’installation d’un islam radical dans les sociétés occidentales et parvient à le faire en se réclamant de nos propres principes. Il se présente à la manière d’une identité parmi d’autres qui réclame qu’on l’accommode, sans quoi il jouera la carte victimaire de la discrimination. C’est très habile. À travers cela, il avance, il gagne du terrain et nous lui cédons. Devant cela, nous sommes moralement désarmés. »
Les pères de la loi de 1905, Jean JAURÈS et Émile COMBES avaient, eux, reçu une solide culture catholique, ils savaient donc parfaitement, ce qui était acceptable ou non pour Rome et pour l’Église de France. Leur laïcité était farouchement anticléricale, mais n’était nullement antireligieuse. Les bouffe-curés les plus intransigeants de l’époque allèrent d’ailleurs jusqu’à reprocher à Jean JAURÈS d’avoir laissé sa fille faire sa communion.
Les pères de la laïcité connaissaient bien la situation. En 1905, ils savaient que près de 90 % des enfants étaient baptisés, en Bretagne plus de 95 % dans certaines paroisses. En 1872 seuls 80 000 Français se déclaraient sans religion. La bataille pour la séparation de l’Église et de l’État était très loin d’être gagnée d’avance. Pour faire respecter la loi, le gouvernement a dû faire intervenir massivement l’armée dans les diocèses les plus rebelles. Ce « détail » n’avait bien sûr pas échappé à ATATÜRK.
En 2020, aucun responsable politique français, fût-il de culture d’origine musulmane ne sait, et ne cherche à en savoir autant de l’islam que ce que Jean JAURÈS savait du christianisme. Considérant le fait religieux comme un archaïsme condamné à disparaître, les élites françaises s’affichent ouvertement majoritairement athées et sont souvent méprisantes pour tous ceux qui ne le sont pas encore. Il est évident que, ouvertement « mécréants » et affichant leur fierté de l’être, ils sont peu enclins à étudier les subtilités de la religion créée par Mahomet. Leur « mécréance » et leur inculture religieuse, auxquelles les catholiques et les juifs de France pratiquants se sont depuis longtemps accoutumés, les condamnent à entretenir avec le monde musulman un dialogue de sourds et/ou des relations purement et dangereusement clientélistes.
En jouant de l’ignorance de leurs interlocuteurs, les islamistes ont ainsi beau jeu de faire passer pour sacrés les codes religieux dont ils sont les promoteurs et souvent les ré-inventeurs, alors que les pratiques qu’ils veulent imposer au monde musulman, puis à l’ensemble de la société ne relèvent pas des cinq piliers de l’islam.
C’est-à-dire qui n’ont rien de central pour la foi des musulmans.
3 15 L’existence de Dieu
Or, une lecture de plus en plus partisane de la loi de 1905 sur la laïcité tend à lui donner aujourd’hui une interprétation fort différente de celles que ses auteurs ont voulu lui donner. En effet, contrairement à la plupart des sectateurs actuels de la laïcité, les rédacteurs de la loi, Émile COMBES et Jean JAURÈS notamment, avaient une solide culture philosophique et religieuse qui leur évitait de tenir ceux qui font « le pari de Dieu » pour des êtres intellectuellement attardés. Ils connaissaient les «certitudes négatives» (Éditions Grasset, janvier 2010) avant que Jean-Luc MARION ne les eût formulées. Ils respectaient ceux qui croient au ciel et leur demandaient de respecter ceux qui n’y croient pas, car ils savaient que l’homme ne peut démontrer ni l’existence ni la non-existence de Dieu.
On peut trouver ridicule qu’une mère appelle son enfant, mon chou, mon lapin. On ne peut en déduire que l’amour pour son enfant n’existe pas.
La foi comme l’amour sont des sentiments intimes qu’il est très difficile de faire partager à ceux qui ne les ont jamais connus ou ne veulent pas les connaître. Celui qui aime son frère ne doute pas un seul instant de la réalité de son amour alors qu’il est bien incapable d’en prouver l’existence à autrui. De même, celui qui aime Dieu, son Dieu, ne doute pas de son existence (cf : Saint Augustin et la première Épître de saint Jean : une théologie de l’Agapè).
En pointant les contradictions des religions, des religieux et des croyants, on peut en déduire que la foi a ses faiblesses ; on ne peut pas en déduire que Dieu n’existe pas. Les quelques enseignants bien intentionnés qui ne pourraient s’empêcher d’essayer de convertir à l’athéisme les élèves qui, pour eux, vivent encore dans une « croyance archaïque » s’éloigneraient de l’idéal laïc originel et prendraient le risque d’allumer dans l’école, des querelles qu’on espérait révolues.
La laïcité française s’est construite en lutte contre le dogmatisme clérical. Pour que la laïcité garde aujourd’hui sa pertinence et son exemplarité, elle doit prendre soin de lutter contre le modernisme d’autorité qui devient à son tour un dogmatisme, comme si l’histoire avait retrouvé un nouveau sens unique.
Les sectes à caractère eschatologique (relatif à l’étude des fins dernières de l’homme et du monde) se développent de plus en plus. On assiste à une montée de l’irrationnel. C’est le rôle de l’enseignant de lutter contre cette tendance.
La laïcité ne doit pas être dogmatique, mais elle ne doit pas abdiquer devant le fait religieux. Dans les cas où la science est en contradiction avec la croyance, l’enseignant ne peut choisir que la science. Il n’y a pas une vérité du religieux et une vérité de la science qui pourraient être mises en concurrence. La foi, même éclairée par la raison, est une donnée personnelle tout à fait respectable, mais qui relève d’autres raisons que la science.
Le savoir scientifique dénonce les superstitions, il place les religions dans le domaine uniquement spirituel, mais il n’a pas apporté à l’homme de certitudes, rendant finalement encore plus difficile sa position dans le monde.
Les adeptes de la Libre pensée (branche athée), apparue au milieu du XIXe siècle, et les partisans de la révolution bolchevique (1917), n’avaient aucun doute sur le triomphe à terme du matérialisme et de l’athéisme, inscrit selon eux dans le sens de l’Histoire.
Dés sa création, l’Union soviétique a ainsi cherché à faire de l’athéisme la religion du pays des travailleurs.
La « science communiste » a été mise au service de l’athéisme. L’éducation des masses à un monde sans Dieu a été affichée comme une priorité par les différents gouvernements, le but étant de prouver l’essence athée du monde et l’incompatibilité radicale entre la science et la religion. Toutes les matières scientifiques ont été mobilisées à cet effet. En 1964, un décret a introduit l’athéisme scientifique comme nouvelle discipline obligatoire dans l’enseignement supérieur et annoncé la création d’un Institut de l’athéisme scientifique.
Depuis GALILÉE, on sait que science et religion ne font pas bon ménage. Le savant, astronome et physicien, a démontré que c’est la terre qui tourne autour du soleil et non l’inverse, mais il n’a pas apporté la preuve de la non existence de Dieu.
Pierre-Simon de LAPLACE est célèbre pour une boutade par laquelle, devant Napoléon, il aurait relégué Dieu au rang de supposition. (Selon Hervé FAYE, ce n’est pas Dieu que LAPLACE traitait d’hypothèse, mais seulement son intervention en un point déterminé) :
« Comme le citoyen LAPLACE présentait au général BONAPARTE la première édition de son Exposition du Système du monde, le général lui dit : « NEWTON a parlé de Dieu dans son livre. J’ai déjà parcouru le vôtre et je n’y ai pas trouvé ce nom une seule fois. » À quoi LAPLACE aurait répondu : « Citoyen premier Consul, je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse. »
Arguant de ces célèbres exemples, dans le monde occidental de plus en plus déchristianisé, nombreux sont ceux qui veulent en déduire hâtivement que, plus on est savant moins on peut croire, et on croit, en Dieu.
Cette idée est tellement répandue aujourd’hui en Europe dans certains milieux, que celui ou celle qui confesse croire ou douter en Dieu est suspecté d’indigence intellectuelle ou de fragilité psychique. Il est intéressant de noter que moins les gens ont de culture en sciences fondamentales, plus ils sont critiques vis à vis de ceux qui ne partagent pas leur athéisme, ou leur indifférence au surnaturel.
« Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène ». Cette citation attribuée à Louis PASTEUR n’a jamais été aussi pertinente. On peut en effet vérifier que ceux qui convoquent le plus volontiers la science pour conforter leurs convictions athées, sont souvent les moins aptes à démontrer les vérités scientifiques auxquelles ils font référence. La quasi totalité de ceux qui affirment doctement » on a démontré scientifiquement que ... » sont totalement incapables de reproduire la démonstration invoquée. Ils sont donc réduits à faire benoitement confiance aux conclusions des travaux de chercheurs beaucoup plus savants qu’eux.
Contrairement à ce que cherchent à accréditer des esprits simples, mais mal informés, les plus grands savants qui ont marqué l’Histoire ne sont pas les plus athées. Ceux qui en doutent peuvent facilement le vérifier : Les scientifiques à la recherche de Dieu — Les grands scientifiques croyants — 25 savants illustres confessent leur foi en Dieu.
Difficile à croire, mais vrai, le père du Big Bang(1927), l’astrophysicien Georges LEMAÎTRE était chanoine. Il fut même nommé en 1960 par le pape Jean XXIII, président de l’Académie pontificale des sciences.
o0o
3 16 La foi et la raison
Les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l’islam ont été confrontés tout au long de leur existence au même dilemme, comment conjuguer foi dogmatique, et raison.
Le judaïsme, religion mère de ces trois religions révélées, a dès son origine convoqué la raison, pour faire une lecture herméneutique et exégétique, et jamais littérale des textes bibliques.
En lisant les Homélies sur la Genèse d’Origène (185–253), on peut constater qu’au IIIe siècle l’un des tous premiers pères de l’Église avait déjà pleine conscience qu’une lecture littérale de la bible était une insulte à l’intelligence :
Qui serait assez stupide pour s’imaginer que Dieu a planté, à la manière d’un agriculteur, un jardin à Eden, dans un certain pays de l’Orient, et qu’il a placé là un arbre de vie tombant sous le sens, tel que celui qui en goûterait avec les dents du corps recevrait la vie ?
« … À quoi bon en dire davantage lorsque chacun, s’il n’est dénué de sens, peut facilement relever une multitude de choses semblables que l’Écriture raconte comme si elles étaient réellement arrivées et qui, à les prendre textuellement, n’ont guère eu de réalité. »
Plusieurs théologiens et savants, Saint AUGUSTIN au IV et Ve siècle, Saint Thomas d’AQUIN au XIIIe siècle, Blaise PASCAL au XVIIe siècle, TEILHARD de CHARDIN au XXe siècle, n’ont eu de cesse d’interroger leur foi à la lumière de la raison.
À la veille du XXIe siècle, en 1998, le pape Jean-Paul II a publié l’encyclique Fides et ratio dont la phrase introductive est : « Fides et ratio binæ quasi pennæ videntur quibus veritatis ad contemplationem hominis attollitur animus. » « La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité. »
Ce qui définit les relations entre la foi et la raison sur le plan de la philosophie chrétienne.
Les universités qui apparaissent en Europe à partir du XIIe siècle, doivent certainement peu au monde musulman en matière d’organisation, en revanche il est acquis que les croisades, qui se sont déroulées entre le XIe et le XIIIe siècles, ont permis aux chrétiens de découvrir, ou de redécouvrir, de très nombreux écrits scientifiques et philosophiques, trésors que les enseignants et les savants européens sauront faire fructifier.
La réflexion est un des thèmes les plus récurrents du Coran, le texte sacré des musulmans. Rien d’étonnant donc que, jusqu’au XVIIIe siècle, les plus grands esprits de l’islam n’aient jamais imaginé qu’il puisse y avoir un conflit entre foi et raison, entre foi et savoir.
On ne sait si c’est la cause ou la conséquence du désamour du monde musulman pour le savoir et la science, mais c’est précisément au moment où les européens entraient dans le siècle des Lumières, que le fondamentalisme wahhabite a fait son apparition.
oo0 JMR 0oo
Mais à la suite des politiques inconséquentes menées par les Occidentaux, sous la houlette des Nord-américains, la disparition ou l’affaiblissement des États, qui s’opposaient le plus fermement à leur développement, a permis aux divers mouvements fondamentalistes musulmans d’imposer rapidement et massivement leurs vues en terre d’islam, puis aussi dans les pays « mécréants ».
o0o
3 17 Empire ottoman, Arabie Saoudite, terrae incognitae des Occidentaux
Cette réussite cultuelle, culturelle et géopolitique, est si étonnante, était si improbable, qu’elle mérite absolument d’être étudiée et surtout comprise.
L’histoire commence au cœur de la péninsule arabique au XVIIIe siècle, ou plus exactement recommence. En effet le wahhabisme a ses racines, dans les mêmes terres que celles où l’islam a pris naissance 11 siècles plus tôt. Mahomet est né à la Mecque vers 570. Mohamed ibn abd AL-WAHHAB, le théologien père du wahhabisme, est né en 1703 à Uyayna (à 30 kilomètres de Riyad). Le chef de guerre, chef de tribu, qui a fondé la dynastie des SAOUD, Mohammed ben SAOUD ben Mohammed Al Mouqrin, est né en 1710 à Dariya (à 20 kilomètres de Riyad).
Sans AL WAHHAB pas d’Arabie Saoudite, et sans Ibn SAOUD pas de Wahhabisme, car c’est le pacte conclu entre le prédicateur et le guerrier chef de tribu, après qu’ils ont marié leurs enfants, qui a rendu possible en moins de 300 ans la réussite du wahhabisme et celle de l’Arabie Saoudite.
Pour mesurer la valeur de la performance, la comparaison de l’évolution de la France et de l’Arabie Saoudite est éclairante. Plus de mille ans pour faire la France, moins de deux cents ans pour faire l’Arabie Saoudite.
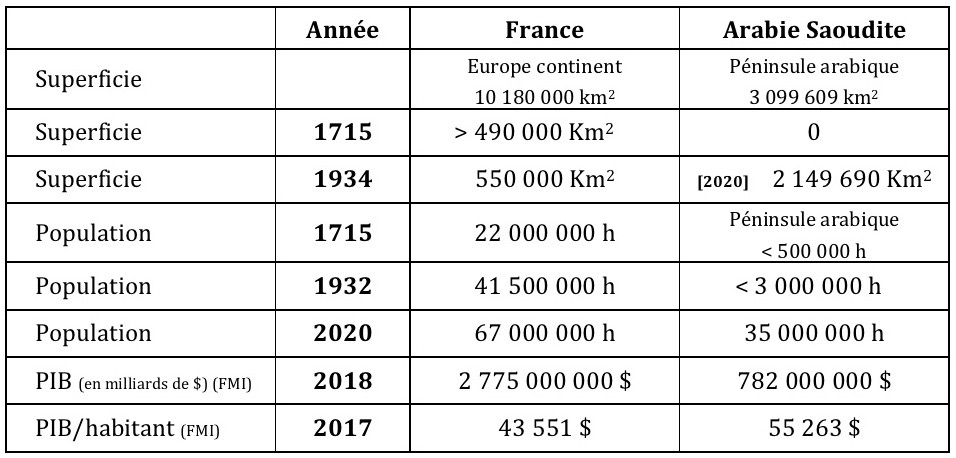
Certains musulmans présentent aujourd’hui le prédicateur du tandem comme un grand théologien, alors que le père du wahhabisme, ne s’est jamais encombré de grandes et savantes recherches. Il a peu pensé et encore moins écrit (son principal ouvrage, Le livre de l’unicité divine ne contient que 50 pages).
Les Saoudiens veulent faire du père de la dynastie SAOUD un grand stratège. Un grand pourfendeur, assurément, un grand stratège militaire, cela reste encore à documenter.
Le théologien n’était pas Saint Thomas d’Aquin, le chef de guerre n’était pas Alexandre, pourtant à eux deux ils ont réussi à vaincre et convaincre toutes les tribus qui se sont trouvées sur leur piste.
Comment expliquer l’efficacité de leur collaboration, comment comprendre le succès de leur entreprise?

L’Empire ottoman aux portes de Vienne en 1683
- Le 29 août 1517 à Alep, après les prières dites en son nom, le sultan , Selim Ier fut déclaré calife. Selim envoya immédiatement à Constantinople les objets sacrés, l’épée, la robe, l’étendard et des dents du prophète, et transforma la ville en centre du califat. Cette proclamation violait manifestement la tradition arabe et plusieurs hadiths qui stipulaient que le calife devait toujours être un membre de la tribu mecquoise des Quray (ou Quraychites).
Le wahhabisme et la révolte du clan SAOUD contre le pouvoir ottoman représentent l’avers et le revers d’une même pièce : le nationalisme arabe.
Le wahhabisme est certes un mouvement religieux de l’islam sunnite, une forme de salafisme revendiquant un retour aux pratiques en vigueur dans la communauté musulmane à l’époque du prophète Mahomet, à l’époque des « pieux ancêtres » (al-Salaf al-Ṣāliḥ ), mais il est aussi, et peut être avant tout, l’expression de l’exaspération de tribus arabes en conflit pendant des siècles avec l’Empire ottoman, conflit politique et militaire, devenu parallèlement conflit religieux.
Menacé au Nord par la Russie, menacé au Sud par les bédouins du Moyen-Orient qui voulaient s’affranchir de sa pesante tutelle, l’Empire ottoman a entamé son déclin, et est entré dans une crise existentielle, plus d’un demi-siècle avant que le wahhabisme prenne son essor.
À l’heure où l’Empire se mettait à douter, fasciné par l’Europe occidentale et sa modernité, le wahhabisme prônait une lecture littérale archaïque des textes fondateurs de l’islam, le Coran et la Sunna, et postulaient que l’interprétation wahhabite était la seule légitime.
Pour la plupart des Occidentaux, l’histoire de l’Empire ottoman se résume à quelques dates : Chute de Constantinople (1453), Siège de Vienne (1529), Bataille de Lépante (1571), Siège de Vienne (1683).
Croyants passer pour des bons élèves, certains ajoutent : Prise de Grenade (1492). C’est bien sûr une erreur, mais elle est tellement commune, qu’il faut en donner l’origine. Dans l’imaginaire des Européens islam, musulmans et Empire ottoman ne font qu’un. Les professeurs d’Histoire ont tellement insisté pour rapprocher la date de la chute de Constantinople de celle de la prise de Grenade, que seuls ceux qui se sont donnés le mal d’approfondir le sujet comprennent que ce sont des Turcs qui ont pris Constantinople, et que se sont des Arabo-Andalous qui ont été chassés de Grenade, des musulmans certes, mais qui n’avaient aucun lien avec l’Empire ottoman.
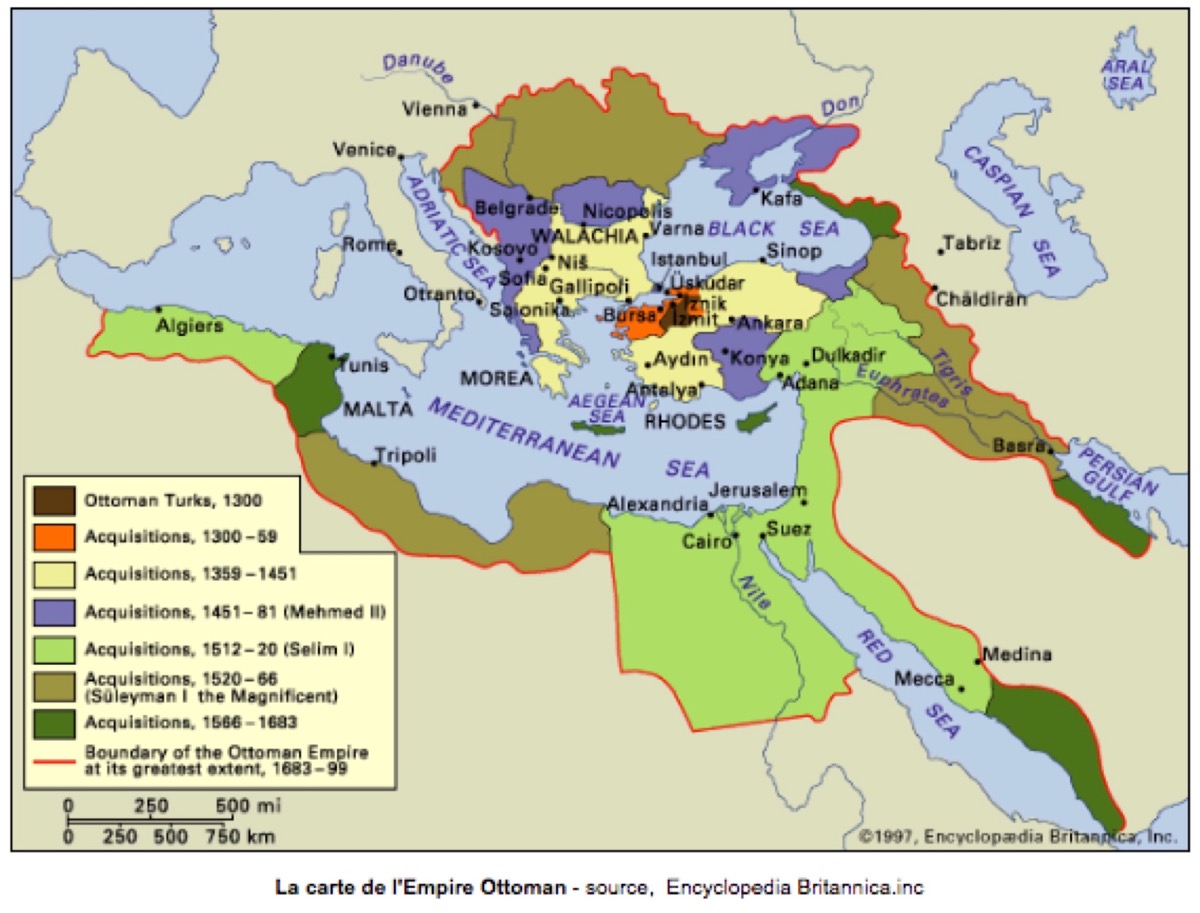
Souvent ignorants de l’Histoire de l’Empire ottoman, les Européens méconnaissent encore plus l’évolution de sa démographie et de sa superficie. S’ils la connaissaient, ils comprendraient mieux pourquoi en Turquie la fierté nationale est un sentiment si puissant et tant partagé.
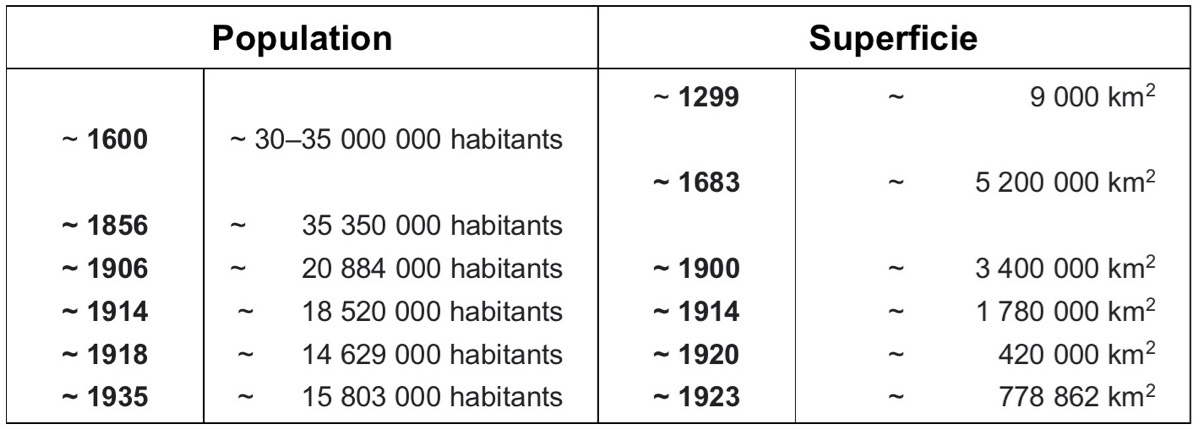
L’Empire ottoman du début (1299) à la fin (1923)
Le nationalisme est la nostalgie d’une grandeur passée, réelle et/ou fantasmée, c’est la fidélité à un héritage, qui fait obligation aux légataires de se montrer dignes des ancêtres qui le leur ont transmis.
Les Européens ont appris dans la douleur que le nationalisme exacerbé conduisait à la haine des autres. Pour conjurer leurs vieux démons qui les ont menés si souvent à la guerre, les fondateurs de l’Union européenne ont fait de la lutte contre le nationalisme l’une de leurs priorités, à l’intérieur de l’Europe.
En bannissant la pensée nationaliste de leur espace mental propre, les Européens ont oublié que le nationalisme restait le ressort implicite ou explicite le plus puissant de l’Histoire. C’est pourquoi ils ont tant de mal à comprendre comment se sont faits les empires, et encore plus comment ils se sont défaits.
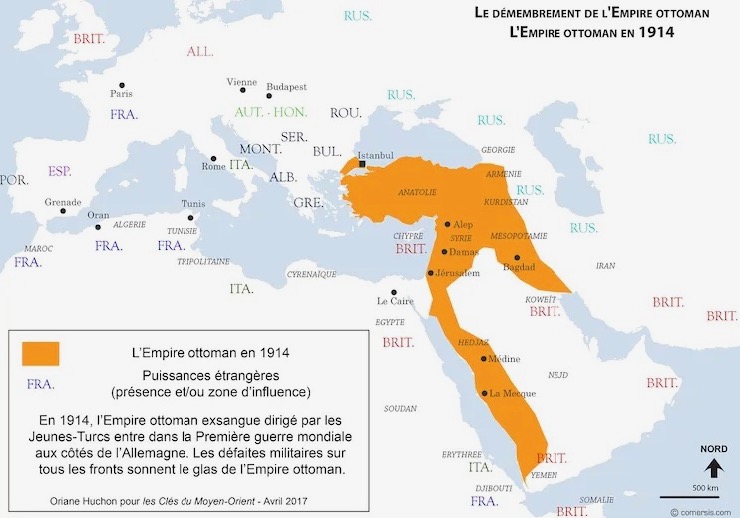
L’Empire ottoman en 1914 – à la veille de sa dislocation
À la veille de la Première Guerre mondiale, l’Empire ottoman avait perdu les deux tiers de sa superficie et la moitié de sa population, optimales.
Le sultan-calife turc, qui régnait alors à Constantinople sur les restes de l’Empire, se rassurait probablement, en pensant que tout n’était pas perdu puisque les ottomans conservaient encore sous leur coupe, La Mecque, Médine et Jérusalem, les trois lieux les plus saints de l’islam.
Malheureusement pour lui et pour l’Empire ottoman, à l’heure où le sultan turc se croyait encore calife, la plus haute autorité religieuse dans l’islam sunnite, les tribus bédouines arabes avaient entrepris de redoubler d’effort pour chasser définitivement les derniers turcs, et leurs soutiens, qui restaient dans la péninsule arabique.
En 1902, Abdelaziz ben Abderrahmane Al SAOUD lança à partir de la région actuelle du Koweït, la reconquête de Riyad, la capitale ancestrale de la dynastie des Al SAOUD, alors occupée par la famille rivale Al RACHID. Après cette conquête, il entreprit d’étendre peu à peu son autorité sur l’ensemble de l’Arabie actuelle, et d’imposer le wahhabisme à toutes le tribus soumises.
Avant de parvenir définitivement à leurs fins, les SAOUD ont dû faire la guerre à l’Empire ottoman sans interruption pendant près de deux siècles.
Le premier État saoudien, constitué vers 1744, trop instable, disparut en 1818.
Le second État saoudien, fondé six années plus tard en 1824, disparut lui aussi en 1891.
Pour que le Royaume d’Arabie saoudite soit enfin viable durablement, il fallait que tous ceux qui s’opposaient à la prise du pouvoir par les SAOUD soient préalablement réduits à l’impuissance.
Pendant 200 ans ces conditions ne purent jamais être réunies. En signant la fin de quatre des six empires qui façonnaient l’Europe jusqu’alors, la Première Guerre mondiale ouvrit enfin à la famille Al SAOUD le chemin du pouvoir.
Après avoir conquis les trois quarts de la péninsule arabique, après avoir repris La Mecque et Médine en 1924, la dynastie Al SAOUD put finalement créer son royaume, le 22 septembre1932.
o0o
3 18 Tarih aynı yemeği iki kez sunmaz
« L’Histoire ne repasse pas les plats » – traduction libre en turc
Ce sont précisément ces alliances, scellées pour préserver la paix, qui vont précipiter l’Europe et le Moyen-Orient dans une spirale infernale conduisant à une guerre mondiale.
C’est ainsi que :
Le 28 juillet, l’Autriche–Hongrie déclara la guerre à la Serbie, le 1er août, l’Allemagne déclara la guerre à la Russie, le 3 août, l’Allemagne déclara la guerre à la France, le 4 août, le Royaume-Uni déclara la guerre à l’Allemagne, le 6 août, l’Autriche–Hongrie déclara la guerre à la Russie, le 11 août la France déclara la guerre à l’Autriche–Hongrie, le 13 août, le Royaume-Uni déclara la guerre à l’Autriche–Hongrie, le 23 août, le Japon déclara la guerre à l’Allemagne.
La Guerre de Crimée (1853–1856) était loin, l’Empire ottoman, l’homme malade de l’Europe, conscient qu’il ne pouvait plus compter sur la France et la Grande-Bretagne pour arrêter une nouvelle fois les Russes, crut trouver son salut en signant le 2 août 1914 un traité secret d’alliance avec la Triplice. Jusqu’en octobre, alors que l’Empire se défaisait chaque jour un peu plus, il tenta de se montrer neutre, bien qu’entrainé inexorablement dans la tourmente.
Cette neutralité de façade, ne pouvait pas faire longtemps illusion, tant la connivence et la coopération des Turcs et des Allemands étaient devenues évidentes depuis des dizaines d’années.
Le 3 novembre 1914, la France et le Royaume-Uni finirent par déclarer officiellement la guerre à l’Empire ottoman.
Lorsque la guerre éclata, les chances de survie de l’empire, créé par les Ottomans six siècles plus tôt, étaient très minces, mais si, comme cela semblait très probable, l’Allemagne et l’Autriche–Hongrie sortaient vainqueurs du conflit, restait quand même un tout petit espoir.
Espoir bien illusoire, on le sait aujourd’hui, car l’importance que le pétrole avait prise dans le monde depuis 1910, en devenant la matière première stratégique la plus recherchée, condamnait l’Empire ottoman à mourir, à très brève échéance.
L’Histoire est en effet très cruelle, elle ne donne pas de deuxième chance à ceux qui ont laissé passer la première.
L’industrie pétrolière est née en Roumanie. La première raffinerie de pétrole a été construite en 1857 à Ploieşti, à 60 kilomètres au Nord de Bucarest, à 700 kilomètres d’Istanbul (Constantinople). La Roumanie fut ainsi en 1857 et 1858 le premier pays producteur de pétrole au monde, avant d’être rejointe par les États-Unis (Pensylvanie) dès 1859, et la Russie en 1861, avec le gisement de Boryslav actuellement en Ukraine.
Après la ruée vers l’or en Californie qui dura environ huit ans (1848–1856), en 1859 commença pour les Américains la ruée vers l’or noir. Une ruée « mondiale » qui, elle, n’est toujours terminée.
Alors qu’aux États-Unis, l’importance économique et stratégique qu’aurait le pétrole fut rapidement comprise par les industriels, les politiques, les banquiers et les militaires, à Constantinople, les grands vizirs se montrèrent incapables de saisir LA chance de l’Empire ottoman.
La Roumanie ne s’émancipa de la tutelle ottomane qu’en 1878, année de son indépendance plénière. Les responsables économiques et politiques ottomans eurent donc 20 ans pour sauvegarder ou partager les puits de pétrole roumains.
À la fin du XIXe siècle, et plus encore au début du XXe, l’importance stratégique du pétrole était établie sans réserve dans les pays les plus industrialisés et les plus avancés scientifiquement.
Chaque année, de nouvelles nappes pétrolifères étaient découvertes, partout dans le monde. Il est donc acquis aujourd’hui que, si les Ottomans avaient multiplié les forages dans les couches géologiques de leur vaste et riche Empire, ils auraient forcément trouvé rapidement l’or noir, qu’ils possédaient si abondamment dans leurs sols.
Albanie (1913) [Au début du XXe siècle on compte en Albanie des proportions quasi identiques entre les chrétiens et musulmans (47 % de chrétiens pour 53 % de musulmans], Bulgarie (1908), Grèce (1821–1913), Monténégro (1910), Roumanie (1878), Serbie (1878).
Dans le Caucase, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord , les populations, bien que majoritairement musulmanes, souhaitaient elles aussi s’affranchir de la tutelle ottomane et s’efforcèrent de devenir indépendantes.
Dans la région de Constantinople, au cœur de l’Anatolie et partout où les ottomans avaient fait souche où restaient culturellement hégémoniques, la question n’était pas l’indépendance, mais la survivance.
Conscients de la descente aux enfers que vivait l’Empire, les Turcs de sang, les Turcs de cœur ou de raison, s’interrogèrent de leur coté pour essayer de comprendre comment, et pourquoi, l’Empire s’était tant affaibli.
o0o
3 19 Le Comité Union et Progrès (CUP) dans l’Empire ottoman
Pour les jeunes intellectuels turcs, les retards accusés par l’Empire ottoman militairement et économiquement, étaient liés à la faillite des politiques menées par les dirigeants depuis plus d’un siècle.
Ils accusaient sévèrement les sultans de s’être montrés incapables de moderniser l’armée et l’économie et d’avoir ainsi laissé les Empires européens et les États-Unis surclasser l’Empire ottoman dans presque tous les domaines.
Automobile, aviation, chemin de fer, radiophonie, télégraphie, appareils frigorifiques, photographie, cinématographie. Aucune de ses inventions technologiques n’avaient été conçue dans l’Empire ottoman.
Les jeunes Turcs, souvent étudiants d’établissements d’enseignement supérieur, savaient tout cela pertinemment. Ils en éprouvaient beaucoup de ressentiment, et une grande honte. Ils savaient par ailleurs, qu’il était plus facile et moins long d’aller de Constantinople à Paris (3 000 kilomètres), que de Constantinople à Bagdad (2 300 kilomètres).
La ligne directe Orient–Express, permettant d’aller de Paris à Constantinople (3 000 kilomètres dont un tiers dans l’Empire ottoman) fut inauguré en 1883 (via Budapest et Bucarest) et en 1888 (via Belgrade et Sofia).
La ligne de chemin de fer Konya–Bagdad (1 600 kilomètres), qui devait prolonger la ligne Constantinople-Konya (700 kilomètres) ne fut commencée qu’en 1903 et ne fut terminée qu’après 1913. Malgré l’assistance technique et le financement de l’Allemagne, ce chantier situé entièrement dans l’Empire ottoman fut long et difficile à réaliser.
En 1908, pour imposer la modernisation de l’Empire ottoman, les Jeunes-Turcs donnèrent le signal de la révolte, lancèrent leur révolution.
Les soulèvements, qui prirent naissance en Macédoine, encadrés par le Comité Union et Progrès (CUP), obligèrent le Sultan à céder aux principales revendications formulées par les Jeunes-Turcs.
Le 24 juillet 1908, Abdülhamid II restaura la constitution de 1876 et annonça la tenue d’élections en décembre.
Élections que le CUP remporta de manière écrasante.
Alors qu’ils pensaient que leur révolution sauverait l’Empire, ils eurent la douleur de constater qu’ils avaient, eux en premiers, contribué à sa désagrégation. Car il était déjà trop tard.
On sait assez bien ce que les jeunes-Turcs ne voulaient pas ou plus, par contre on ne sait pas ce à quoi ils aspiraient tous vraiment. Les jeunes-Turcs disaient vouloir moderniser l’Empire, mais qu’entendaient-ils par ce mot ?
On sait que nombre d’entre eux prenaient pour modèle la révolution française, mais tout, ou partie ? [voir : Révolution française et jeunes Turcs (1908–1914)].

1 faire entrer l’Empire ottoman dans la modernité technique, industrielle et politique.
L’arrivée du train a en général favorisé considérablement la cohésion économique et politique des pays, mais tout au contraire, le système ferroviaire ottoman a préparé et hâté la dislocation de l’Empire ottoman.
La construction du « réseau ferroviaire turc » a été tardive, laborieuse et chaotique. Pour connaître les vicissitudes traversées on peut lire : L’établissement de la première voie ferrée entre l’Europe et la Turquie. Chemins de fer et diplomatie dans les Balkans et La politique ferroviaire de l’Empire ottoman.
Pour des raisons techniques et financières, les principales lignes ferroviaires ont été construites avec l’assistance de divers pays européens, qui bien évidemment ont souhaité relier en priorité Europe de l’Ouest et Europe de l’Est.
Lorsqu’ils ont enfin reconnu l’utilité et la nécessité des voies ferrées, les dirigeants de l’Empire ont fait preuve de peu d’enthousiasme, et ont éprouvé les plus grandes difficultés, économiques, et politiques pour mettre en œuvre les travaux.
La société ottomane était en effet très divisée, entre ceux qui refusaient la modernité venue d’Europe, car contraire aux valeurs traditionnelles de l’islam, et première cause pour eux du déclin de l’Empire, et ceux qui pensaient au contraire, tels les jeunes-Turcs, que l’Empire ne pourrait retrouver sa splendeur passée que si les Ottomans acceptaient enfin d’adopter les mêmes recettes que les Européens, recettes qui à l’évidence leur assuraient suprématie économique et militaire, depuis des dizaines d’années.
Les jeunes-Turcs n’arrivaient pas à décolérer contre l’archaïsme du pouvoir central et de l’administration, notamment en matière de communication. Comment pouvaient-ils oublier que le pouvoir central avait encore eu recours à des caravanes de chameaux pour communiquer avec ses représentants en Égypte en 1882, alors que la première ligne télégraphique transocéanique avait été mise en service en 1866 ?
2 régénérer l’Empire en lui appliquant des institutions calquées sur celles des États occidentaux.
3 rasséréner les nombreuses minorités ethniques, religieuses, et linguistiques de l’Empire
En août 1909, le CUP revint au pouvoir en position de force. Il fit montre alors d’une détermination et d’une brutalité extrêmes. Il procéda à une révision de la constitution instaurant un régime de parti unique dans lequel le nouveau sultan, Mehmed V ne faisait plus guère que de la figuration.
C’est à ce moment que la devise “Liberté, égalité, fraternité” empruntée à la Révolution française, fut placardée partout pendant plusieurs mois en turc, en arménien et en grec. Cela laissait présager un avenir meilleur pour les minorités de l’Empire. Malheureusement, les Grecs et les Arméniens, ont appris que la fraternité des Jeunes-Turcs était si exclusive et jalouse, qu’elle leur vaudrait la mort ou l’exil.
oMLo
2021.02.10
3 20 De la Révolution française au « génocide arménien »
Les Jeunes-Turcs et les libéraux arabes ne concevaient pas tous de la même manière cette modernité, notamment en Égypte, comme on peut le constater à la lecture de La presse jeune-turque en Égypte et la modernité (1895-1908).
Pour les Jeunes-Turcs comme pour les libéraux arabes, tous les maux de l’Empire découlaient bien sûr de l’ignorance que seule l’éducation et la science pouvaient guérir, mais pour nombre d’entre eux c’était le poids de l’islam traditionnel qui constituait le frein essentiel au progrès.
Dans leurs écrits, le débat portait souvent sur les moyens d’introduire la modernité dans l’Empire en essayant de l’adapter au mieux à l’islam ou plus précisément, en faisant passer ce qui vient de l’Occident comme ne contredisant pas les textes sacrés. La question qui se posait alors aux Jeunes-Turcs et à tous les réformateurs musulmans était : l’islam est-il compatible avec la modernité ? Permet-il le progrès ou est-il ennemi de la science ?
Pour certains Jeunes-Turcs le but n’était plus de concilier modernité et islam, mais de remplacer le second par la première.
En cherchant dans la religion musulmane ce qui permet de légitimer les innovations qu’ils voulaient introduire dans l’Empire ottoman, ils essayaient par tous les moyens de manipuler leurs lecteurs au point de leur faire croire que l’islam n’était rien d’autre qu’une forme de matérialisme.
L’un de leurs plus célèbres penseurs, Ahmed RIZA rêvait même de convertir les musulmans au positivisme d’Auguste COMTE.
Malgré une situation qui apparaissait chaque jour un peu plus désastreuse, les Jeunes-Turcs réussirent à rester au pouvoir d’août 1909 au 13 octobre 1918. Pendant ces neuf années, ils ont tout fait pour tenter de sauver l’Empire en le modernisant à marche forcée.
Mais, bien avant leur arrivée au pouvoir, sauver l’Empire ottoman était déjà devenue chose impossible, car les forces centrifuges étaient trop nombreuses, trop puissantes, et surtout l’Empire avait fini par se faire trop d’ennemis souhaitant sa disparition.
Les Jeunes-Turcs, qui voyaient mois après mois l’Empire fondre comme neige au soleil, parfaitement conscients de l’évolution désastreuse de la situation, fous de rages devant l’impéritie et l’incurie du pouvoir et devant la corruption qui régnait dans l’administration, voulaient tout renverser.
Ils n’avaient en tête que la révolution française comme modèle politique, comme la plupart des mouvements nationalistes et révolutionnaires de l’époque.
Le 11 juillet 1792, en réponse à l’entrée en guerre de la Prusse (25 juin 1792) contre la France, aux côtés de l’Autriche, l‘Assemblée nationale française avait déclaré La Patrie en danger et mobilisé tous les citoyens et toutes ses énergies pour sauver le pays avant qu’il ne soit envahi.
Les Arméniens et les Grecs, vivant au cœur même de l’Empire, au cœur de ce qui fut son berceau turc, l’Anatolie, eurent alors le malheur de ne pas être turcs et d’être jugés trop nombreux, là où ils ne pouvaient plus rester, pour des raisons hautement militaires.
Les Jeunes-Turcs, étaient idéologiquement formatés, ils étaient prêts à reproduire tous les excès de la Révolution française, pourvu que survive l’Empire fondé par leurs ancêtres, pourvu que triomphe leur vision de la modernité.
Au début du XXe siècle, la modernité, c’était aussi la lutte de classe et le darwinisme social, qui faisaient peu de cas des droits de l’homme, comme l’Histoire l’a montré.
Contrairement à ce que les Jeunes-Turcs avaient un moment espéré, plus la guerre durait et s’étendait, moins la coexistence pacifique avec les minorités grecques et arméniennes leur semblait possible, voire même souhaitable.
Depuis 1912 c’en était fini du pluralisme ottoman. La logique du nationalisme s’était emparée de l’Empire. Elle se fondait sur des critères religieux. Le caractère autoritaire et centralisateur de l’idéologie unioniste des Jeunes-Turcs les conduisait à la construction d’une identité turque musulmane homogène et, en parallèle, à l’étatisation de l’Islam sunnite.
Considérées comme allogènes et associées aux puissances européennes et aux chrétiens qui avaient déjà quitté l’Empire, les minorités chrétiennes d’Anatolie ne pouvaient plus faire partie de leur projet.
Pour les unionistes, l’Anatolie devait être turcisée, ou plus exactement re-turcisée. Cet objectif, était aussi recherché pour certains au nom d’une vision biologique des rapports entre les nations,
Accusés de trahir l’Empire, d’apporter leur soutien aux soldats russes dès que l’occasion se présentait, les Arméniens étaient depuis des dizaines d’années victimes de massacres, certes localisés et limités, mais récurrents.
Dans ce qui correspond à la Turquie actuelle, on comptait 17 millions d’habitants, dont 9% de Grecs et 8,5% d’Arméniens. Bien qu’ils n’aient pas été les plus nombreux, ce sont les Arméniens qui furent les premières et les plus nombreuses victimes des déplacements de population programmés par les Jeunes-Turcs. Ils n’étaient pas les plus nombreux, mais ils avaient le malheur d’être les plus mal placés.
Le 25 avril 1915, débuta le débarquement dans la péninsule de Galipopoli de plusieurs divisions britanniques et françaises. La bataille des Dardanelles, commencée le 15 mars 1915, passa ce-jour là de la mer à la terre. Elle ne devait prendre fin que le 8 janvier 1916.
Pour la commémoration des crimes dont ils ont été les victimes, les Arméniens ont retenu la date du 24 avril. Bien que leurs malheurs aient commencé avant, c’est en effet le 24 avril 1915 que le plan destiné à faire un mauvais sort aux Arméniens prit toute son ampleur.
Depuis que le mot « génocide » existe, depuis que ce néologisme a été inventé par le juriste Raphaël LEMKIN en 1943, les Arméniens n’ont eu de cesse de faire qualifier de génocide les massacres qu’ils ont subis. Mais en 75 ans, seule une trentaine de pays a officiellement reconnu leurs malheurs, comme pouvant être qualifié juridiquement de génocide, l’Uruguay le premier en 1965, et la France le 29 janvier 2001 :
Depuis 1923, depuis la création de la République de Turquie, aucun de ses dirigeants n’a toléré que son pays soit mis en accusation pour crimes de guerres, et encore moins, depuis 1945, qu’il puisse être accusé de crimes contre l’humanité.
Une fois encore héritière de la première République française, la République de Turquie, a plaidé pour sa défense, comme son ainée, le principe de nécessité.
Rappelons que, jusqu’en 1985, jusqu’à la publication de la thèse d’État de Reynald SECHER, intitulée, « Contribution à l’étude du génocide franco-français : la Vendée-Vengé », aucun historien français n’osait qualifier de génocide les crimes perpétués par les colonnes infernales dans le bocage vendéen.
On est obligé aujourd’hui d’admettre qu’en Vendée, S’il n’y a pas eu génocide, ça y ressemble !, et qu’en Turquie, Soykırım olmadıysa da bu ona benziyor !.
La première raison est juridique. Le génocide n’étant défini en droit international que depuis 1945, de nombreux pays refusent de qualifier de génocide des crimes commis 30 ans avant cette date.
La deuxième raison est politique. Jusqu’à la fin de la Guerre froide, la Turquie a pu bénéficier de la mansuétude des Occidentaux en général, et des pays membres de l’Otan en particulier. Depuis la chute du Mur de Berlin, depuis l’arrivée au pouvoir de l’AKP la Turquie est devenue une puissance politique, économique et militaire importante. Les pays dans lesquels il n’y a pas de communauté arménienne importante ne voit donc aucune raison de dégrader leurs relations diplomatiques avec la Turquie pour des crimes, prescrits à leurs yeux.
La troisième raison est l’ancienneté. Pour la plupart des dirigeants politiques, un siècle après les faits, la reconnaissance du génocide arménien n’est plus du ressort des parlements nationaux. Il appartient désormais aux historiens, et à eux seuls, de rappeler et d’étudier les faits, et à chacun alors de condamner, ou d’« acquitter », en conscience.
Depuis 1923, considérée comme l’année de la fin du drame arménien, le monde a connu d’innombrables crimes et déportations de masse. Le génocide arménien est présenté comme le premier génocide du XXe siècle, le plus ancien génocide. Mais il ne fut malheureusement ni le plus singulier, ni le plus meurtrier du siècle.
En 2021 les Occidentaux s’accordent à penser que pour sauver une vie, rien ne doit être exclu, preuve en est le principe du confinement généralisé, et accepté. En 1915, comme les jeunes Français en ce temps là, les Jeunes-Turcs, étaient d’avis que pour que vive le pays de leurs pères, la patrie, rien ne devait être exclu.
Les bons historiens et les diplomates deviennent souvent de plus en plus indulgents avec l’âge. Car ils ont compris qu’en matière de droit international, comme en matière de droit pénal, on ne peut pas bien juger, sans contextualiser. Ils ont appris que les hommes au pouvoir, encensés aujourd’hui, sont souvent d’anciens révolutionnaires, placés hier au ban des nations pour les crimes qu’ils commettaient.
La fin des empires a presque toujours été tragique, l’Empire ottoman n’a pas fait exception. Les déportations et les déplacements de populations ont malheureusement constitué la règle commune. Les Français d’Algérie sont parmi les derniers à l’avoir vécu, oh combien douloureusement !
oo0 JMR 0oo
2021.01.15
Ces propos ayant été tenus à l’occasion du colloque sur le génocide de 1915, qui s’est tenu le 25 avril dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, avec la participation, conjointement et sans heurts, d’universitaires turcs et arméniens, il est acquis que jusqu’à aujourd’hui ils sont incontestables, car sinon ils n’auraient certainement pas manqué d’être vertement contestés par les universitaires arméniens participant au colloque.
En 2021, même les admirateurs d’ATATÜRK les plus fervents ne nient plus l’ampleur des horreurs commises sous la direction des Jeunes-Turcs. Le fait que le père de la Turquie ne soit pas, ou ne soit plus, tenu pour responsable de ces crimes n’y est pas pour rien.
Cependant, tout en consentant à condamner les crimes des Jeunes-Turcs, la plupart des kémalistes ne les reconnaissent que comme de très regrettables excès.
Ils tiennent à rappeler que lorsqu’ils ont mis en application en 1915 leur plan de déportations et de massacres de masse, les Jeunes-Turcs avaient toutes les raisons de croire que la Turquie qu’il voulait créer ne pourrait jamais naître, tant elle avait d’ennemis, avant même d’avoir vu le jour.
Car en 1915, ils ne pouvaient pas imaginer que, contre toute évidence, le général ATATÜRK arriverait à stopper le dépeçage des restes de l’Empire ottoman, et qu’il pourrait mettre un terme à une situation qu’ils jugeaient absolument désespérée.
Les kémalistes veulent encore se convaincre que, c’est parce qu’ils se voyaient acculés à leur dernière extrémité, que dans une pulsion suicidaire, les Jeunes-Turcs ont voulu entrainer avec-eux les Arméniens dans la mort.
o0o
3 21 De la République française à la République de Turquie
Cette notion, qui n’a jamais existé dans le Code pénal français, était largement répandue dans les sociétés les plus patriarcales et les plus traditionnelles, notamment au Moyen-Orient.
Dans l’Empire ottoman, la Charia ne reconnaissait aucun droit à la femme à l’endroit du mariage et du divorce. De même que la femme ne pouvait s’affranchir de la tutelle oppressante de son mari, souvent polygame, les minorités religieuses ne pouvaient tenter de s’affranchir du pouvoir ottoman, sous peine de mort.
Tous les empires, qui avaient façonné, certains pendant de nombreux siècles, l’Europe et le Moyen-Orient, ont disparu au XXe siècle, après fragmentation, dans la violence et dans le sang.
Mais l’Empire ottoman a été incontestablement celui qui a volé en éclat de la façon la plus horrible. L’aspiration à la démocratie, les revendications nationalistes et indépendantistes des diverses minorités vivant sous sa tutelle, ont conduit le pouvoir ottoman, agonisant, à mettre en œuvre des nettoyages ethniques d’une ampleur jamais égalée.
Après l’armistice de Moudros, signé le 30 octobre 1918, le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 par des mandataires du sultan Mehmed VI, a consacré un rapetissement inouï de l’Empire ottoman, qui ne gardait plus en Europe qu’Istanbul et en Asie la partie occidentale de l’Anatolie, moins la région de Smyrne, soit un territoire réduit à 420 000 kilomètres carrés. [Empire ottoman :1 780 000 km2 en 1914 – Turquie : 778 862 km2 en 1923 – 783 562 km2 depuis 1939]
Ce traité humiliant, irresponsable et irréaliste, ne fut évidemment jamais ratifié ni appliqué.
Depuis 1919, forte des puissants alliés qu’elle avait alors, notamment la France et le Royaume-Uni, la Grèce était en guerre contre la Turquie en gestation. Les militaires grecs, venus défendre et libérer du joug ottoman leur coreligionnaires présents depuis des millénaires dans la région d’Izmir (Smyrne), grisés par leurs premières victoires faciles, voulurent pousser leur avantage le plus loin possible au cœur de l’Anatolie.
En décembre 1920, les Grecs purent ainsi camper à Eskişehir, et en juillet 1921 arriver aux portes d’Ankara.
Mais la Grèce se montrant trop gourmande et étant devenue trop proche du Royaume-Uni, la France et l’Italie décidèrent de mettre un terme aux ambitions territoriales des militaires grecs. Pour ce faire, les deux pays allèrent jusqu’à vendre des armes à leurs anciens ennemis.
Depuis mars 1921, tous les autres fronts sur lesquels se battaient les Turcs ayant été libérés, le vent commença à tourner. Mustafa Kemal ATATÜRK et ses alliés purent disposer de davantage de ressources pour contrer l’armée grecque.
En octobre 1921, avec l’Accord d’Angora, la France fut la première puissance de l’Entente à reconnaître le gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie.
En septembre 1922, l’armée turque entra dan Izmir en feu. En octobre 1922, ATATÜRK, avait gagné la guerre. La France reconnaîtra alors et fera reconnaître rapidement la Turquie.
Le traité de Lausanne signé le 24 juillet 1923, marqua la fin de l’Empire ottoman, la naissance et la reconnaissance internationale de la Turquie. Le traité en précisa les frontières et organisa des déplacements de populations pour assurer l’homogénéité religieuse à l’intérieur de ses nouvelles frontières, une grande première.
Le 29 octobre 1923, la Grande Assemblée nationale de Turquie proclama la République.
o0o
3 22 1928: arrivée des Américains au Moyen-Orient.
Mais c’est surtout l’Accord de la ligne Rouge, signé entre les plus grandes compagnies pétrolières mondiales le 31 juillet 1928, qui a modifié fondamentalement et durablement l’histoire du Moyen-Orient et de l’Occident.
Jusqu’alors, les rivalités pétrolières au Moyen-Orient ne concernaient vraiment que les grandes puissances européennes, l’Allemagne, la France et bien sûr le Royaume-Uni. L’Accord de la ligne Rouge marqua l’arrivée des Américains au Moyen-Orient.

C’était compter sans l’apparition de deux nouveaux acteurs, la Turquie de Mustafa KEMAL-ATATÜRK, et l’Arabie Saoudite de Mohamed IBN-SAOUD ou SÉOUD. C’était compter sans les États-Unis.
Jusqu’à la Première guerre mondiale, la Grande-Bretagne grâce à son empire et la France grâce au sien dominaient la politique internationale. À la sortie de la Guerre, dans laquelle leur intervention économique et militaire avaient été déterminantes pour la victoire des Alliés, les Américains devinrent de fait le troisième Grand.
Bien qu’ils n’aient été signataires ni du traité de Sèvres, ni de celui de Lausanne, les États-Unis firent tout pour que les deux Grands leur fissent une place dans leur nouvelle zone d’influence, le Moyen-Orient. Car, instruits par l’expérience de la guerre et bien renseignés par leurs techniciens et leurs experts d’excellence, déjà sur le terrain, les Américains avaient parfaitement compris l’importance économique et géostratégique qu’auraient les gisements pétroliers au XXe siècle.
Comme vu supra, le nom de ce pays provient du nom de la lignée de chefs bédouins qui l’ont bâti en obligeant toutes les tribus nomades de la péninsule arabique à leur faire allégeance.
Pour parvenir à leur fin, ils s’appuyèrent, non pas sur le sentiment national d’un pays qui n’existait pas, mais sur leur vision de l’islam, le wahhabisme. La Mecque et Médine étant dans la péninsule arabique, leurs ambitions monarchiques et religieuses étaient étroitement mêlées. Wahhabisme aidant, ils réussirent à soumettre ou à convaincre toutes les tribus que les lieux saints de l’islam devaient être contrôlés sans partage, par des musulmans wahhabites, ce qui signifiait par les rois d’Arabie.
C’est en profitant de la dislocation de l’Empire ottoman, de la faiblesse et des rivalités des États arabes, qui essayaient de se constituer pendant le conflit mondial avec la caution changeante des Britanniques, que Abdelaziz ben Abderrahmane Al SAOUD, dit IBN-SAOUD, fit la conquête par la force en 1924-1925 du Hedjaz, comprenant les villes de La Mecque et de Médine.
En 1927, en s’emparant du Hedjaz et en s’en faisant reconnaître roi, IBN-SAOUD mit fin à près d’un millénaire de chérifat hachémite.
C’est la fin du califat d’Istanbul et la fin concomitante du chérifat hachémite qui permirent la naissance de la première « wahhabitocratie », régnant sur ce qu’on pourrait appeler le « Wahhabistan ».
Entre 1901 et 1932 elles firent plus de 500 000 morts. À cette époque dans la péninsule arabique, la population correspondant à ce qui allait devenir l’Arabie Saoudite, était inférieure à 2 millions. L’accouchement du premier État wahhabite se fit donc dans le sang de 25 % de la population.
Le wahhabisme peut être ainsi considéré comme le plus ancien totalitarisme. Celui qui est né et s’est propagé dans la plus extrême des violences et la plus extrême intolérance. Les Occidentaux, qui prétendent toujours être les chantres des droits de l’homme, ont malheureusement refusé pendant des décennies de voir cette évidence, par inculture, inconséquence, et surtout par cupidité.
Au XIXe siècle, les Grandes puissances européennes avaient vite compris que lorsque les présidents des États-Unis proclamaient, selon la doctrine Monroe, « L’Amérique aux Américains », il fallait entendre « L’Amérique aux Nord-Américains ».
Au XXe siècle, après le fameux discours du président Woodrow WILSON du 8 janvier 1918 devant le congrès à Washington, la France et la Grande-Bretagne ne tardèrent pas à comprendre que, lorsque les Américains défendaient « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », ils œuvraient pour le droit des peuples à s’émanciper d’une tutelle coloniale pour pouvoir faire allégeance à l’imperium américain.
oMLo
2021.02.10
3 23 Depuis un siècle, y a-t-il une erreur que les Occidentaux n’aient pas commise au Moyen-Orient ?
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, tous les États-majors du monde avaient déjà pris conscience de l’importance géostratégique qu’auraient les puits de pétrole, notamment ceux du Moyen-Orient.
En mars 1938, la découverte de gigantesques gisements de pétrole en Arabie Saoudite, bouleversa l’économie de ce tout jeune État et marqua le début d’une alliance stratégique avec les États-Unis, consolidée et pérennisée par le Pacte du Quincy (14 février 1945). Pacte qui, en échange d’un libre accès au pétrole, engageait les États-Unis à protéger militairement la dynastie des SAOUD. Ce qu’ils firent continument, sans réserves, avec les conséquences que l’on peut mesurer aujourd’hui.,
Tout affairés à se partager le plus rapidement possible les dépouilles de l’Empire ottoman, et à accaparer les prometteuses ressources pétrolières du Moyen-Orient, les Britanniques et les Français avaient eu la folie d’oublier que les nouveaux pays dont ils étaient devenus mandataires étaient habités par des populations très diverses qui avaient toutes des aspirations non moins diverses, et souvent incompatibles.
Charles de GAULLE expliqua dans Mémoires de guerre à propos de son départ pour l’armée du Levant en 1929 : « Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples. » Il ajoutait : « Je savais qu’au milieu de facteurs enchevêtrés une partie essentielle s’y jouait ».
Pour le malheur des Occidentaux, Charles de GAULLE fut bien seul à saisir, dix ans avant la Seconde Guerre mondiale, la très grande importance que ne manquerait pas d’avoir la politique des Européens au Moyen-Orient.
Tous les peuples du Moyen-Orient, notamment ceux qui avaient aidé les Occidentaux à vaincre les Ottomans, rêvaient de souveraineté. Leurs élites, dans leur grande majorité, attendaient juste LA modernité et plus de liberté. Elles espéraient simplement pouvoir suivre l’exemple donné par les peuples des Balkans.
Les élites les plus nationalistes, souvent les plus radicales, rêvaient, elles, au modèle français de révolution, modèle qui venaient d’être imité avec succès (succès pour les bolcheviques) en Russie.
Le 25 octobre 1917 ( 7 novembre dans le calendrier grégorien) la Russie devint le premier pays socialiste de l’Histoire.
Le 2 mars 1919 création à Moscou de l’Internationale communiste (Komintern)
Du 1er au 8 septembre 1920, premier congrès des peuples d’Orient (aussi appelé congrès de Bakou), sommet réuni par l’Internationale communiste qui se tint dans la ville de Bakou.
Le 30 décembre 1922 création de l’Union soviétique
On note que les bolchéviques ont créé l’Internationale communiste et organisé le premier congrès des peuples d’Orient deux ans avant de créer l’Union soviétique. Cette chronologie particulière ne peut surprendre que ceux qui méconnaissent l’histoire et la géographie de la Russie.
Les bolchéviques rêvaient de faire de l’homo sovieticus en devenir un homme totalement nouveau, ils pensaient arriver à démentir les données anthropologiques les plus anciennement établies, mais ils savaient que la patrie du socialisme ne pouvait pas s’affranchir de ses contingences historiques, et encore moins de ses contingences géographiques. C’est pourquoi, dans un environnement géopolitique totalement bouleversé, avant de créer l’Union soviétique, les bolchéviques se sont préoccupés en priorité de la fiabilité de leurs voisins, sympathisants ou alliés politiques potentiels.
Dès 1920 l’Union soviétique chercha à instrumentaliser le nationalisme arabe contre l’Occident capitaliste en général, et contre les impérialismes, britannique, français, puis après la Seconde Guerre mondiale américain.
Le jour de leur création, les nouveaux États du Moyen-Orient espéraient, comme tous les États, acquérir rapidement une indépendance nationale minimale. Mais la richesse de leur sous-sol a fait naître trop de convoitises et attiré trop de prédateurs pour que cette espérance simple puisse devenir effectivement et durablement réalité.
Pour expliquer le chaos géopolitique apparu au Moyen-Orient dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, le plus simple est peut être de convoquer l’effet papillon théorisé en 1972 par Edward LORENZ.
On peut en effet donner le nom de celui qui est à l’origine de tous les drames que vivent encore aujourd’hui les habitants, de l’Irak, de la Syrie, de l’Iran, etc.
Ce nom, c’est Ignacy LUKASIEWICZ, c’est le nom du Polonais, qui après avoir suivi des études de pharmacie à l’Université Jagellonne de Cracovie, a inventé en 1853 la première lampe à pétrole moderne.
La découverte du pétrole lampant, provoqua immédiatement une révolution en matière d’éclairage, et fit naître la soif de pétrole, qui n’a toujours pas fini de s’étancher.
Le pétrole est devenu indispensable à l’économie mondiale dès la fin du XIXe siècle. Pour la plupart des pays producteurs il fut leur plus grande richesse, mais aussi souvent leur plus grande malédiction. Depuis près d’un siècle et demi, l’or noir a été le moteur de la croissance et la source des plus grands malheurs.
Les habitants du Moyen-Orient sont parmi les premiers à l’avoir appris à leurs dépends (voir la bande dessinée de Jean-Pierre PECAU et Fred BLANCHARD, La Malédiction du pétrole, paru en mars 2020).
En 1914 l’Empire britannique recouvrait déjà 26 millions de kilomètres carrés et comptait 400 millions de personnes.
En 1914 l’Empire français recouvrait déjà 11 millions de kilomètres carrés et comptait plus de 80 millions de personnes.
Rappelons que la totalité des terres émergées représente environ 148 millions de km2, soit 29 % de la superficie du globe terrestre. Les deux empires recouvraient donc alors le quart des terres émergées.
En avril 1920, à la fin de la Conférence de San Remo, lorsque la France et la Grande-Bretagne se sont partagé le Moyen-Orient, les Français et les Britanniques pensaient certainement qu’ils devenaient mandataires de la meilleure part de la région.
La Société des Nations (SDN) confia à la Grande-Bretagne le sort de la Palestine, de la Trans-Jordanie, et de la Mésopotamie (Irak), d’une superficie totale de 550 000 kilomètres carrés (population estimée à 23 millions en 1932) et confia à la France celui de la Grande Syrie (Syrie et Liban) d’une superficie de 200 000 kilomètres carrés (population estimée à 4 millions, dont 1,046 millions au Liban selon le recensement de 1932, 614 000 chrétiens et 432 000 musulmans).
Les Français et les Britanniques ne se doutaient pas alors que le plus gigantesque des trésors liquides dormait sous les déserts de la péninsule arabique, dans une zone géographique qui ne ressortait pas des mandats que la Société des Nations (SDN) leur avait accordés.
Ils ne se dotaient surtout pas que l’islam pur et dur de la Confrérie des Frères musulmans, fondée en 1928 en Égypte, et/ou le nationalisme arabe aiguillonné et stimulé depuis Moscou, rendraient leur présence coloniale si problématique qu’il leur faudrait abandonner leurs mandats au Moyen-Orient immédiatement après la Seconde Guerre mondiale.
Après le départ des Britanniques et des Français, pour préserver leur hégémonie économique, les grandes puissances occidentales n’hésitèrent pas à apporter leur soutien aux régimes politiques les moins recommandables, sous réserve qu’ils leurs garantissent des approvisionnements abondants et continus en hydrocarbures.
Brève histoire du pétrole dans la péninsule Arabique (1982)
Durant la Guerre froide, tous les pays du monde furent contraints de choisir leur camp, les pays producteurs de pétrole les premiers, les pays producteurs du Moyen-Orient les tous premiers.
Le royaume d’Arabie saoudite, wahhabite, donc par naissance et par essence, ultra religieux et anticommuniste, avait tout pour obtenir l’assistance technique et la bienveillance politique des Occidentaux, une bienveillance très intéressée.
Les premières compagnies pétrolières exploitantes, toutes américaines, ont en effet attendu 1950 pour accepter un premier accord de partage de leurs bénéfices nets, fixé à 50-50.
En 1973, en représailles au soutien américain à Israël lors de la guerre du Kippour, l’Arabie saoudite imposa un nouveau partage fixé à 60-40.
En 1980, l’Arabie saoudite procéda à la nationalisation complète de toutes les sociétés pétrolières, avec effet rétroactif jusqu’en 1976.
En novembre1988, la compagnie Arabian American Oil Company est devenu la Saudi Arabian Oil Company (ou Saudi Aramco).
Depuis cette date Saudi Aramco possède la quasi-intégralité des ressources en hydrocarbures du royaume et est restée, jusqu’en 2015, la première compagnie pétrolière mondiale en termes de production. Son principal gisement pétrolier à Ghawar, est resté jusqu’en 2019 l’un des tous premiers gisements dans le monde.
Pour le plus grand malheur de toutes les populations du Moyen-Orient, et pour le malheur des musulmans de la planète, c’est le berceau du wahhabisme, c’est le pays arabe le plus opposé au progrès et à la liberté de penser, qui est devenu, le plus vite, le plus riche producteur de pétrole dans le monde.
Pour créer leur royaume, les SAOUD ont bénéficié de circonstances exceptionnelles et inédites. Pour asseoir leur pouvoir et faire prospérer le wahhabisme, les rois saoudiens ont été particulièrement chanceux, ils ont pu devenir sans peine, au sens littéral du terme, les « rois du pétrole ».
Ils ont surtout bénéficié avant, pendant et après la guerre froide, de l’inculture abyssale et de l’inconséquence des Occidentaux.
Depuis un siècle, y a-t-il une erreur que les Occidentaux n’aient pas commise au Moyen-Orient ?
C’est la question que l’on est obligé de se poser quand on fait la somme de toutes stupidités géopolitiques accumulées par les Occidentaux en un siècle, dans presque tous les nouveaux États créés après la disparition de l’Empire ottoman.
3 24 L’or rend fou, l’or noir rend plus fou encore
Les tribus vivant au centre désertique et peu peuplé de la péninsule arabique, restèrent longtemps méconnues du monde, jusqu’à la veille de la Seconde guerre mondiale, jusqu’à ce que les géologues occidentaux trouvent de très prometteurs gisements pétroliers dans le sous-sol de l’Arabie saoudite.
L’isolement, qui constitua pendant des siècles le plus grand handicap des tribus de la péninsule arabique, devint au milieu du XXe siècle un formidable atout, atout dont les SAOUD furent les premiers, puis les uniques, bénéficiaires.
Depuis près d’un siècle l’histoire du Moyen-Orient a une très forte, trop forte odeur de pétrole. On ne peut donc comprendre les évènements qui s’y sont produits sans connaître précisément l’histoire du pétrole.
Grâce à l’immense manne financière qu’elle récupère depuis plus de 70 ans, l’Arabie saoudite, longtemps très peu peuplée, a pu acheter la paix social à l’intérieur du royaume et exporter l’idéologie wahhabite à l’extérieur.
L’Arabie saoudite a reçu tous les dons du ciel, La Mecque, Médine, le pétrole et l’indéfectible bienveillance des Occidentaux en général et des États-Unis en particulier.
Pendant la Guerre froide, face à la montée des régimes nationalistes arabes, laïcs et socialisants, soutenus par l’Union soviétique, grâce à la mansuétude inouïe des Occidentaux, l’Arabie saoudite réussit à passer pour un fidèle allié du « monde libre ». Un monde qui se montrait bien peu regardant en matière de droit de l’homme, et encore moins en ce qui concernait l’anticommunisme, lorsque le pétrole l’exigeait.
Déclaré haram le jour de sa création, le Parti communiste d’Arabie saoudite n’eut ainsi qu’une existence très mineure et éphémère.
Pour hâter le départ des armées soviétiques, en Afghanistan de décembre 1979 à février 1989, les Américains, totalement inconscients, embarquèrent l’intégrisme religieux musulman, né en Arabie, dans leur croisade anticommunisme. On connaît le résultat de cette idée, qui se croyait géniale.
Après la chute du mur de Berlin en novembre 1989, bien que la Guerre froide eût cessé, les États-Unis restèrent, de façon insensée et totalement inconséquente, d’indéfectibles soutiens du régime théocratique de Ryad.
Au XXIe siècle, au regard du principe des droits de l’homme continuellement mis en avant par les responsables politiques américains, le soutien cynique, constant et inconditionnel des États-Unis à la monarchie saoudite est devenu incompréhensible d’un point de vue moral et géostratégique.

Passé le moment d’émerveillement devant toutes les faces de la modernité importées d’Occident, les habitants de cette zone géographique ont eu vite fait de comprendre que les dirigeants des pays occidentaux étaient peu intéressés à faire leur bonheur, fort peu soucieux de ce qu’ils avaient dans la tête, et encore moins de ce qu’ils avaient dans le cœur.
Ils savaient que les hommes pouvaient tuer pour de l’or. Ils savaient que l’or rend fou, ils ont vite appris que l’or noir rend plus fou encore. Le pétrole a fait perdre la raison aux Européens et aux Américains, qui ont cru pouvoir tout acheter, voire pire tout prendre, et qui ont cru pouvoir faire table rase du passé culturel de cette région du monde, encore très peu peuplée lors de leur arrivée.
Jusqu’en 1950, le Moyen-Orient est resté une zone géographique de faible densité de population, inférieure à 20 habitants au kilomètre carré. En 2020, en 70 ans la densité est passée à plus de 110.

De 1950 à 2020, la population du Proche et du Moyen Orient a été multiplié par plus de 5
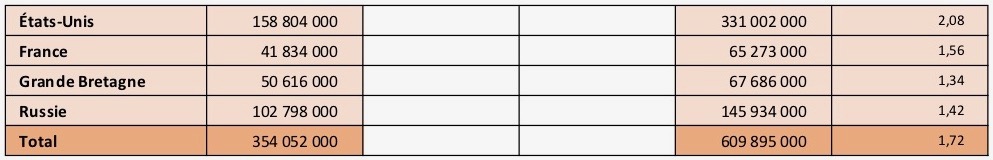
Évolution de la population des 4 premiers États membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU.

De 1950 à 2020, l’Europe, le Vieux continent, de plus en plus vieux.
Négligés, méprisés, spoliés, bombardés, certains à de multiples reprises, des millions d’habitants du Moyen-Orient n’ont jamais manqué, et ne manquent toujours pas, de motifs de ressentiment contre les Occidentaux qui prétendent encore leur imposer « leurs valeurs ».
L’antiaméricanisme virulent qui existe chez tous ceux qui ont eu affaires de près et longtemps à la real politik américaine, s’explique fort simplement.
La politique menée par les Américains au Moyen-Orient depuis des décennies, avec la caution, voire le soutien explicite de la plupart des pays occidentaux, fut du pain béni pour tous les imams salafistes du monde entier, qu’ils fussent salafistes quiétistes, salafistes réformistes ou salafistes djihadistes.
Pour entretenir la détestation du monde occidental chez tous ceux qui entendent leurs prêches, les imams, salafistes ou non, n’ont pas besoin de forcer le trait, il n’ont pas besoin de diaboliser l’univers américain. Nul besoin pour eux de prêcher la haine explicitement, il leur suffit d’inviter leur auditoire à faire appel à leur mémoire, à la mémoire de leurs ancêtres, et à la mémoire de tous les peuples qui ont connu de près l’armée américaine en campagne.
o0o
3 25 Les USA, prompts à donner des leçons, mais pas à donner l’exemple. Le 11 septembre 2001, une surprise bien peu surprenante
Le 8 janvier 1918, le président Thomas Woodrow WILSON, dans son discours devant le Congrès des États-Unis en appela au «principe d’une justice pour tous les peuples et toutes les nationalités, le principe du droit de vivre dans des conditions égales de liberté et de sécurité les uns avec les autres, qu’ils soient forts ou faibles», ce qu’on a ramassé depuis dans la formule : «le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes».

Depuis lors, les dirigeants de la première nation décolonisée du monde, invoquent très souvent l’origine de leur pays, et les nobles et généreuses déclarations de leurs présidents, pour se défendre d’avoir jamais été une puissance colonisatrice.
Il n’est pas grave que des responsables politiques américains profèrent de gros mensonges, par inculture ou par duperie, par contre il est fort regrettable que tant de gens, vivant dans les anciennes puissances coloniales d’Europe, soient si enclins à les croire, en raison de leur coupable ignorance des innombrables heures sombres de l’histoire des États-Unis.
Les interventions militaires des États-Unis dans le monde ont été si nombreuses depuis deux siècles, et leurs motifs si troubles, que peu d’historiens en Europe ont pu en garder la mémoire, et très peu sont capables d’en rappeler les raisons (les prétextes) officiellement invoquées (voir chronologie des interventions militaires des États-Unis publiée dans le journal en ligne Mediapart en 2017).
En déclarant en février 1918 que les peuples ne doivent pas passer de souveraineté en souveraineté, comme s’ils étaient de simples objets le président américain n’a pas manqué d’aplomb, mais il a manqué cruellement de mémoire.
Lorsqu’il s’est permis de fustiger la politique coloniale de ses deux principaux alliés, la France et la Grande-Bretagne, le président WILSON a oublié que depuis leur création les États-Unis ont fait fi de la souveraineté de leurs voisins, en commençant par les Amérindiens qu’ils ont failli exterminer jusqu’aux derniers, suivis des Mexicains dont ils ont annexé la moitié du pays pour en faire des États américains (le Texas, la Californie, le Nevada, l’Utah, l’Arizona, le Nouveau-Mexique, et le Colorado).
De février 1815 (fin de la seconde guerre anglo-américaine) au 7 décembre 1941 (attaque de Pearl harbor), les Américains ont pu croire que le sol des États-Unis était inviolable. Une seule exception mineure à noter : la brève incursion en territoire américain de quelques quatre cents guérilleros mexicains à Colombus en 1916.
L’épisode le plus sanglant de toute l’histoire des États-Unis, la Guerre de Sécession, qui fit à elle seule plus de victimes que toutes les autres guerres auxquelles le pays fut amené à participer, apporta paradoxalement aux Américains la conviction qu’ils étaient invincibles, sous réserve qu’ils restent unis et mieux armés que leurs adversaires potentiels.
Après la Première Guerre mondiale, et plus encore avant la Seconde, les États-Unis avaient acquis une telle puissance économique et militaire que les Américains étaient unanimement convaincus qu’aucune armée étrangère n’oserait, ni ne pourrait défier l’US Army.
Pas étonnant donc que, 80 ans après, l’attaque de Pearl Harbor reste considérée par les Américains comme l’un des événements les plus tragiques de leur histoire.
Pas étonnant que des journalistes et personnalités politiques comparèrent les attentats du 11 septembre 2001 à l’attaque du 7 décembre 1941.
En 2001, même incompréhension, même sidération qu’en 1941, devant ce que les Américains et presque tous les Occidentaux pensaient inimaginable.
Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit depuis 1791 à tous les citoyens le droit de détenir et de porter une arme, n’est pas pour rien dans l’approche très singulière des dirigeants américains en matière de relations internationales.
En raison de l’histoire particulière de leur pays, les Américains ont forgé une culture singulière au regard des autres peuples, notamment des Européens. Le pays s’est construit à coup de revolvers. Ceci explique sans doute pourquoi les Américains aiment toujours tant les armes, et pourquoi ils hésitent si rarement à s’en servir.
Dans la liste des pays par taux d’armement établie en 2007, les États-Unis apparaissent à la première place, avec 89%, devant la Serbie deuxième avec 58%, [Allemagne 14e 30%, Suisse 18e 24%, France 41e 15%, et à la dernière place la Tunisie 175e 0,1%].
Ceci signifie que, en moyenne, un groupe de 100 Américains, de tous âges, détient 89 armes, et qu’un groupe de 1000 Tunisiens n’en a qu’une seule.
À la fin de son second mandat, le 17 janvier 1961, le président des États-Unis, Dwight D. EISENHOWER prononça à la télévision l’un des plus célèbres de ses discours :
« Dans les assemblées du gouvernement, nous devons donc nous garder de toute influence injustifiée, qu’elle ait ou non été sollicitée, exercée par le complexe militaro-industriel. Le risque d’une désastreuse ascension d’un pouvoir illégitime existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés et nos processus démocratiques. Nous ne devrions jamais rien prendre pour argent comptant. Seule une communauté de citoyens prompts à la réaction et bien informés pourra imposer un véritable entrelacement de l’énorme machinerie industrielle et militaire de la défense avec nos méthodes et nos buts pacifiques, de telle sorte que sécurité et liberté puissent prospérer ensemble. »
La mise en garde du président EISENHOWER contre la possible montée en puissance d’un « complexe militaro-industriel » ne fut malheureusement absolument pas entendue par les membres du Congrès des États-Unis. Pendant 60 ans, à la notable et paradoxale exception du mandat du plus rock and roll des présidents américains, Donald TRUMP, la politique extérieure des USA s’est faite au service des intérêts premiers de l’industrie militaire américaine, et non dans l’intérêt de la paix dans le monde, même réduite à la pax americana.
En ne répondant à la violence des organisations terroristes djihadistes que par une super violence d’État, qui peut bien souvent être elle-même qualifiée de terroriste, et pratiquement que par la violence, les États-Unis, suivis des Occidentaux, sont tombés grossièrement dans le piège que leur ont tendu les islamistes.
Depuis 20 ans, les Guerres contre le terrorisme que les États-Unis et leurs divers alliés mènent contre le terrorisme, ou ce qu’ils appellent terrorisme, en commençant par l’Afghanistan, se sont soldées par des échecs cuisants. Comme si partout où les soldats américains posaient le pied pour combattre le terrorisme, celui-ci se renforçait et essaimait.
Il est troublant que, dans un pays où la pratique religieuse reste une des plus élevées du monde occidental, les forces spirituelles et les forces culturelles soient si mal prises en compte par les généraux. Les communistes en leur temps méprisaient les religieux. Ils avaient, eux, l’excuse de professer l’athéisme.
Les Américains sont extrêmement respectueux de la liberté religieuse (Premier amendement de la Constitution), tellement respectueux que pour eux, sous couverture religieuse, n’importe quelle secte peut promouvoir les idées les plus délirantes. Les penseurs et les prêcheurs salafistes les plus fanatiques ont ainsi pu librement proférer au cœur des États-Unis, en toute impunité, sous habillage religieux, les propos les plus violents à l’égard du monde occidental en général, et de l’Amérique en particulier.
Cette grande et folle tolérance intérieure a tout naturellement conduit à une encore plus grande et encore plus folle tolérance extérieure. Depuis que l’Arabie saoudite existe, aucun président des États-Unis n’a émis la moindre critique de l’idéologie wahhabite régentant cette théocratie monarchique.
Non seulement les Américains ont toujours fait preuve d’une grande mansuétude avec tous les princes arabes des divers pays pétroliers, mais ils ont cru judicieux et malin d’instrumentaliser le fanatisme religieux des salafistes à des fins géopolitiques.
Lors de la première guerre du golfe contre l’Irak en 1991, grisés par leur toute nouvelle hyperpuissance, désormais incontestée, sûrs de leur impunité, les États-Unis ont cru pouvoir camper en terre d’islam, en faisant fi des menaces explicites de nombreux salafistes hystérisés.
En prenant pour de ridicules rodomontades les prêches des imams salafistes radicalisés ils ont commis une grave erreur, dont ils ne prendront conscience que lors de la destruction des twin towers.
Malgré ce couteux avertissement, les Américains n’ont tiré aucune leçon de ce drame, ils ont refusé de croire que les prêches qui appelaient au djihad dans de plus en plus nombreuses mosquées, devaient être pris au sérieux, devaient être pris au premier degré. Oubliant leur coûteuse et criminelle expérience vietnamienne, ils ont cru une fois de plus pouvoir régler le problème terroriste sous des tapis de bombes.
En 2001, en œuvre prosélyte depuis plus de 20 ans, le wahhabisme saoudien avait fait souche dans la plupart des grands pays occidentaux. Tous ceux qui avaient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre pouvaient constater que le salafisme avait pris le contrôle idéologique et sociétal de pans entiers des populations d’origine musulmane, notamment parmi les plus déculturées.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis acceptèrent, sans hésiter, de porter assistance à l’Union soviétique, 4 mois avant que l’Allemagne nazie ne leur ait déclaré officiellement la guerre en décembre 1941. Entre deux totalitarismes ils surent promptement faire le choix du moindre mal, de l’urgence et de la nécessité. En juillet 1941, pour choisir le communiste athée contre le nazisme il fallait avoir le sens aigu des priorités, qui n’est donné qu’aux êtres de grande intelligence et de grande culture.
Aujourd’hui, les responsables politiques occidentaux, les Américains les premiers, semblent avoir perdu toute capacité d’analyse prospective. Ils ne développent le plus souvent que des politiques à très courte vue, sans réellement prendre en compte les conséquences de leurs opérations militaires et/ou du choix de leurs partenaires commerciaux.
Les bonnes écoles de guerre enseignent, et l’Histoire a maintes fois prouvé qu’elles étaient bien fondées à le faire, qu’une expédition militaire, ayant pour but de renverser un pouvoir, n’est judicieuse, et ne peut être couronnée de succès, que si elle répond simultanément à trois conditions :
1° Une alternative au pouvoir en place existe et est hautement crédible.
2° On a l’assurance que la vie des populations deviendra meilleure après l’expédition qu’avant.
3° L’engagement a un intérêt essentiel pour le pays qui intervient.
En 2001 (Afghanistan), en 2003 (Irak), en 2011 (Lybie), depuis 2011 (Syrie), aucune de ces conditions n’était remplie.
C’est donc en toute irresponsabilité et en toute inconséquence que les Américains et leurs divers alliés, souvent inconstants et très peu fiables, ont décidé d’imposer à ces pays, par la force, la « paix », la « démocratie » et le « respect des droits de l’homme », avec les résultats catastrophiques que l’on connaît.
Les premiers gagnants de ces « brillantes » interventions militaires sont bien sûr les ennemis islamistes de l’Amérique, qui n’ont jamais eu aussi peu de mal à enrôler de nouvelles recrues. Les seconds gagnants sont les actionnaires des sociétés travaillant pour le complexe militaro-industriel américain, dont les gouvernants n’ont plus voulu réellement, ni pu, réduire l’influence néfaste sur la politique des États-Unis, après EISENHOWER.
3 26 De l’inculture religieuse et historique des Occidentaux
L’Occident chrétien et l’Orient musulman font calendrier à part depuis qu’ils se font face. Cette façon différente de compter le temps qui passe, serait anecdotique si elle n’était le signe le plus symbolique de la difficulté, qu’ont les Occidentaux et les musulmans à voir le monde d’un même point vue.
Comparée à la diffusion du christianisme dans l’Empire romain, l’expansion de l’islam a été extrêmement rapide. Le christianisme fut reconnu comme seule religion de l’État romain 4 siècles après la naissance du Christ, alors que moins d’un siècle après la naissance de Mahomet la presque totalité du Proche-Orient et du Moyen-Orient vivait selon la loi de l’islam, ou plus exactement sous la loi de l’islam.

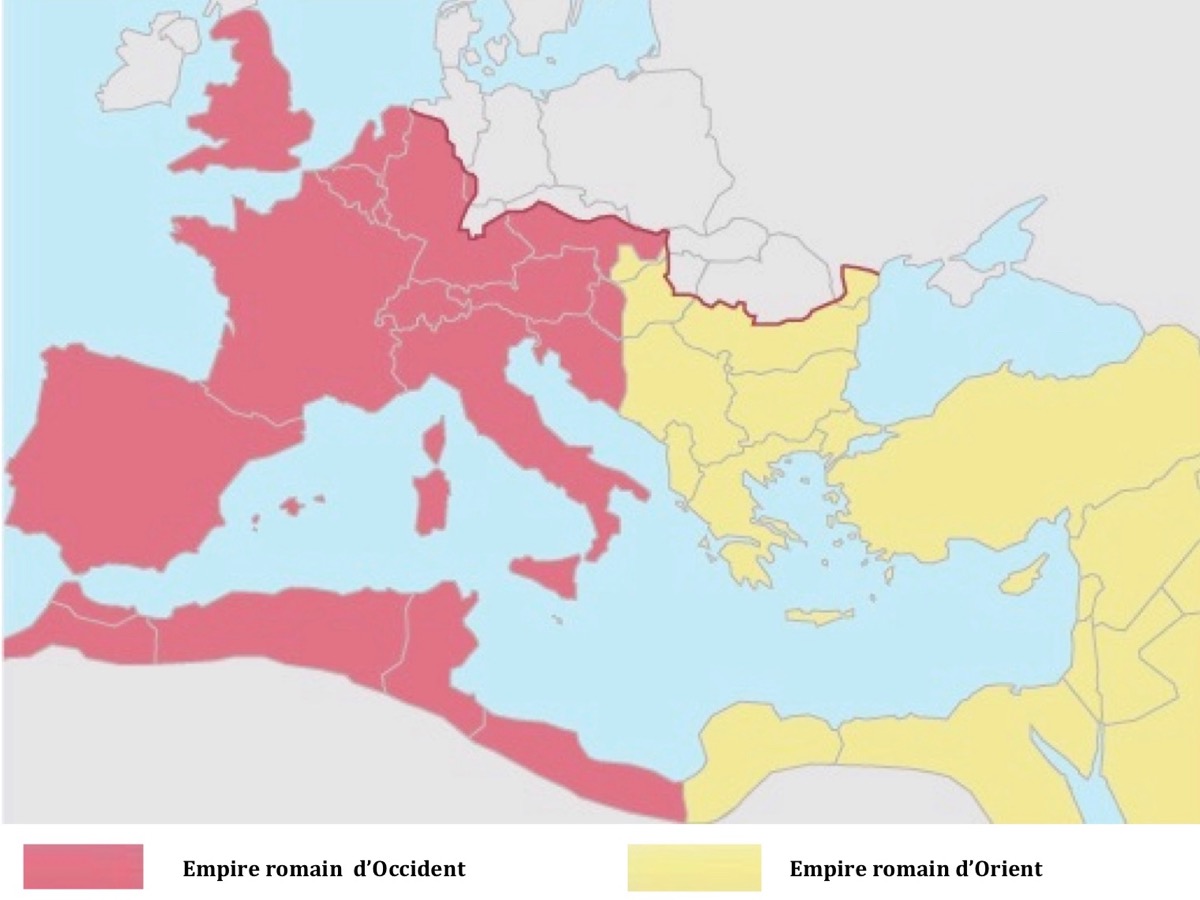
L’Empire romain à la fin du IVe siècle

Diffusion du christianisme du IIIe au Ve siècle
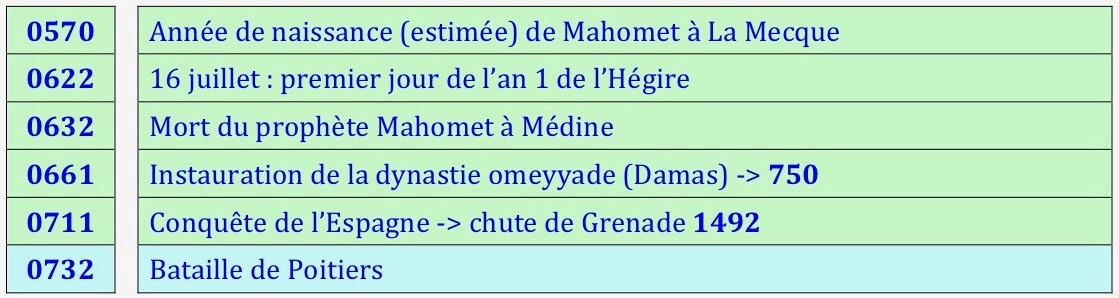

Expansion de l’Islam du VIIe au VIIIe siècle

C’est le miracle du Coran, expliquent fièrement les musulmans. C’est plutôt le «miracle» du sabre et du cimeterre rétorquent souvent les chrétiens.
Jusqu’au début du XXe siècle, pour les historiens occidentaux, la vaillance, la bravoure, pour ne pas dire la brutalité particulière, des soldats de l’islam suffisaient, à eux seuls, à expliquer la phénoménale et fulgurante expansion du monde musulman.
Au XXIe siècle, cette explication apparaît trop simpliste, à presque tous les historiens.
Pourquoi une expansion aussi rapide ? Les sciences humaines et la sociologie apportent leurs réponses. L’histoire des religions apporte aussi les siennes.
La diffusion du christianisme, première religion monothéiste prosélyte, a certainement été ralentie par sa nouveauté et sa complexité théologique, notamment pour ce qui regarde le mystère de la trinité.
Face aux croyances ancestrales répandues et installées dans l’Empire romain depuis des siècles, le message évangélique était en effet trop original pour être compris et adopté sans aucune réserve.
Dès les premiers temps du christianisme, des divergences théologiques sont apparues et ont coexisté, jusqu’à ce qu’un concile s’efforce de les réduire, ou les condamne comme étant hérétiques.
Le concile de Nicée en 325, représente pour les chrétiens un événement essentiel à leur foi. C’est en effet lors de cette assemblée que les évêques définirent ce que devait être le credo (symbole de Nicée) de tous ceux qui se voulaient disciples du Christ.
C’est lors de ce concile que fut condamnée l’arianisme, doctrine professée par Arius et ses disciples, qui est fondée sur la négation de la divinité de Jésus. L’arianisme niait la consubstantialité, c’est-à-dire, l’égalité de substance du Fils avec le Père et considérait Jésus le Fils de Dieu comme une nature inférieure, subordonnée.
Cette hérésie, touche un point essentiel de la foi chrétienne: « la divinité de Jésus», infirmant ainsi le mystère de la Trinité.
Bien que condamné depuis plusieurs siècles, l’arianisme, le christianisme arien avait continué à exister, ou à coexister à côté du christianisme nicéen, lorsque l’islam commença son expansion.
On note que, les populations qui se sont le plus farouchement opposées à l’arrivée des musulmans sont celles dont les évêques professaient le credo de Nicée.
Tandis que les populations dont les évêques étaient restés fidèles à la doctrine d’Arius, ont pu facilement se convertir à l’islam, sans avoir le sentiment de se renier, tant leur rapport à Dieu était proche de celui des disciples de Mahomet.
Les musulmans comme les disciples d’Arius, reprochaient aux nicéens d’être polythéistes, plus précisément tri-théistes. Ils avaient donc tout pour cohabiter, c’est ce qu’il firent pendant des siècles dans la péninsule ibérique.
Le baptême de Clovis en 498, soit plus de deux siècles avant la bataille de Poitiers, marque la fin de l’arianisme dans le royaume des Francs.
Au Ve siècle de notre ère, les peuples germaniques païens qui peuplaient le nord-ouest de l’Europe se sont rendus maîtres de l’Empire romain. Entre le Ve et le VIIe siècles, les vainqueurs de la puissance romaine ont cependant adopté la religion officielle des vaincus, le christianisme. Phénomène paradoxal.
En effet, au début du Ve siècle, les populations de l’Empire n’étaient que superficiellement christianisées. En 476, date qui marque le passage définitif de l’Occident sous la domination des rois barbares, aucun de ces derniers n’était encore catholique. La pérennité du christianisme reposait alors uniquement sur des évêques ne disposant pas de forces armées pour convertir les populations.
Dès lors, comment l’Europe est-elle devenue chrétienne en l’espace de deux siècles? ( voir : Les Racines chrétiennes de l’Europe. Conversion et liberté dans les royaumes barbares, Ve-VIIIe siècle, par Bruno DUMÉZIL, Éditions Fayard.)
Pour convertir les barbares, les évêques durent affronter à la fois le paganisme germanique et l’arianisme, hérésie qui fut, malgré le concile de Nicée, la religion officielle de l’Empire entre 360 et 380.
En 381, au premier concile de Constantinople, deuxième concile œcuménique de l’histoire du christianisme, après celui de Nicée, cent cinquante évêques, tous orientaux, confirmèrent la condamnation de l’arianisme prononcée dès 325.
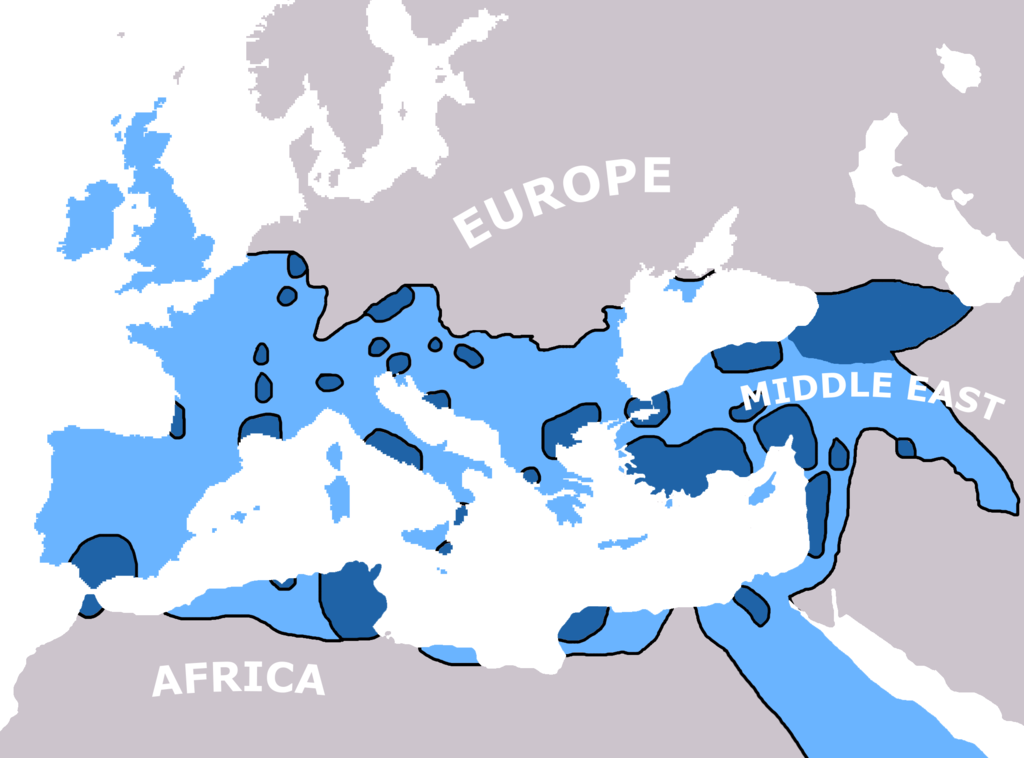
Diffusion du christianisme du IVe siècle au début du VIIe siècle
Lorsque Mahomet et ses compagnons arrivent à Médine, au début du VIIe siècle, en 622, le christianisme s’est diffusé et s’est établi sur la quasi totalité du pourtour méditerranéen, ainsi que dans la vallée du Nil, et jusqu’en Éthiopie.
Le christianisme est alors omniprésent en Europe occidentale et méridionale, souvent depuis plus d’un siècle, tandis que dans la partie orientale et septentrionale de l’Europe il est totalement absent.
Dans de nombreuses régions du vieux continent, le christianisme n’apparaitra que très tardivement, souvent plusieurs centaines d’années après le VIIe siècle.
Les dates de baptêmes des rois et des princes, qui sont souvent connues, permettent d’estimer l’année d’apparition du christianisme dans les différents pays de l’Europe d’aujourd’hui : 863 Moravie, 962 Danemark, 966 Pologne, 988 Russie, 997 Hongrie, 1060 Suède, 1200 Estonie. Il faut noter qu’aux dates indiquées, les noms, Moravie, Pologne, Hongrie, et Suède, correspondaient à des superficies beaucoup plus grandes que celles des pays et des régions nommés ainsi actuellement. (Voir Expansion du christianisme en Europe au Moyen Âge).
On note ainsi que lorsque les Arabes musulmans firent leur première incursion en Europe au VIIIe siècle, le christianisme était bien loin de s’être implanté sur tout le continent.
Lorsqu’en Espagne la reconquista s’achève en 1492, avec la prise de Grenade qui marque la fin de plus de 780 années de présence musulmane dans la péninsule ibérique, cela fait déjà plus d’un siècle et demi que les Turcs ottomans ont traversé le Bosphore et pris pied sur le continent européen. En effet, l’islam ottoman a commencé à s’implanter dans les Balkans, où il devait imposer ses lois durant près de 450 ans, un siècle avant la prise de Constantinople en 1453.
On voit ainsi que, si toutes les régions d’Europe ont été des terres chrétiennes, elles ne l’ont jamais été toutes en même temps. On voit aussi que, depuis la conquête musulmane de la péninsule Ibérique, depuis que le général omeyyade Tariq IBN ZIYAD a débarqué à Gibraltar, depuis 711, les chrétiens d’Europe partagent, volens nolens, les 10 millions de kilomètres carrés de leur continent avec des musulmans.
En décembre 1991, de nombreux Occidentaux ont eu la folie de croire que, la fin de l’Union soviétique, après la fin des dictatures dans la péninsule Ibérique (Salazar, franquisme), en Grèce (dictature des colonels) ou en Amérique latine (juntes), annonçait la «victoire finale» de la démocratie libérale et de l’économie de marché.
Pensant que cette victoire rendait une Troisième Guerre mondiale de plus en plus improbable, Francis FUKUYAMA reprit en 1992 avec grand succès l’hypothèse de la fin de l’histoire.
De son coté, tirant de l’effondrement du bloc soviétique une toute autre conclusion, Samuel HUNTINGTON proposa en 1996 dans son livre Le Choc des civilisations une nouvelle façon d’analyser les relations internationales. Pour le professeur à Harvard, désormais : les lignes de front des guerres du futur seront les lignes de fracture entre civilisations, le premier critère de définition de ces civilisations étant la religion : « La nature d’une civilisation, c’est ce qui s’agrège autour d’une religion » [André MALRAUX – Note sur l’Islam (1956)]. (Écouter : Comment les livres changent le monde (15 épisodes)- 22 juillet 2021 – Épisode 14 : 1997 : Samuel Huntington, « Le Choc des civilisations ».)
Après la chute du système soviétique, l’heure était à l’euphorie et à l’irénisme, à la survenue possible, sinon probable, de la paix perpétuelle. Le livre du chercheur américain fut donc très critiqué, accusé de « nourrir toutes les peurs » et de semer la haine.
Ce livre est considéré aujourd’hui comme le plus important de la fin de la guerre froide, car il a le premier annoncé que les réalités qui diviseraient désormais notre temps seraient d’abord d’ordre culturel et non plus seulement économique, ou idéologique. Il a surtout relevé, que contrairement à ce que croient les Occidentaux présomptueux, il existe sur terre plus d’une civilisation majeure.
Pour Régis DEBRAY : «Il [fut] bon de se voir rappeler que les cultures, comme les religions qui en forment le soubassement, sont plus vouées, par nature, à faire la guerre qu’à dialoguer, d’où l’importance d’une forme de coexistence pacifique.»
Après les attentats du World Trade Center, aucun universitaire, même parmi les plus critiques, n’osa prétendre que c’était le livre de Samuel HUNTINGTON qui avait poussé Oussama BEN LADEN à passer à l’action terroriste.
Qu’il ait fallu attendre HUNTINGTON, pour qu’aux États-Unis et en Europe les universitaires redécouvrent les guerres de religions et les chocs de civilisations afférents, montre combien le multiculturalisme et l’individualisme a fait perdre aux Occidentaux le sens de réalités historiques et culturelles parmi les mieux documentées.
Pour le coup, penser comme l’ont fait ses promoteurs les plus zélés, qu’après la chute du Mur de Berlin, la mondialisation « pacifique » de l’espace marchand conduirait inéluctablement à la mondialisation « pacifique » des espaces culturels et religieux, c’était vraiment croire à la fin de l’Histoire.
Si le livre d’HUNTINGTON provoqua les plus fortes réactions en Occident, c’était parce que depuis la Seconde Guerre Mondiale, et plus fermement encore après 1991, les élites occidentales s’étaient convaincues que la puissance des États-Unis était devenue telle dans tous les domaines, que le modèle américain, the american way of life and of thinking, avait vocation à s’imposer partout dans le monde, et finirait inévitablement par le faire.
Avant que le mouvement woke ne façonne une nouvelle histoire des États-Unis, les Américains avaient progressivement gommé de leur mémoire les liens historiques qui rattachaient la majorité d’entre eux à l’Europe. Il n’est donc pas étonnant qu’en Amérique la théorie du choc des civilisations fut incomprise, jugée comme une crainte infondée, et dangereuse, car propre à devenir auto-réalisatrice si, par malheur, elle se développait.
Accusé d’incitation à une guerre des religions, HUNTINGTON a été attaqué en Amérique par tous ceux qui prônent la mondialisation de la tolérance et de la liberté religieuse, et en Europe, en France notamment, par tous ceux qui prônent la sécularisation et l’indifférence religieuse.
Il est triste que tant d’Européens aient pu reprendre à leur compte les mêmes réserves que celles formulées par les Nord-Américains, sans en mesurer la vanité, et surtout l’incongruité en regard du passé particulièrement tourmentée de leur continent.
Comment les Européens peuvent-ils aujourd’hui tant méconnaitre l’histoire au cours de laquelle leur civilisation si singulière s’est forgée ?
La civilisation européenne n’est pas tombée du ciel, mais elle a pris naissance en pensant d’abord au ciel et au salut des âmes. Depuis le VIIe siècle, elle ne s’est pas développée tranquillement à coté de l’Islam, mais face à l’Islam, et plus encore contre l’Islam.
En août 2021, les Occidentaux, et les Européens les premiers, seraient bien inspirés de relire leur histoire à l’endroit.
o0o
o0o
La foi des musulmans a aussi le droit d’être éclairée par la raison
o0o


La Turquie kémaliste, laïque et féministe, incomprise et trahie par l’Union européenne au nom de ses valeurs, défaite dans les universités

o0o
Les Européens n’ont plus que leurs yeux pour pleurer.




Aujourd’hui, il faut malheureusement se rendre à l’évidence, Recep Tayyip ERDOGAN n’a jamais vraiment cru, lui, à la possibilité d’adhésion de son pays à l’Union européenne. Il n’y a jamais cru parce que sachant les objectifs politiques qu’il voulait atteindre, il savait qu’ils étaient totalement incompatibles avec une éventuelle adhésion. Maintenant qu’il a acquis presque tous les moyens de faire la politique de ses rêves, il cache de moins en moins le fond de sa pensée.

[Le 9 juin 2023, 16 H35, J. B., Auch] : J’ai relu ce qu’ICEO a écrit depuis plusieurs années et rassemblé dans cet envoi, en continu, malgré les quelques urgences que j’ai provisoirement évacuées, tant j’ai été intéressé par le contenu extrêmement documenté de ces articles successifs. Je crois que c’est un des documents les plus intelligents que j’ai pu lire sur ces sujets. Pas de polémique, des faits mis en perspective… On se demande ensuite comment on peut être aussi cons ! Comment on ne voit rien ! Alors que si on réfléchit tout est là sous les yeux….. Bravo et merci.
[Le 27 octobre 2020, 20 H05, J. M., Carnon] : Accord complet – Amitiés